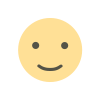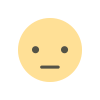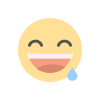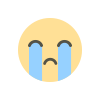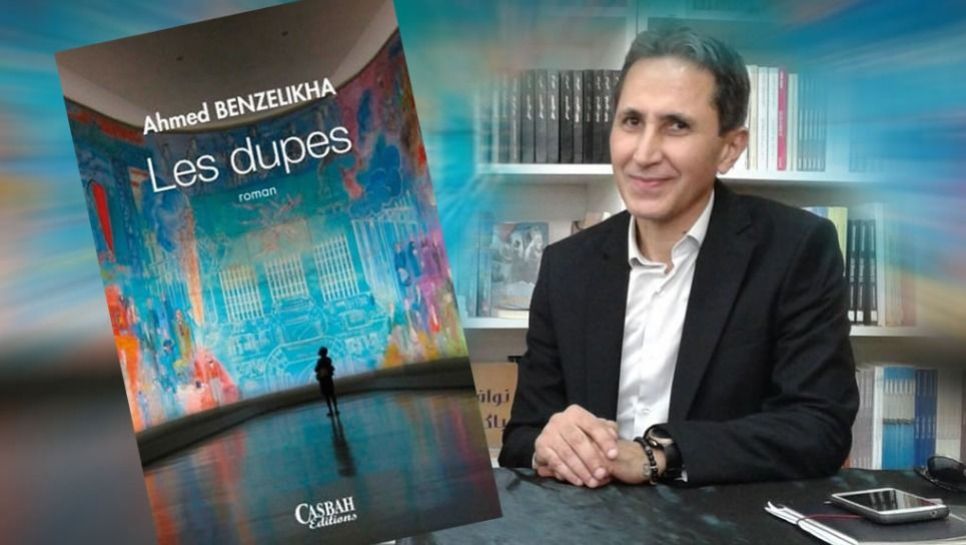Ces « tabous présidentiels » qui bloquent l’économie algérienne par Hassan Haddouche
A l’heure des bilans qu’on ne manquera pas de dresser dans les mois à venir, il faudra certainement inscrire principalement, au crédit de l’ère Bouteflika, le très vaste programme de réalisation des infrastructures économiques et sociales mis en œuvre au cours des 15 dernières années ; même si les conditions de réalisation, et les coûts de […]

A l’heure des bilans qu’on ne manquera pas de dresser dans les mois à venir, il faudra certainement inscrire principalement, au crédit de l’ère Bouteflika, le très vaste programme de réalisation des infrastructures économiques et sociales mis en œuvre au cours des 15 dernières années ; même si les conditions de réalisation, et les coûts de ces infrastructures notamment, continueront longtemps de soulever des interrogations voire d’alimenter la chronique judiciaire.
Dans la colonne du passif il faudra en revanche aligner une longue série de décisions, parfois dogmatiques, souvent intempestives et improvisées, presque toujours d’inspiration populiste, qui ont plongé, sans que la plupart des observateurs y prennent garde, l’économie algérienne dans une sorte de léthargie qui est en grande partie responsable de la médiocrité des performances enregistrées par notre pays en matière de croissance économique depuis maintenant près d’une décennie.
Ces décisions prises au fil du temps et des mandats successifs, suivant des témoignages concordants, par le chef de l’Etat en personne, dessinent les contours d’une doctrine caractérisée par sa très grande rigidité et l’absence complète de bilan de leur mise en œuvre, au point qu’on peut évoquer pour la plupart d’entre elles des « tabous présidentiels » auxquels se heurtent aujourd’hui inutilement la volonté apparente de réforme et de dynamisation de l’économie d’une grande partie de l’exécutif dirigé par Abdelmalek Sellal.
Des prix gelés depuis 15 ans
Au premier rang de ces tabous figure sans aucun doute le gel des prix d’un grand nombre de produits depuis près de 15 ans. L’Algérie de l’ère Bouteflika aura tenté avec constance d’endiguer les contestations sociales et politiques en agissant sur le levier des prix. Au fil du temps, cette politique s’est élargie à un nombre croissant de produits et sa vocation première qui était d’aider les plus démunis s’estompe de plus en plus. Une recette dont le coût, déjà considérable, pour les finances publiques mais également en terme de croissance des importations ne cesse de s’alourdir. Le mécanisme ne se limite malheureusement pas aux seuls produits alimentaires de base et les prix de l’eau, du gaz, de l’électricité ainsi que, surtout, ceux des carburants sont fixés administrativement à des niveaux sensiblement inférieurs à leur coût de revient moyennant le paiement de subventions aux opérateurs concernés. Cette générosité de l’Etat ne profite d’ailleurs pas aux seuls Algériens et on sait qu’elle contribue à alimenter un bassin géographique énorme à travers un vaste trafic frontalier.
C’est ce que les autorités algériennes viennent de reconnaître par la bouche de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre de l’Intérieur parle de danger pour la sécurité nationale et de renforcement des contrôles aux frontières. Avant lui, le ministre des Finances, Karim Djoudi avait annoncé qu’il va introduire dans les prochaines lois de finances une indication sur le montant des subventions pour les produits énergétiques, tout en tenant à préciser que ce sera sans budgétisation. La preuve de l’opportunité d’une telle mesure ? Le ministre des finances vient d’avouer qu’il ne sait même pas combien ces subventions coûtent, ses services étant en train de les évaluer. Pas question donc, pour l’instant de relever les prix de l’énergie et des carburants, mais on saura au moins ce que leur subvention coûte à la collectivité nationale. Il était temps, la croissance de la consommation des produits énergétiques, stimulée par des prix dérisoires, est carrément vertigineuse. Plus de 14% par an pour l’électricité et entre 15 et 20% par an pour les carburants selon des chiffres officiels communiqués dernièrement.
Dans tous les cas, on aura remarqué qu’il n’est toujours pas question de toucher aux prix des produits concernés. Quand on vous dit qu’il s’agit d’un tabou….
Le 51/49 freine l’investissement étranger
Autre « tabou présidentiel » dont la remise en cause serait considérée comme une sorte de crime de lèse-majesté : La célèbre règle du 51/49. Les opérateurs économiques nationaux ont beau critiqué une mesure inefficace et contre productive. Les partenaires étrangers peuvent toujours déplorer un frein puissant à l’investissement dans notre pays. Le FMI peut regretter les occasions d’investissement manquées par l’économie algérienne dans un contexte de crise européenne et de délocalisation tous azimuts. Il n’est pas à l’ordre du jour « pour l’instant » de toucher à la règle du 51/49. Le Ministre de l’industrie, Chérif Rahmani, ainsi que le Premier ministre l’ont répété en chœur ces dernières semaines.
Les évolutions des dernières années ont pourtant confirmé, logiquement, l’impact négatif de la décision prise par les autorités algériennes dès la fin de l’année 2008 à la fois sur le niveau et sur l’orientation des flux d’investissements étrangers en direction de notre pays. Ce sont les très officiels rapports de conjoncture de la Banque d’Algérie qui ont annoncé successivement des investissements directs étrangers, hydrocarbures compris, en baisse sensible. On est passé de 2,2 milliards de dollars en 2010, à 1,8 milliard en 2011 et 1,7 milliard en 2012. A titre de comparaison la Tunisie, en pleine turbulence politique, fait nettement mieux que nous avec un PIB qui est trois fois inférieur.
La nouvelle donne concrétisée par l’annonce au cours des derniers mois de plusieurs projets industriels conclus notamment avec des partenaires français mais aussi américains ou arabes est-elle de nature à relancer la dynamique de l’investissement étranger pour la canaliser vers le secteur industriel ? C’est en tout cas ce que semble espérer le nouveau gouvernement qui s’y emploie avec beaucoup de zèle et en a fait une de ses priorités.
Au sein de ces différents partenariats, les associés algériens sont toujours majoritaires souvent grâce à l’entrée au capital du Fonds public d’investissement, tandis que le management des nouvelles entités a été systématiquement confié au partenaire étranger. La démarche s’apparente quelquefois à un véritable sauvetage des entreprises publiques ainsi que c’est par exemple le cas pour l’ensemble de l’industrie mécanique nationale. Une démarche qui pour l’instant laisse entier le problème de la création d’une dynamique plus large qui associerait le secteur privé national et s’attaquerait résolument au frein que constitue pour beaucoup d’investisseurs étrangers, et en dépit des dénégations des pouvoirs publics, le cadre réglementaire actuel.
L’affaire Djezzy ou la crise du « partenariat privilégié »
L’affaire Djezzy qui a éclaté en 2008, illustre les limites de la règle non écrite qui a consisté dans le choix, accentué par les autorités algériennes de l’ère Bouteflika, d’un nombre réduit de partenaires économiques privilégiés. Cette orientation a été illustrée au cours des années 2000 par l’importance prise par le groupe Orascom dans les flux d’investissement étranger. À lui seul, le holding égyptien a représenté près de la moitié des investissements étrangers réalisés en Algérie. Le groupe est présent non seulement dans la téléphonie mobile mais il a pris également une part importante au programme de développement de la pétrochimie algérienne en association avec Sonatrach, ainsi qu’à l’installation d’usines de dessalement d’eau de mer ou encore à la construction de la plus grande cimenterie du pays. Ce partenariat privilégié va vite se révéler comme un facteur de fragilité. La dégradation des relations entre les deux parties (les deux familles disent les mauvaises langues), à partir de l’année 2008, a plongé l’ensemble de la démarche d’ouverture à l’investissement étranger dans une période de crise. Orascom a en outre engagé, avec dit-on, de bonnes chances de succès, une démarche de recours à l’arbitrage international.
Les conséquences ne s’arrêtent pas là et leur aspect le plus pénalisant est sans aucun doute constitué par l’obstination mise par les autorités algériennes, sur instruction présidentielle, ainsi que l’atteste toutes les sources, à vouloir racheter Djezzy alors même que la quasi totalité des spécialistes considère l’opération comme n’ayant aucun intérêt économique ou technologique. En attendant des développements ultérieurs qui pourraient s’avérer financièrement très couteux pour la collectivité, le « dossier Djezzy » continue d’empoisonner le secteur et aura eu pour première conséquence de faire prendre à l’Algérie plusieurs années de retard en matière de modernisation de ses télécoms.
La liste des tabous présidentiels posés au fil des années comme des lignes rouges infranchissables et qui constituent de puissants facteurs de blocage ou de détérioration de l’activité économique dans notre pays est encore longue. Il faudrait aussi mentionner en bonne place la politique de désendettement qui, avec d’excellentes intentions, mais appliquée de façon dogmatique, a quasiment gelé au plus mauvais moment la coopération entre l’Algérie et les institutions financières internationales. Sans oublier non plus l’obligation du recours au crédit documentaire, encore une oukaze présidentielle, qui visait un meilleur contrôle des importations qui sont aujourd’hui en pleine explosion et menacent la stabilité financière de notre pays mais ceci est une autre histoire…
Hassan Haddouche
Quelle est votre réaction ?