L’insurrection des Righa (Ain Defla): Une poursuite de la résistance algérienne contre l’occupation française
L’insurrection des Righa, déclenchée le 26 avril 1901 à Aïn Torki (au nord-est d’Ain Defla), est considérée comme l’un des soulèvements les plus importants que l’Algérie ait connu sous la colonisation française, avant la Révolution du 1er novembre 1954, et constitue une « preuve tangible » que le peuple algérien n’en avait pas encore fini avec la […]

L’insurrection des Righa, déclenchée le 26 avril 1901 à Aïn Torki (au nord-est d’Ain Defla), est considérée comme l’un des soulèvements les plus importants que l’Algérie ait connu sous la colonisation française, avant la Révolution du 1er novembre 1954, et constitue une « preuve tangible » que le peuple algérien n’en avait pas encore fini avec la résistance contre l’occupation, a soutenu un chercheur en histoire de la région.
Par Maya H./APS
Dans un entretien à l’APS, Ahmed Ben Yeghzer, professeur d’histoire à l’université «Djilali Bounaama» de Khemis Meliana, a expliqué, à la veille du 124e anniversaire de l’insurrection des Righa, également connue sous le nom de «Soulèvement de Margueritte», nom donné à la région d’Aïn Torki pendant la période coloniale, que celle-ci était venue «réfuter les allégations de la France selon lesquelles la résistance populaire contre la présence coloniale en Algérie avait pris fin, surtout après qu’elle ait cru avoir éliminé la résistance d’El Mokrani en 1871 et l’insurrection des Ouled Sidi Cheikh et celle de Cheikh Bouâmama». A cette époque, a ajouté le chercheur en histoire, la France faisait valoir, par l’intermédiaire de certains de ses hommes politiques et militaires, que les soulèvements populaires contre sa présence en Algérie avaient «pris fin» et que «la sécurité avait soi-disant été rétablie pour la France en Algérie». Il a également indiqué que le soulèvement des Righa est considéré comme l’un des événements «importants» de l’histoire de la résistance de l’Algérie à l’occupation française, car plusieurs soulèvements en ont été le prolongement. Il a cité, en exemple, le soulèvement d’Ain Bessam à Bouira en 1906 et celui des Aurès en 1916, en plus des développements qui ont eu lieu en Algérie sur le plan politique, qui ont finalement conduit au déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954. M. Ben Yeghzar a également souligné que le «Soulèvement de Margueritte» était «dirigé contre les colons, à qui la loi de 1900 accordait certains droits, notamment celui de s’emparer des terres fertiles et d’expulser les Algériens ou de les contraindre à les vendre à bas prix». Des sources historiques mentionnent que ceux qui ont planifié le soulèvement, tels que Cheikh Mohammed Yaâkoub Ben Al-Hadj Ahmed, Al-Hadj Ben Aicha, Al-Thaâlibi et Cheikh Al-Majdoub, qui étaient des adeptes de la Tariqa Rahmania, ont convenu de se réunir après la prière du vendredi 26 avril 1901, sur la place Sidi Bouzar et de se diriger vers le village d’Aïn Torki. Bien que limité dans le temps et dans l’espace, le soulèvement «a eu un grand retentissement, à cette époque, sur les médias en France et en Algérie, et même sur le Parlement français, qui a tenu plusieurs sessions pour discuter de ce qui s’est passé en 1901». Quant à la réaction de l’administration coloniale, la répression fut son seul langage, puisque des résistants furent tués, environ 200 personnes arrêtées et quelque 130 d’entre elles transférées à Blida pour y être jugées avant d’être transférées plus tard à l’actuelle prison de Serkadji (anciennement prison de Barberousse) puis transférées pour être jugées en France. Les participants à l’insurrection des Righa avaient été condamnés le 11 décembre 1902 dans la ville de Montpellier, en France, à de lourdes peines de prison à vie et à l’exil au bagne de Cayenne en Guyane en Amérique du Sud, où le cheikh Mohammed Yaâkoub Ben Al-Hadj Ahmed et d’autres membres de la résistance sont morts en 1904.
M. H.
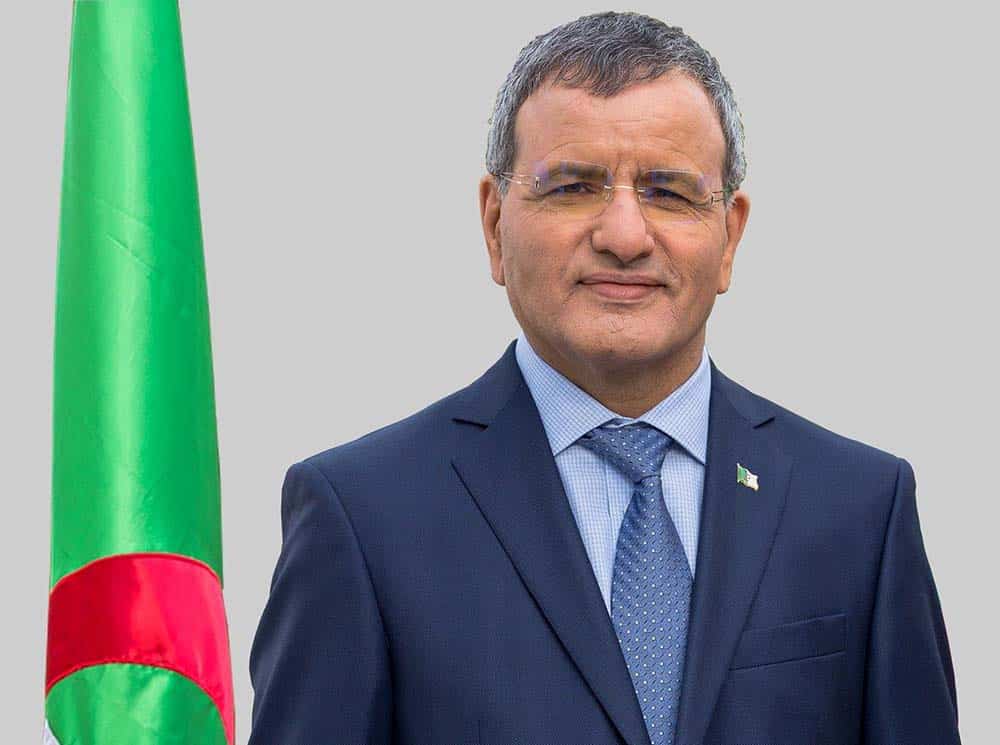




















































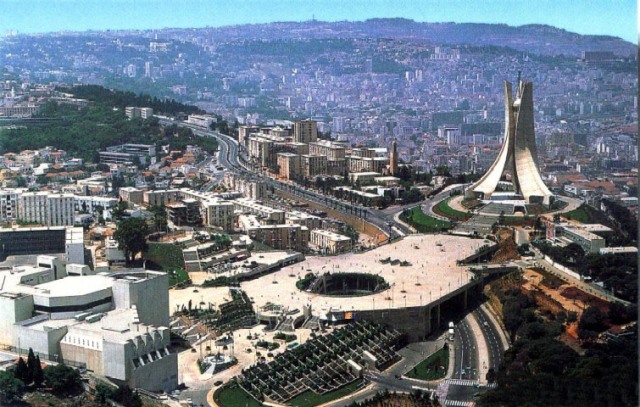










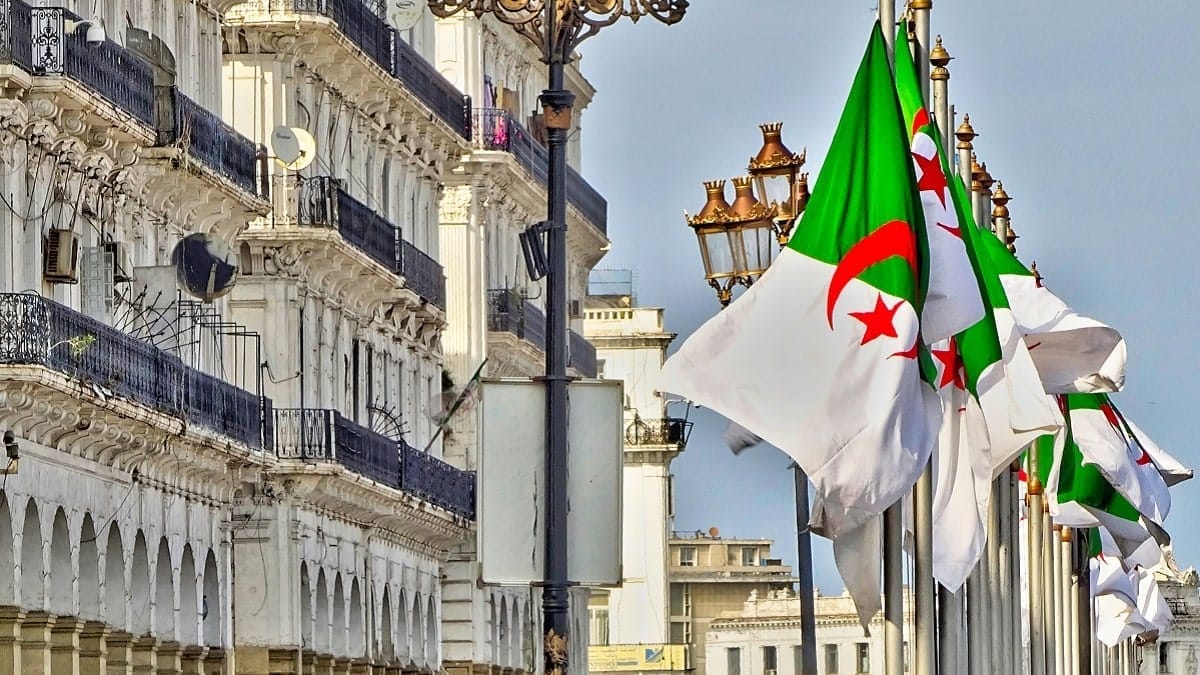


![[Photos] La SARM rend visite aux industries médico-chirurgicales.](https://www.santenews-dz.com/wp-content/uploads/2025/06/IMC5.jpg)






















































