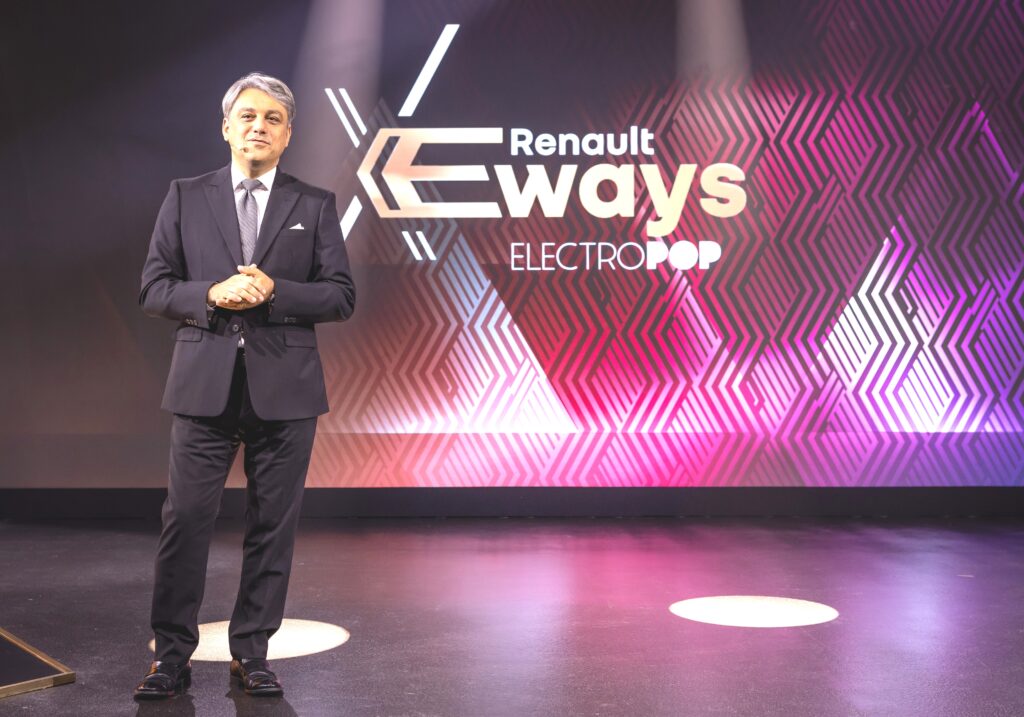Le 8 mai 1945 vécu et vu par Hocine Aït Ahmed
Une trentaine de mois après avoir adhéré, à l’âge de 16 ans, au Parti du Peuple algérien (PPA) et trois ans avant de faire, en figure de proue, son entrée au Bureau politique et succéder à Mohamed Belouizdad à la tête de l’Organisation spéciale (OS), Hocine Aït Ahmed (1926-2015) a vécu avec fougue et une […] The post Le 8 mai 1945 vécu et vu par Hocine Aït Ahmed appeared first on Le Jeune Indépendant.
Une trentaine de mois après avoir adhéré, à l’âge de 16 ans, au Parti du Peuple algérien (PPA) et trois ans avant de faire, en figure de proue, son entrée au Bureau politique et succéder à Mohamed Belouizdad à la tête de l’Organisation spéciale (OS), Hocine Aït Ahmed (1926-2015) a vécu avec fougue et une motivation militante débordante les journées de mai 1945. ‘’Un mois tragique, une semaine historique’’, soulignera-t-il trente-huit ans plus tard au moment d’achever ‘’Mémoires d’un combattant. L’esprit d’indépendance 1942-1952 » (Messinger, Paris) et au moment de donner un titre fort à un chapitre de dix-neuf pages dédié aux tenants et aboutissants de mai 1945.
Pour le jeune homme qui s’apprête à boucler, le 20 août 1945, son 19e printemps dans la ‘’nuit coloniale’’ (dixit Ferhat Abbas), les évènements décisifs et cruciaux se bousculent sous ses yeux et dans son environnement à un rythme effréné. En mars 1945, ‘’grâce à Ouali Bennaï’’, il assiste, à Alger, au congrès des Amis du Manifeste et de la liberté (AML), précise l’historien Ali Guenoun en rappelant, ici, un élément de biographie qui, souvent, échappe à la curiosité générale. ‘’En avril 1945, écrit-il, la victoire des Alliés sur le nazisme et le fascisme n’était plus qu’une question de jours, mais nous, nous avions le sentiment d’être de nouveau piégés et encerclés par a guerre. Le parti préparait fiévreusement les manifestations du 1er mai’’.
Ce faisant, la Fête du Travail ‘’pouvait être l’occasion historique de réaffirmer, à côté des revendications économiques et sociales, l’aspiration nationaliste’’. A l’évidence, Hocine Aït Ahmed et ses camarades lycéens de Ben Aknoun (l’actuel lycée El Mokrani) souhaitent se joindre au ‘’défilé pacifique’’ dans les rues d’Alger. ‘’Nous en fîmes part à Ouali Bennaï qui nous en dissuada, préférant nous garder « en réserve »’’. Adolescent de 13 ans mais fort d’une ‘’prise de conscience’’ précoce, il savait déjà – et il le souligne à grand trait dans ses Mémoires — qu’il vivait ‘’dans un pays colonisé par la France’’ et ressentait ‘’le pouvoir colonial comme un pouvoir étranger’’.
Le 1er mai à Alger, les manifestations ‘’revêtirent un caractère massif’’. Deux cortèges s’ébranlent, l’un à partir de Belcourt et l’autre de la Casbah. Direction la Grande Poste et le Palais du Gouvernement général au cœur de l’ilot colonial. ‘’Répondant à l’appel pacifique, Alger des profondeurs se leva comme un seul homme. La police intervint vigoureusement pour empêcher la jonction des deux cortèges’’. Ouali Bennaï est au rang des manifestants et au premier rang, rue d’Isly (Ben M’hidi). Il ‘’avait l’arcade sourcilière fendue d’un coup de crosse’’, se rappelle Aït Ahmed. Au soir de cette journée, le militant senior rejoint le jeunot Hocine et ses camarades dans la cour du lycée de Ben Aknoun. Motif de sa visite nocturne : leur raconter au moyen d’un récit circonstancié la manifestation au cours de laquelle, outre des blessés, deux militants du PPA sont tombés sous les balles de la police coloniale : Abdelkader Ziar dont le nom jalonne – depuis l’indépendance — une avenue reliant Bab El Oued à Bologhine/Deux Moulins et Ghazal Belhaffaf, frère de Salima, la future épouse de Benyoucef Benkhedda.
Cette journée du 1er mai, écrit Hocine Aït Ahmed en empruntant au témoignage oculaire de son sénior, ‘’est indissociable de la logique répressive comme de la dynamique révolutionnaire. Si le pouvoir colonial visait à terroriser l’opinion, il avait manqué son but. La politique du pire renforce toujours la communion affective. Dans ce cas précis, elle provoqua une véritable mutation psychologique et politique’’. Une semaine plus tard, le 8 mai 1945, à Sétif et dans d’autres contrées du Nord-Constantinois, l’Algérie va vivre ce que le successeur de Belouizdad à la tête de l’OS qualifiera d’’’insurrection de 1871 à rebours’’.
Le dirigeant activiste du PPA s’en explique avec un récit aux allures de reportage in situ : ‘’une vraie guerre s’abat sur les populations des Babors, région qui avait vu l’un des derniers soubresauts de la résistance algérienne. A Kherrata et près de Sétif, des villages entiers sont rasés par l’aviation et la marine. Dans de nombreuses villes du Constantinois, notamment à Guelma, les forces militaires et les milices conjuguent leurs efforts dans une vaste et impitoyable chasse au faciès’’. Et l’auteur de « Mémoires d’un combattant » d’enchaîner dans son témoignage avec le recul du temps et à trente-huit ans de distance : ‘’Près de deux mois s’écoulèrent avant que nous connaissions toute l’étendue de la répression’’, une débauche de violence inouïe qui a provoqué une ‘’boucherie insensée’’.
Les leaders politiques, et religieux incarcérés
En tenant, via ses Mémoires, à léguer pour la postérité de la mémoire collective et de l’histoire un témoignage sur les évènements, Aït Ahmed voulait rappeler à quel point la France coloniale était décidée à en découdre avec des Algériens désireux de porter pacifiquement leurs revendications. ‘’Il ne faut pas se demander comment ces événements de mai 1945 ont pu se produire mais, au contraire, comment auraient-ils pu ne pas se produire ?’’.
Le décor répressif était déjà planté bien avant l’enchaînement des évènements. Les journées tragiques de mai ‘’avaient été précédés, dès les lendemains du congrès des AML, d’une campagne d’hystérie totalitaire, d’appels à la répression prenant la forme d’appels au meurtre (…) On opère des milliers d’arrestations à travers tout le pays, en commençant évidemment par les leaders : Ferhat Abbas et le cheikh Bachir el-Ibrahimi sont jetés en prison. Messali, lui, avait déjà été déporté en Afrique équatoriale à la fin avril’’. Le jour même de la Victoire, ‘’les aspirations des Algériens ont été noyées dans un bain de sang, et ce dans l’indifférence totale des alliés, de l’« opinion mondiale » et de la « conscience universelle »’’.
En vérité, le militant fougueux de 19 ans n’est pas surpris outre-mesure par cet épisode sanglant, le énième du genre depuis 115 ans. Loin d’être nouvelle, ‘’cette guerre politique et psychologique (…) n’avait jamais cessé depuis les débuts de la domination coloniale en 1830’’. A la veille de gravir les échelons au sein des instances dirigeantes du PPA et de se voir confier des responsabilités lourdes, le jeune Hocine Aït Ahmed se livre à une première lecture à chaud de ce que l’Algérie et les Algériens viennent de vivre tout au long du mois sanglant. Plus rien ne sera comme avant ! Tel est le sentiment qui l’animait au sortir de cette Seconde Guerre mondiale, un sentiment, au demeurant, partagé par l’ensemble de ses pairs dirigeants du mouvement national. Ce sentiment en guise conclusion, il le remettra en perspective à l’heure de rédiger ce qui n’était que le tome 1 d’un exercice de Mémoires non achevé.
Le combattant en herbe de 1945 nourri déjà à ‘’l’esprit d’indépendance’’ dira, à l’aube des années quatre-vingt, ce que les historiens souligneront quelques années plus tard dans une moisson de livres et de travaux sur les journées sanglantes du Nord-Constantinois et des autres contrées du pays. ‘’La tragédie de Sétif, en traumatisant la conscience populaire, agira comme un lent révélateur. Une ligne de force émerge, qui va désormais guider et développer le sentiment national.
Le cœur des Algériens et des Algériennes s’emplit de colère et d’indignation (…) Le recours à la lutte armée entre dans la catégorie des possibles (…) Au lendemain de l’insurrection éteinte avant d’avoir commencé, nous autres, lycéens, sommes incapables de faire cette analyse, mais nous pouvons pressentir une certaine solidarité significative’’. Onze ans avant la grève des étudiants algériens du 19 mai 1956 et l’appel mémorable – « avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres » –, un étudiant-militant promis à des études réussies s’est décidé à tourner le dos à la vie du campus. Le ‘’mois tragique’’ et la ‘’semaine historique’’ l’ont poussé à trancher. Et irrémédiablement.
‘’En décrochant la première partie du bac, j’ai donné involontairement un faux espoir à mes parents, car avec Laïmèche, Ould Hamouda et Oussedik, nous avions décidé de toute façon décidé d’interrompre nos études. Nous nous trouvions devant quelque chose d’autrement exaltant et concret : le combat libérateur, qui force l’homme à composer avec le réel, à inventer des angles d’attaque. Mai 1945 avait ouvert une nouvelle étape historique à laquelle devaient correspondre des formes de lutte et d’organisation neuves’’
Armés par l’administration coloniale française pour lui r prêter main-forte dans la répression durant du 1er au 11 mai 1945, des prisonniers de guerre italiens et allemands internés dans la région de Sétif et Kherrata notamment retrouvent leur emploi, tuent femmes et enfants à la baïonnette, prennent leur revanche sur les tirailleurs algériens qui les avaient délogés de la bataille de Cassino en Italie en 1943.
.
The post Le 8 mai 1945 vécu et vu par Hocine Aït Ahmed appeared first on Le Jeune Indépendant.























































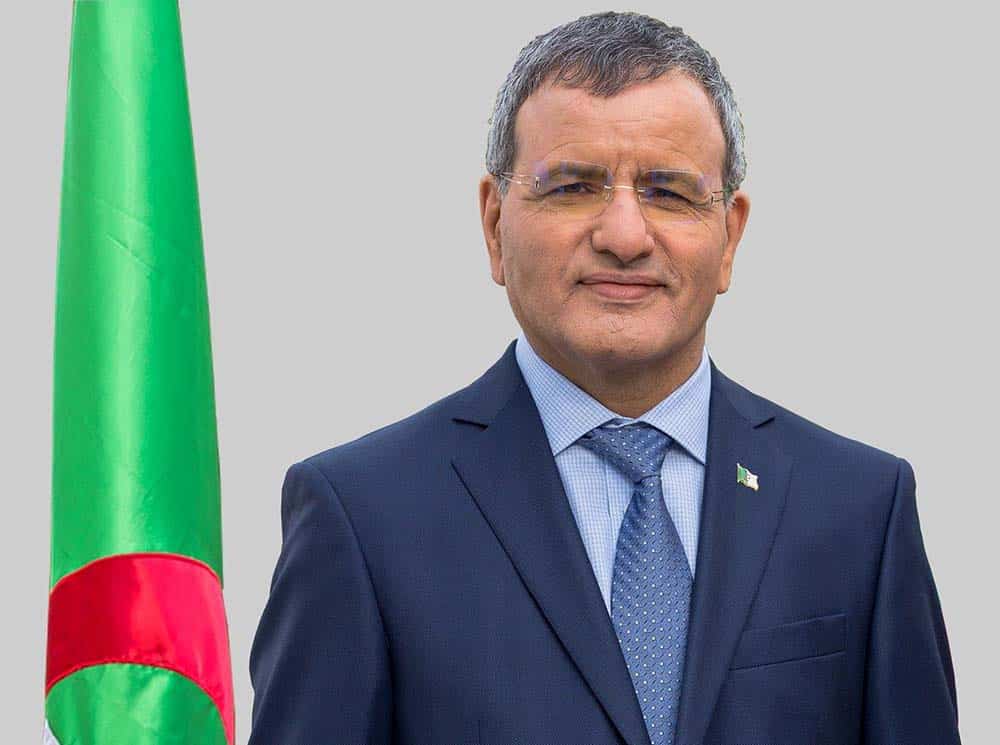













![[Photos] La SARM rend visite aux industries médico-chirurgicales.](https://www.santenews-dz.com/wp-content/uploads/2025/06/IMC5.jpg)