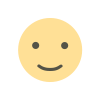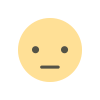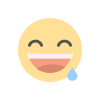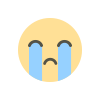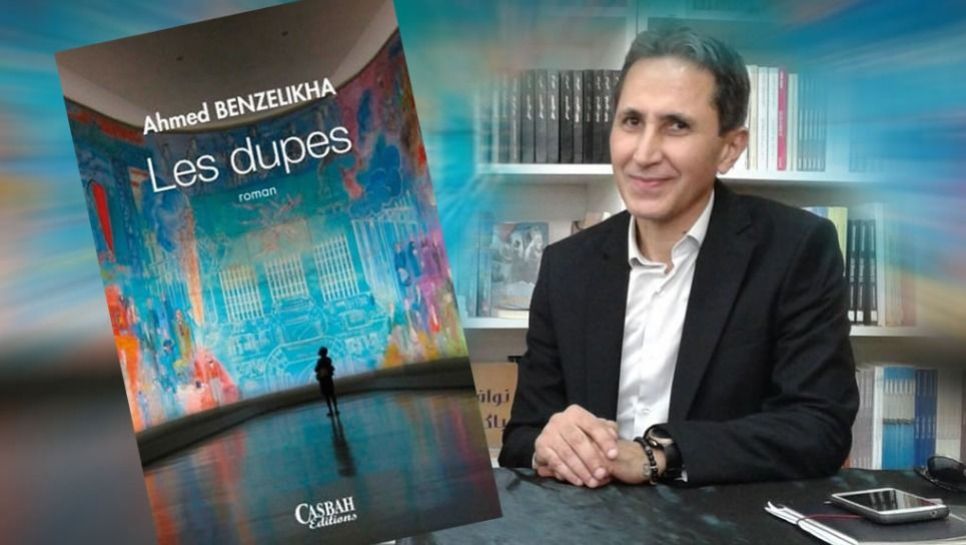Pourquoi il n’y a aucune différence entre une dictature et l’escroquerie baptisée démocratie
Une contribution de Khider Mesloub – La différence entre démocratie et dictature est une question de positionnement du «curseur gouvernemental normatif».... L’article Pourquoi il n’y a aucune différence entre une dictature et l’escroquerie baptisée démocratie est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Une contribution de Khider Mesloub – La différence entre démocratie et dictature est une question de positionnement du «curseur gouvernemental normatif».
Dans cette contribution, je vais introduire un nouveau paradigme pour démystifier la prétendue différence entre démocratie et dictature, démonter les mécanismes de cette escroquerie électorale baptisée démocratie.
Contrairement à une idée répandue, la différence entre démocratie et dictature n’est pas de nature. Elle est essentiellement de degré. D’étendue. Ou plus exactement de positionnement du «curseur gouvernemental normatif».
Le secret de la mystification démocratique se niche dans cette «variable» politique libérale qui peut revêtir plusieurs courants gravitant toujours autour de la même centralité gouvernementale dominée par le capital.
Pour rappel, en science, une variable est une lettre à laquelle on peut attribuer différentes valeurs. En algèbre, on tente de généraliser les calculs en remplaçant très souvent les nombres par des lettres. Ces lettres se nomment des variables. Une variable peut être représentée par n’importe quelle lettre de l’alphabet. En politique, dans une société capitaliste développée, le capital (la variable) peut être représenté par n’importe quelle formation bourgeoise de l’échiquier politique libéral qui s’étend de la gauche à la droite, en passant par le centre.
Si dans une dictature, en vigueur dans des pays tardivement intégrés dans le monde capitaliste, donc encore ancrés dans la phase de domination formelle, caractérisée par l’absence d’un capital hégémonique doté de moyens de conditionnement idéologique efficients aux pouvoirs de subjugation puissants, le curseur de la «normalité gouvernementale» (au sens de conforme à la norme gouvernementale et idéologique dominante) est positionné nulle part, ni au centre, ni à droite, ni à gauche de la gouvernance et de l’idéologie dominante du pouvoir, c’est-à-dire aucune dissidence n’est tolérée, ni agréée faute d’assurance étatique (la bourgeoisie manque de confiance en son pouvoir, faute de légitimité institutionnelle historiquement établie) et d’adhésion citoyenne (l’idéologie citoyenniste demeure encore embryonnaire dans ces Etats-nations fraîchement créés) ; en revanche, dans une démocratie marchande, en vigueur dans les pays capitalistes développés anciennement établis et pourvus d’une puissante industrie de conditionnement des esprits, le curseur de la «normalité gouvernementale» est fixé discrétionnairement au «centre politique libéral» avec, pour donner l’illusion d’une pluralité de courants politiques, une légère extension vers la droite et la gauche.
La dissidence, quant à elle, est repoussée au-delà de ces deux courants politiques droite et gauche. Pour désigner cette dissidence, l’Etat capitaliste démocratique emploie délibérément une terminologie dépréciative, disqualifiante, criminalisante. Des termes péjoratifs et effrayants, notamment «extrême», «extrémiste», «extrémisme». Bien évidemment, c’est la classe dominante (le capital) qui détermine la «centralité gouvernementale», fondée, il va de soi, sur le libéralisme, l’intangibilité de la propriété privée et du salariat.
En d’autres termes, en démocratie marchande, l’éligibilité réelle (et non fantasmée, incarnée par les lilliputiennes organisations politiques tolérées uniquement pour faire de la figuration, donc sans aucune chance d’accéder au pouvoir) aux instances législatives et, à plus forte raison, présidentielles, est agréée exclusivement pour les formations politiques gravitant autour du centre et s’étendant à la droite et la gauche de l’échiquier politique libéral, un échiquier politique sous l’emprise du capital.
Quoi qu’il en soit, c’est toujours l’état-major central du grand capital qui dicte le tempo et les thèmes de campagnes électorales. Entre un parti politique de droite, de gauche ou du centre, seule diffère la phraséologie. Tous trois défendent les intérêts du capital.
Si les candidats sont les porte-voix du capital, les électeurs sont sa caisse de résonance.
L’unique programme du concert électoral législatif et présidentiel est de faire jouer la même partition musicale électorale aux votants, celle que l’une ou l’autre des factions hégémoniques (gauche/droite, républicain/démocrate aux Etats-Unis) du capital veut entendre comme récital gouvernemental libéral, un récital joué sous la surveillance et le contrôle du chef d’orchestre muni de son gourdin en cas de fausse note élective : l’Etat policier capitaliste, cet Etat qui bat la mesure (abat sans mesure si besoin est) afin que les électeurs restent synchronisés sur le même tempo.
Cela étant dit, dans ce jeu de chaise musicale, quelle que soit la faction bourgeoise entrée en lice dans le concert électoral pour briguer le commandement du gouvernail exécutif ou législatif, le résultat n’aura aucune incidence sur la marche des affaires économiques, la domination de la bourgeoisie. Car une élection est une simple représentation théâtrale jouée par des bouffons politiciens, une représentation destinée à distraire politiquement le peuple.
Si dans une dictature, toute transformation économique est clairement exclue du fait de l’absence de toute participation électorale des citoyens à la gestion du pays ou participation électorale préalablement falsifiée, dans une démocratie, toute transformation économique est également exclue en dépit de la «participation électorale» des citoyens. Car les électeurs, tout comme les élus, n’ont aucune emprise sur les puissances d’argent, encore moins sur le développement du mode de production capitaliste et ses rapports de production commandés par des lois qui échappent à tout contrôle politique exécutif ou législatif.
De manière générale, dans les pays capitalistes prétendument démocratiques, l’activité politique est le fait du grand capital multinational. Et cette activité politique se matérialise sous la forme de partis politiques bourgeois (du centre, de gauche et de droite) représentant chacun une faction de la classe dominante nationale (la grande – la moyenne – la petite bourgeoisie), bras exécutif local, national et mondial du grand capital qui coordonne, lui, l’ensemble de la scène politicienne.
Si dans une dictature dénuée de tout «curseur gouvernemental normatif», toute transaction de marchandise politique est interdite, évitant ainsi aux citoyens toute déception ou indigestion électorale, dans une démocratie au curseur étendu, offrant une profusion de «marchandises politiques» différenciées uniquement par leurs emballages rhétoriques, ces marchandises aux programmes interchangeables sont vendues sans garantie de résultats, ni assurance de leur bon fonctionnement une fois installées au pouvoir contrôlé par le capital immuable. C’est ce qu’on pourrait qualifier d’escroquerie politique, d’imposture gouvernementale.
Encore une fois, comme je ne cesse de l’écrire et de le crier : si la démocratie permettait de changer le sort du peuple, elle serait interdite. La démocratie est la feuille de vigne derrière laquelle se dissimule la dictature du capital.
Dans les pays développés dits démocratiques encadrés par un «curseur gouvernemental normatif, au-delà de la droite et de la gauche, pour disqualifier, voire criminaliser tout courant ou parti politique dissident et antisystème, la bourgeoisie a créé, comme on l’a souligné plus haut, les vocables extrême, extrémiste, extrémisme».
La bourgeoise occidentale a délimité discrétionnairement la légitimité de la gouvernance dans un espace politique, fondé exclusivement sur le libéralisme et ses variantes idéologiques représentées par les partis de la droite et de la gauche du capital.
Au-delà de ses formations politiques légitimées par le capital, les autres partis sont qualifiés d’extrémistes. Un parti dissident ou antisystème est toujours catalogué d’extrémiste. L’emploi des termes extrême, extrémisme, extrémiste, outre le fait d’être péjoratif, induit, par le seul fait de leur énonciation, une réprobation morale, implique une disqualification politique, une condamnation électorale, une criminalisation potentielle, une proscription inéluctable, une incarcération possible.
Comme on l’observe aujourd’hui en France, avec le Rassemblement national et LFI, dorénavant lynchés, excommuniés, criminalisés par les tenants de la démocratie bourgeoise en crise, sous l’accusation d’extrémisme brandie pour les besoins de la cause : celle de la purgation de ces partis politiques jugés insuffisamment fiables pour la marche forcée vers la guerre décrétée par le capital national français.
Actuellement, en France, comme dans la majorité des pays (Israël et Russie), c’est la guerre qui dicte le tempo. C’est la guerre qui impose son programme politique meurtrier, son agenda économique militariste, son système de pensée chauviniste et caporaliste. Tous les partis qui n’adhèrent pas à ce projet de guerre seront proscrits. Tous les partis jugés complaisants avec l’ennemi actuel (Russie) interdits.
Dans la démocratie bourgeoise corsetée par le capital, si le peuple ne vote pas convenablement, on le refait voter (comme au Danemark à propos de Maastricht) ou on dissout carrément son vote, comme on l’observe actuellement en France avec la discrétionnaire décision du monarque Macron de refaire voter les citoyens car le score du RN ne convient pas à sa majesté le capital. Quoique la dissolution de l’Assemblée nationale soit motivée par des raisons plutôt géopolitiques, militaires, impérialistes. Et non politiciennes. La prochaine étape du dictateur Macron ou de son successeur déguisé en démocrate serait-elle, en cas de triomphe électoral du Rassemblement national, la dissolution du peuple français car il aura voté contre le gouvernement, en dehors du «curseur gouvernemental normatif» agréé ?
Cela confirme ce constat : en démocratie, le vote, c’est ce que concède le capital au vaincu pour qu’il accepte sa défaite sociale et militante : troquer le combat révolutionnaire contre les urnes mais, bien sûr, dans la dignité démocratique et marchande.
Dans les pays capitalistes développés dit démocratiques, si un électorat s’avise à relever la tête pour voter pour des candidats dissidents et antisystème, il est aussitôt accusé d’extrémiste. Il est ostracisé, excommunié. Autrement dit, ces électeurs antisystème sont considérés comme des pestiférés.
N’est-ce pas ce qu’on observe avec les électeurs du Rassemblement national et de LFI, traités comme des pestiférés parce qu’ils ont voté pour des candidats de leur choix ? Ainsi, l’Etat des riches tout comme les médias ne respectent pas la souveraineté du «peuple électeur frondeur».
Quand il ne participe pas aux mascarades électorales, le peuple est fustigé pour son abstentionnisme. Quand il se résout à voter pour des candidats dissidents ou antisystème, il est également fustigé. Quand il manifeste sa colère par la «révolte de rue», il est bastonné. Quand il exprime son mécontentement par la «révolte du vote», il est vilipendé.
Au vrai, dans les pays développés occidentaux, la démocratie s’arrête là où les intérêts du capital sont remis en cause. Si la dictature commence d’emblée là où se manifeste la volonté indiscutée des dirigeants, la démocratie, quant à elle, s’arrête là où se manifeste la volonté du peuple dissident ou antisystème. Là où les exigences d’une authentique démocratie populaire et autogestionnaire s’affirment.
Comme le reconnaît, du reste, la sociologue bourgeoise Dominique Schnapper qui, dans son interview accordée au journal Le Monde ce lundi 24 juin, rappelle explicitement le caractère de classe de la démocratie : «L’aspiration extrême à l’égalité peut mener à des formes d’égalitarisme qui gommerait les singularités et les distinctions constitutives de la condition humaine et de la vie sociale.» Ainsi, la condition humaine et la vie sociale ne peuvent, selon cette sociologue bourgeoise, être fondées que sur des rapports de classe inégalitaires, des distinctions sociales constitutives inviolables. Et l’aspiration à l’égalité sociale réelle et non pas formelle, portée par le peuple, est assimilée à de l’extrémisme, par cette apologue de la démocratie des riches. Selon cette intellectuelle bourgeoise, l’aspiration à la liberté réclamée par le peuple, c’est-à-dire son émancipation, ne peut qu’entraîner «des effets contraires à ses promesses».
C’est le fameux chantage de toutes les classes dominantes, notamment la bourgeoisie moderne : «C’est nous ou le chaos» ; «C’est la préservation de notre régime, sinon c’est la guerre civile» ; «C’est la défense inconditionnelle de notre civilisation (bourgeoise), sinon c’est la fin du monde». Les classes dominantes prennent toujours la fin de leur monde, bousculé et renversé par une classe révolutionnaire pour la fin du monde !
De là découle que la démocratie peut être définie comme un mode de gouvernance de l’entre-soi bourgeois élargi, dont le «curseur gouvernemental normatif» est positionné au centre et s’étend légèrement à la gauche et à la droite du capital. Au-delà, point de salut pour les «mauvais électeurs», les têtes brûlées de la dissidence électorale. La dictature démocratique s’abat sur leur tête, abat leur naïve prétention à s’imposer par les élections, à imposer leur volonté politique par le suffrage. C’est la ligne rouge à ne pas franchir.
Dans une dictature, la ligne rouge est inscrite visiblement sur tous les frontons des édifices de l’espace public et le front des tyranniques dirigeants. Dans une démocratie, la ligne rouge se dissémine sur le bitume de toutes les agglomérations et se dissimule sous les bâtons des forces de police, l’authentique figure des démocrates. Dans la première, tracés par la visible ligne rouge, les citoyens ravalent spontanément leur salive. Dans la seconde, ils s’égosillent spectaculairement sur le bitume protégé par des escadrons de CRS. Contrairement à une idée répandue, la police œuvre et sévit plus massivement dans une démocratie que dans une dictature.
Si je devais devenir policier, je préférerais exercer le métier dans une dictature : il y a moins de voyous à écrouer et de manifestations permanentes à réprimer. Etre policier dans une dictature est une sinécure. En France, pays «démocratique», les policiers se suicident plus que toutes les autres catégories socioprofessionnelles. Et pour cause. Ils passent leur temps à réprimer la délinquance chronique et les manifestations sociales et politiques.
La dictature est fondée sur l’interdiction, donc nul besoin de répression. La démocratie, sur la répression permanente, faute d’interdiction. Cela revient au même. C’est, encore une fois, une question de curseur. Avec la dictature, l’interdit est fixé en amont, donc la répression virtuelle dissuasive agit à plein régime. Avec la démocratie, la répression réelle sévit en aval, faute d’interdit.
«L’hypocrisie fait les amis, la franchise engendre la haine», a écrit Bernard Weber. En matière de gouvernance : l’hypocrisie démocratique s’attire l’amabilité, la franchise dictatoriale suscite l’hostilité. La gouvernance démocratique bourgeoise ? La plus tolérable des hypocrisies.
L’humoriste Coluche avait parfaitement bien saisi l’imposture de la bipartition du système politique entre démocratie et dictature. C’est à lui qu’on doit cette définition proférée en forme de boutade : «La dictature, c’est ferme ta gueule ; et la démocratie, c’est cause toujours»… sur le bitume, sous des banderoles, dans un meeting. Et si tu franchis la ligne rouge de la revendication, contestation, la répression se chargera de te rappeler qu’en démocratie la liberté du peuple s’arrête là où commencent les intérêts de la bourgeoisie.
Mon ami Robert Bibeau, auteur du livre La Démocratie aux Etats-Unis. Les mascarades électorales, directeur du webmagazine Les 7 du Québec.com, a donné une belle définition de l’imposture de la démocratie.
Dans une interview il déclarait : «La démocratie représente le bon policier qui nous incite à nous mettre à la table de la collaboration de classe pour que le prolétariat, la classe sans pouvoir économique, politique et idéologique, n’ayant que sa force de travail à vendre pour survivre, se compromette et remette son sort entre les mains de politiciens véreux, tous semblables. Si jamais l’un d’entre eux souhaitait défendre la classe ouvrière, il ne serait jamais élu ou il serait abattu. La dictature, c’est le mauvais policier qui réprimerait durement si on ne jouait pas docilement le jeu de la démocratie électorale, jeu où un simple ouvrier n’a aucune chance de l’emporter face à un gang de riches.»
K. M.
L’article Pourquoi il n’y a aucune différence entre une dictature et l’escroquerie baptisée démocratie est apparu en premier sur Algérie Patriotique.
Quelle est votre réaction ?