Une semaine critique pour un accord en Ukraine
Rien que ces derniers jours, l’administration Trump s’est montrée d’abord pessimiste quant à l’issue de sa médiation dans le conflit en Ukraine, ensuite optimiste, avec son chef annonçant un accord dans les tout prochains jours, et puis la voilà qui redevient pessimiste, avec Marco Rubio disant que le président américain décidera cette semaine si les […]

Rien que ces derniers jours, l’administration Trump s’est montrée d’abord pessimiste quant à l’issue de sa médiation dans le conflit en Ukraine, ensuite optimiste, avec son chef annonçant un accord dans les tout prochains jours, et puis la voilà qui redevient pessimiste, avec Marco Rubio disant que le président américain décidera cette semaine si les Etats-Unis doivent ou persévérer dans leurs efforts. Avant lui, c’était Donald Trump qui dans un post évoquait la possibilité que la Russie ne soit pas intéressée par un arrêt de la guerre. Notons tout de même au passage que les Etats-Unis continuent de se donner pour de simples médiateurs, se situant comme tels à égale distance des belligérants, alors qu’il n’y a pas si longtemps Rubio affirmait que cette guerre était en réalité une guerre par procuration entre les Etats-Unis et la Russie. Du moins l’administration Trump a-t-elle un plan de paix, qui vaut ce qu’il vaut mais qui a le double mérite d’exister et de ne pas déplaire entièrement à la Russie. Celle-ci s’en contenterait à défaut de mieux, et eu égard au fait qu’il sera garanti par son initiateur, c’est-à-dire les Etats-Unis.
Pour elle ce serait comme si elle signait un accord de paix avec ces derniers, non avec l’Ukraine. Contrairement aux apparences, les Européens » » volontaires » comme ils se définissent eux-mêmes, en gros la France, la Grande-Bretagne, et l’Allemagne, si on laisse de côté les pays voisins de la Russie, n’ont pas de plan alternatif. S’ils avaient voix au chapitre, ils voudraient ajouter une seule clause absente dans le plan américain, tel du moins que celui-ci se dessine sur la base des fuites dans les médias, une clause de garantie d’ailleurs, incarnée dans ce qu’ils appellent l’armée de réassurance. En clair, ils veulent convaincre les Américains de la nécessité d’envoyer une armée en Ukraine dont la véritable mission n’est pas de s’interposer mais de dissuader la Russie d’attaquer à nouveau. Comme ils ont fait leur deuil d’une participation américaine dans cette force de dissuasion, appelée par eux force de réassurance, ils ne demandent plus à l’administration Trump que d’en accepter le principe, et le moment venu son déploiement, c’est-à-dire dès la signature de l’accord en gestation. Cet objectif est inatteignable, tout simplement parce que la Russie ne voudrait jamais d’une telle force sur le sol ukrainien. Si elle a envahi l’Ukraine, il y a trois ans, pour empêcher l’Otan de s’y installer, ce n’est pas pour accepter ensuite que ce même Otan soit à ses frontières sous un autre visage, sous une autre appellation. Les Européens pensent que cet accord, pour autant bien sûr qu’il voie le jour, n’est pas un accord de paix mais juste un accord de cessez-le-feu, un armistice, susceptible de voler en éclats dès le départ de l’administration américaine actuelle. Le problème, c’est qu’il faut attendre d’ici à ce que cela se produise un peu moins de quatre ans, une période au cours de laquelle il coulera beaucoup d’eau dans le Dniepr. Tout peu arriver, y compris le pire, c’est-à-dire du point de vue des » volontaires » partisans d’une force de réassurance, la chute de Zelensky, ce qui constitue le dernier des soucis de l’administration Trump.























































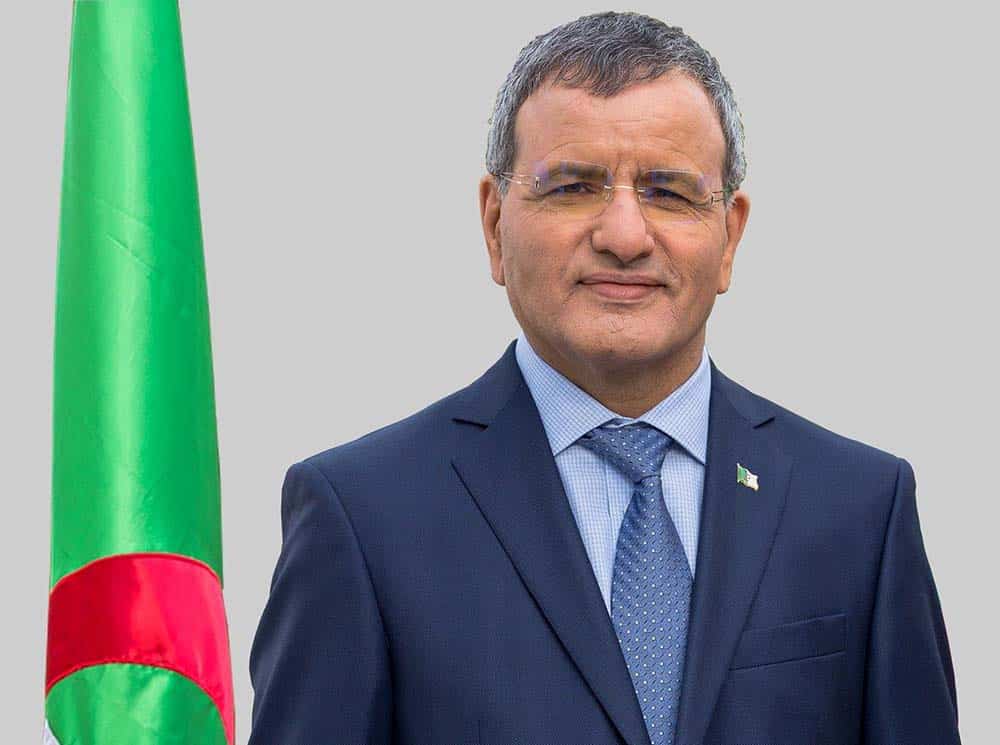













![[Photos] La SARM rend visite aux industries médico-chirurgicales.](https://www.santenews-dz.com/wp-content/uploads/2025/06/IMC5.jpg)














































