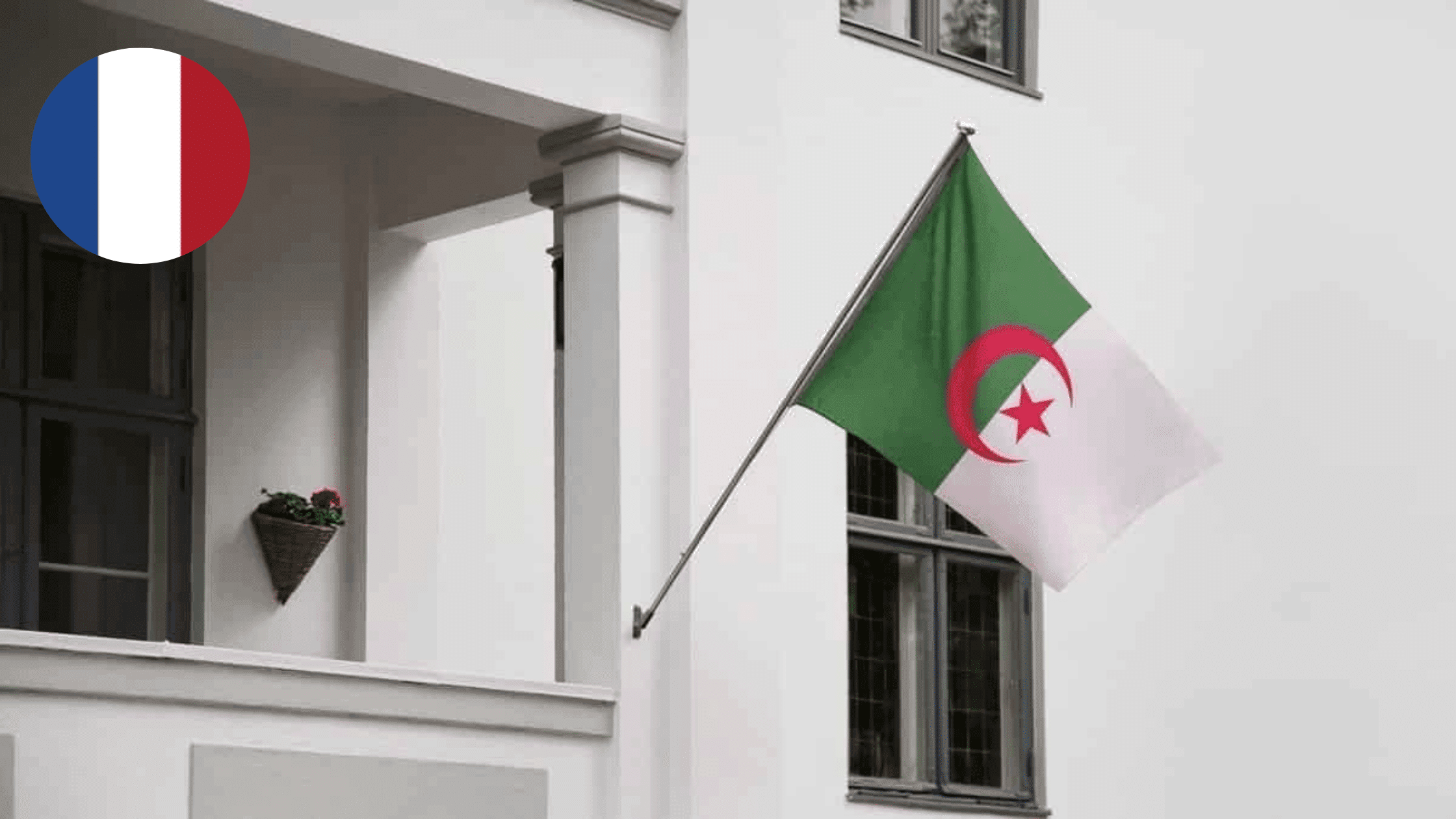L’arme invisible
Par Mohamed El-Maadi – La posture de l’Algérie comme pôle de souveraineté affirmée, loin de la protéger, en fait surtout une cible : non plus par des armes visibles, mais par des moyens insidieux et diffus. L’article L’arme invisible est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Par Mohamed El-Maadi – A l’heure où le monde se recompose sous les coups de boutoir des crises économiques, climatiques et sécuritaires, l’Algérie émerge comme un pôle de stabilité relatif, de souveraineté affirmée et de reconstruction silencieuse mais déterminée. Cette posture, loin de la protéger, en fait une cible : non plus par des armes visibles, mais par des moyens invisibles, insidieux et diffus.
L’époque des conquêtes coloniales classiques est révolue. Désormais, les offensives s’opèrent par le biais de flux humains incontrôlés, de naturalisations opportunistes, de noyautages culturels et économiques. L’ennemi ne vient plus du dehors, il s’installe à l’intérieur, s’acclimate, tisse des réseaux, puis réclame des droits avant même d’assumer des devoirs.
La question migratoire n’est donc pas qu’une affaire humanitaire ou administrative. Elle est une question de souveraineté, de survie historique et de continuité civilisationnelle. Face à cette nouvelle donne, l’Algérie ne peut plus se permettre l’angélisme ou l’aveuglement.
Le continent africain s’apprête à connaître un bouleversement sans précédent. D’ici 2050, il comptera près de 2,5 milliards d’habitants. Dans certains pays sahéliens, la moitié de la population aura moins de 18 ans. La pression migratoire qui en découle est colossale, inédite et déjà palpable.
L’Europe, quant à elle, a fermé ses portes. Les murs se dressent, les bateaux sont repoussés, les frontières extérieures militarisées. Dans ce contexte, l’Algérie devient mécaniquement une destination de repli, voire un objectif stratégique.
Les récits circulent, notamment dans les forums de jeunes Africains : «L’Europe est finie, l’Algérie est la nouvelle porte». On y décrit Alger comme une capitale accessible, Oran comme une ville hospitalière, le Sud algérien comme une terre de transit où il est facile de disparaître.
Ce ne sont plus quelques centaines, mais plusieurs milliers de clandestins qui vivent aujourd’hui en Algérie, souvent en toute impunité, parfois avec la complicité de réseaux mafieux organisés. Loin d’être un phénomène accidentel, cette présence devient une constante, un fait social, voire une stratégie.
Les mariages mixtes servent souvent de cheval de Troie. La régularisation par alliance ne répond pas à un projet d’intégration mais à une logique d’appropriation. Ce phénomène est aggravé par un laxisme hérité d’une époque où l’Etat fermait les yeux, préférant l’image flatteuse d’une Algérie accueillante plutôt qu’un contrôle rigoureux des flux.
Le cas des clandestins marocains doit être traité à part. Il ne s’agit plus ici de misère ou d’exode, mais d’un projet délibéré et hostile. Depuis des années, l’infiltration économique marocaine en Algérie a été documentée. Une étude de la Chambre de commerce au début des années 2010 avait révélé que le nombre d’entreprises enregistrées par des ressortissants marocains était le plus élevé parmi les étrangers, notamment dans les régions frontalières et commerciales.
Cela ne relevait pas du hasard. Ce que le Maroc n’a pu obtenir par la force – notamment lors de la guerre des Sables et d’Amgala –, il tente aujourd’hui de l’obtenir par la ruse économique et l’installation progressive.
Le slogan «khawa khawa», qui servait à masquer les tensions, n’a jamais été partagé sincèrement par un royaume qui nourrit, structurellement, une haine anti-algérienne dans ses manuels scolaires, ses séries télévisées, sa diplomatie et même sa diaspora.
La normalisation entre Rabat et Tel-Aviv est venue ajouter un facteur de risque inédit. En scellant un pacte sécuritaire avec Israël, le royaume marocain ne fait pas qu’un choix diplomatique, il s’aligne stratégiquement avec un Etat qui a historiquement combattu les souverainetés arabes et qui maîtrise l’ingénierie du contrôle intérieur.
Dans ce nouveau paradigme, l’infiltration migratoire peut devenir un relais du renseignement, un vecteur d’instabilité, voire un outil de manipulation sociale. Certains agents naturalisés ou installés ont déjà été impliqués dans des affaires d’espionnage.
Il serait naïf de croire que la population marocaine, élevée dès l’école à mépriser l’Algérie, pourrait servir de force modératrice. Le ressentiment territorial, le mythe du «Grand Maroc» et la frustration diplomatique font d’une partie de cette population une caisse de résonance de la propagande du Makhzen.
L’immigration n’est plus seulement une conséquence, elle est devenue un instrument politique au service d’un projet globaliste. Celui de la dilution des peuples dans une masse indistincte, gérable, déracinée, sans mémoire ni résistance.
Ce «citoyen universel», sans histoire propre, sans culture, sans passé glorieux, devient la figure idéale pour les architectes d’un monde unipolaire. A l’inverse, les peuples fiers de leur histoire, attachés à leur langue, à leurs martyrs, à leur indépendance, deviennent des obstacles à abattre.
Le véritable objectif n’est donc pas seulement économique, il est ontologique. Rendre un peuple méconnaissable à lui-même, l’éparpiller dans des identités secondaires, le rendre suspect s’il revendique son algérianité.
Il ne s’agit pas de rejeter l’autre, mais de défendre le soi. L’Algérie ne peut pas rester passive devant un phénomène qui vise, à terme, sa transformation interne.
Les outils existent : réforme du code de la nationalité, encadrement strict des régularisations, audit de la population étrangère, coopération sécuritaire, suivi des flux économiques suspects, refonte du discours officiel sur la fraternité africaine.
La solidarité ne peut se faire au prix de la disparition. L’humanisme n’est pas le suicide.
Ce qui se joue aujourd’hui, ce n’est pas un simple problème de frontière ou de statut. C’est une guerre d’usure civilisationnelle. L’Algérie, qui n’a pas été vaincue militairement, risque d’être affaiblie de l’intérieur si elle ne pose pas, dès aujourd’hui, les fondations d’une doctrine de souveraineté démographique.
Car le plus grand danger n’est pas l’envahisseur déclaré, mais le passager clandestin devenu électeur, commerçant, relais et bientôt acteur politique.
L’histoire nous enseigne que les civilisations ne meurent pas toujours dans le fracas des armes. Elles meurent souvent dans le brouhaha de l’oubli de soi.
M. E.-M.
L’article L’arme invisible est apparu en premier sur Algérie Patriotique.