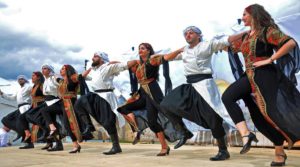L’Algérie renforce son bannissement total des cryptomonnaies
L’Algérie et le Maroc restent les deux seuls pays africains à bannir totalement les cryptomonnaies, une position qui les place aux côtés de cinq autres pays dans le monde, dont la Chine et l’Égypte. L’Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre les cryptomonnaies. Avec la publication au Journal officiel n° 48 de […]

L’Algérie et le Maroc restent les deux seuls pays africains à bannir totalement les cryptomonnaies, une position qui les place aux côtés de cinq autres pays dans le monde, dont la Chine et l’Égypte.
L’Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre les cryptomonnaies. Avec la publication au Journal officiel n° 48 de la loi n° 2510 du 24 juillet 2025, le pays durcit une interdiction déjà en vigueur depuis 2018 et l’étend désormais à toutes les activités liées aux actifs numériques.
Alger fait ainsi le choix de se placer parmi les pays les plus restrictifs au monde, à l’image du Maroc, de la Chine, du Bangladesh, de l’Égypte ou de la Bolivie.
La nouvelle loi prohibe l’émission, la commercialisation, l’usage comme moyen de paiement ou d’investissement, la promotion, ainsi que la création ou l’exploitation de plateformes d’échange de cryptomonnaies.
Même le minage, activité qui consiste à valider des transactions sur un réseau blockchain, devient une infraction. Les contrevenants s’exposent à des peines allant jusqu’à un an de prison et à des amendes comprises entre 200 000 et 1 000 000 DA, selon les nouvelles dispositions de l’article 31 bis.
Ce durcissement vient renforcer l’article 117 de la loi de finances 2018, qui interdisait déjà l’achat, la vente, la détention et l’utilisation de monnaies virtuelles sur le territoire national.
Une position radicale en Afrique
L’Algérie rejoint ainsi un cercle très restreint de pays ayant opté pour un bannissement total des cryptomonnaies. À ses côtés : le Maroc, dont l’Office des changes considère depuis 2017 les transactions en monnaies virtuelles comme illégales. Quelques autres pays africains comme le Burundi ou le Nigeria appliquent également une réglementation extrêmement restrictive.
Ailleurs sur le continent, la tendance est pourtant inverse : de nombreux pays, à l’image de l’Afrique du Sud, travaillent à l’élaboration de cadres réglementaires destinés à sécuriser et encadrer l’usage de ces technologies financières.
À contre-courant des standards internationaux
Ce choix va également à rebours des recommandations internationales. Ni l’OCDE, ni l’Union européenne, ni le GAFI (Groupe d’action financière) ne prônent une interdiction totale. Ces organisations privilégient plutôt la régulation et la transparence : lutte contre le blanchiment, obligations de connaissance client, suivi des flux et encadrement fiscal.
L’Union européenne a d’ailleurs adopté le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), qui encadre mais n’interdit pas les actifs numériques.
Une minorité de nations en rupture
À l’échelle mondiale, la majorité des pays s’efforcent de mettre en place des réglementations permettant d’intégrer les cryptomonnaies tout en maîtrisant les risques. Mais une poignée de juridictions a choisi le bannissement pur et simple.
Parmi elles : la Chine, qui a progressivement interdit toutes les transactions et le minage de cryptomonnaies en misant sur son yuan numérique ; la Bolivie, avec une interdiction complète de toute monnaie non régulée par l’État ; le Bangladesh, où les utilisateurs s’exposent à des poursuites ; ainsi que l’Égypte et le Népal, qui maintiennent des interdictions strictes.
Une même logique pour les devises
La même logique restrictive s’étend désormais aux devises : depuis la récente modification du règlement de la Banque d’Algérie, le plafond de devises autorisé à la sortie du territoire est désormais limité à 7 500 € par an, tous déplacements confondus.
Un changement de taille : auparavant, ce montant s’appliquait à chaque voyage. Officiellement, cette mesure viserait à lutter contre le blanchiment, conformément aux recommandations du GAFI.
Pourtant, dans l’Union européenne, il est permis de voyager avec jusqu’à 10 000 € par personne et par trajet sans déclaration.
En Tunisie, ce plafond est fixé à 5 000 € sans déclaration et jusqu’à 25 000 € avec déclaration, et par voyage. Au Maroc, il atteint 10 000 € par voyage.
L’Algérie fait donc figure d’exception en optant pour une restriction annuelle. Une politique qui s’explique sans doute par une volonté de préserver les réserves de change, d’autant que les avoirs en devises déposés par les particuliers dans les banques algériennes sont inclus dans leur calcul.
Limiter les retraits ou la sortie physique de ces montants permet ainsi de contenir l’érosion de ces réserves, dans un contexte où la balance des paiements reste déficitaire.
Interdire plutôt que contrôler
Pour rappel, lors de la présentation du projet de loi au Parlement, l’exposé des motifs a mis en avant la nécessité d’adapter le cadre juridique aux recommandations internationales afin de lutter contre le blanchiment et de protéger le système monétaire national.
Mais aucune instance n’a jamais exigé une interdiction totale ; ailleurs, on encadre, on régule. L’Algérie, elle, a choisi la voie la plus radicale : interdire plutôt qu’apprendre à contrôler.
Par Larbi Ghazala