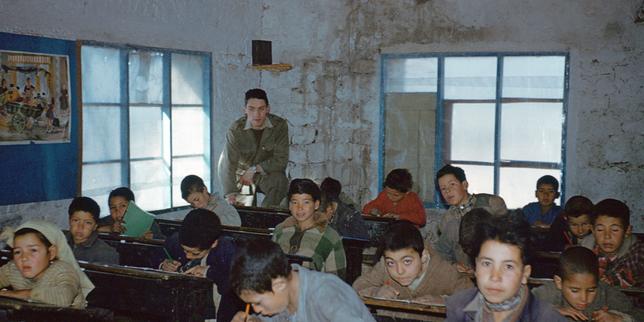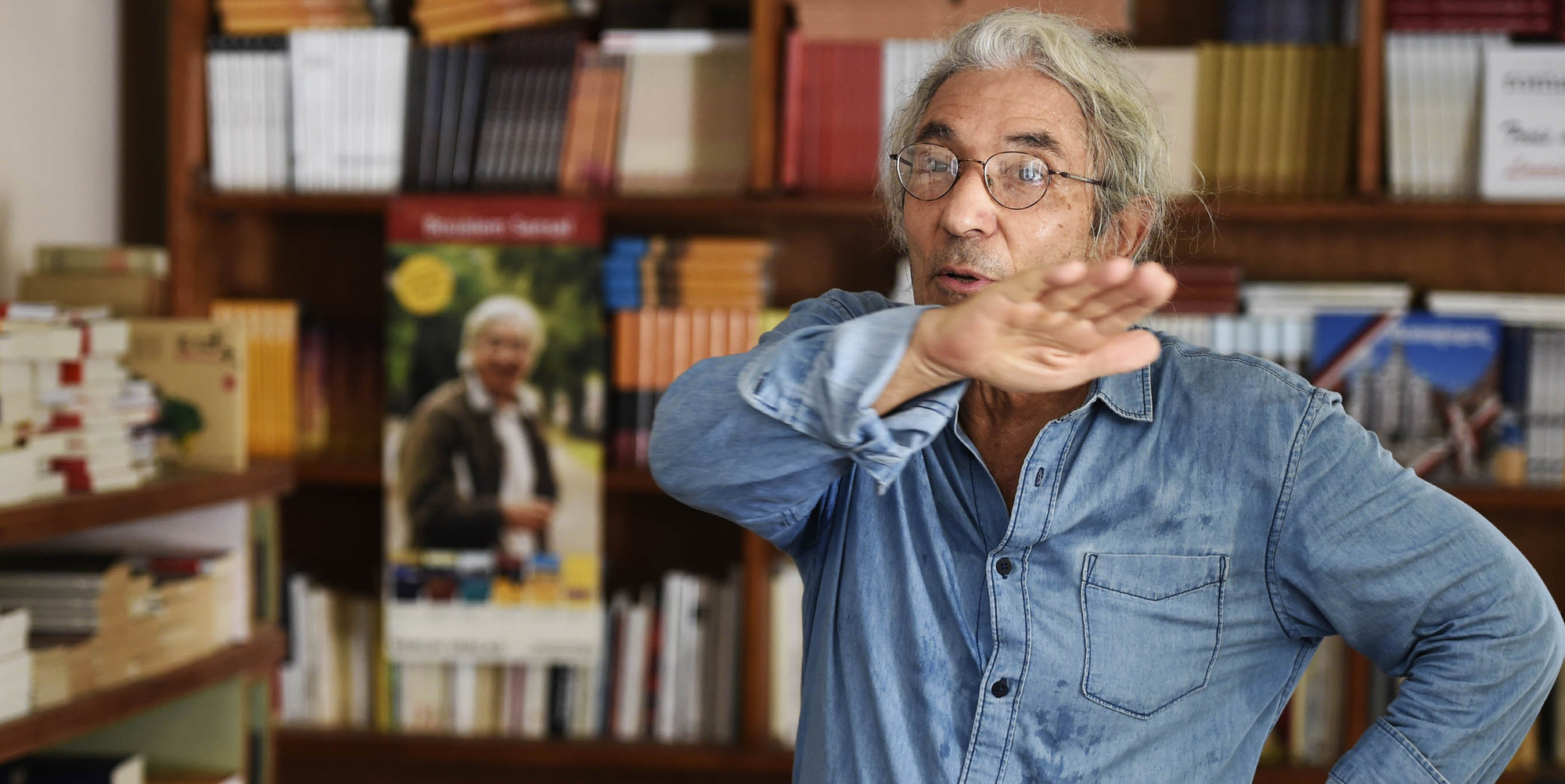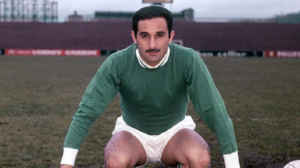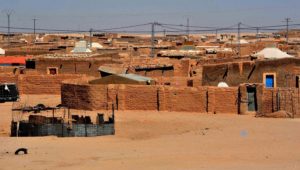Farida Saffidine: Des voix féminines aux résonances universelles
Née à Bordj Bou Arréridj, formée au lycée Malika-Gaïd de Sétif, puis à l’université de Constantine où elle étudia la langue et la littérature anglaises, Farida Saffidine s’est installée à Sétif dès 1980 pour y enseigner au département des langues étrangères de l’université Ferhat-Abbas. Devenue écrivaine après une longue carrière universitaire, elle a choisi de […]

Née à Bordj Bou Arréridj, formée au lycée Malika-Gaïd de Sétif, puis à l’université de Constantine où elle étudia la langue et la littérature anglaises, Farida Saffidine s’est installée à Sétif dès 1980 pour y enseigner au département des langues étrangères de l’université Ferhat-Abbas. Devenue écrivaine après une longue carrière universitaire, elle a choisi de consacrer sa plume à un sujet aussi intime qu’universel : la condition des femmes en Algérie. Trois ouvrages jalonnent aujourd’hui son parcours littéraire, trois jalons d’une même quête : rendre audibles les voix longtemps étouffées.
Son premier roman, «Voix de femmes, voies de fait» (Éditions El Ibriz, 2018), s’impose comme un texte fondateur. À travers le destin d’une famille algérienne de
l’après-indépendance, l’auteure déploie le récit de trois générations de femmes prisonnières de traditions séculaires, soumises aux diktats d’un patriarcat relayé parfois par les mères, les grands-mères ou les belles-mères elles-mêmes. Le roman dénonce avec une rare lucidité la transmission insidieuse de la domination masculine, décrivant des femmes réduites au silence, aux tâches domestiques et à la reproduction, tout en portant en elles ces «voix intérieures» que la société attribue au diable. Hymne à l’égalité des sexes, le livre met en lumière une réalité encore trop actuelle : celle d’une citoyenneté des femmes inscrite dans les lois, mais trop rarement vécue dans les mentalités.
Dans la foulée de ce premier coup d’éclat littéraire, Farida Saffidine publie un recueil de poèmes, «Aime-moi», où se dévoile une autre facette de son écriture : plus intimiste, plus incandescente. Ici, l’auteure s’affranchit du roman familial pour plonger dans l’expression lyrique des émotions. L’amour y apparaît tour à tour comme un élan vital, un refuge, mais aussi une lutte contre la solitude et l’injustice. Ces poèmes, dans leur simplicité touchante, prolongent son engagement : affirmer la sensibilité féminine comme une force, et non comme une faiblesse.
Son second roman, «La robe blanche de Barkahoum» (Éditions Casbah, 2021), confirme la constance de ses thématiques tout en ouvrant de nouvelles pistes. Barkahoum, médecin célibataire au tempérament bien trempé, devient le miroir d’une société où les femmes indépendantes continuent de susciter suspicion et rejet. À travers ce personnage, Farida Saffidine interroge les mentalités, mais aussi les dysfonctionnements d’un système de santé en crise, révélant les failles d’un secteur où la médecine peine à répondre aux attentes des malades. Avec un réalisme implacable, l’auteure dénonce la violence symbolique et physique qui persiste encore contre les femmes, tout en inscrivant sa réflexion dans une perspective plus large, où l’égalité de genre est indissociable du développement social.
Ces trois œuvres, différentes par leur forme mais unies par leur souffle, composent une fresque au féminin qui dépasse largement les frontières algériennes. Dans «Voix de femmes, voies de fait», «Aime-moi» et «La robe blanche de Barkahoum», Farida Saffidine pose la même exigence : reconnaître la femme comme un être humain à part entière, ni inférieure, ni soumise, mais actrice de sa propre vie et partenaire essentielle dans la construction de la société. À travers ses écrits, elle rappelle avec force que le sexisme est un racisme de genre, et que les véritables révolutions ne s’accomplissent pas seulement dans les lois, mais dans les mentalités. Ses livres, au croisement du témoignage, de la fiction et de la poésie, constituent un héritage littéraire et citoyen, une invitation à écouter ces voix que l’on voulait taire et qui, grâce à la plume de Farida Saffidine, trouvent enfin écho.
Hafit Z.