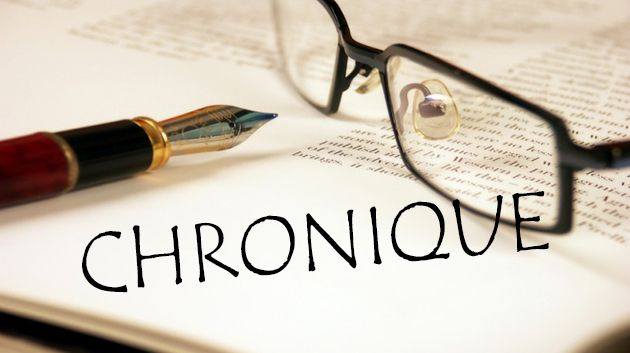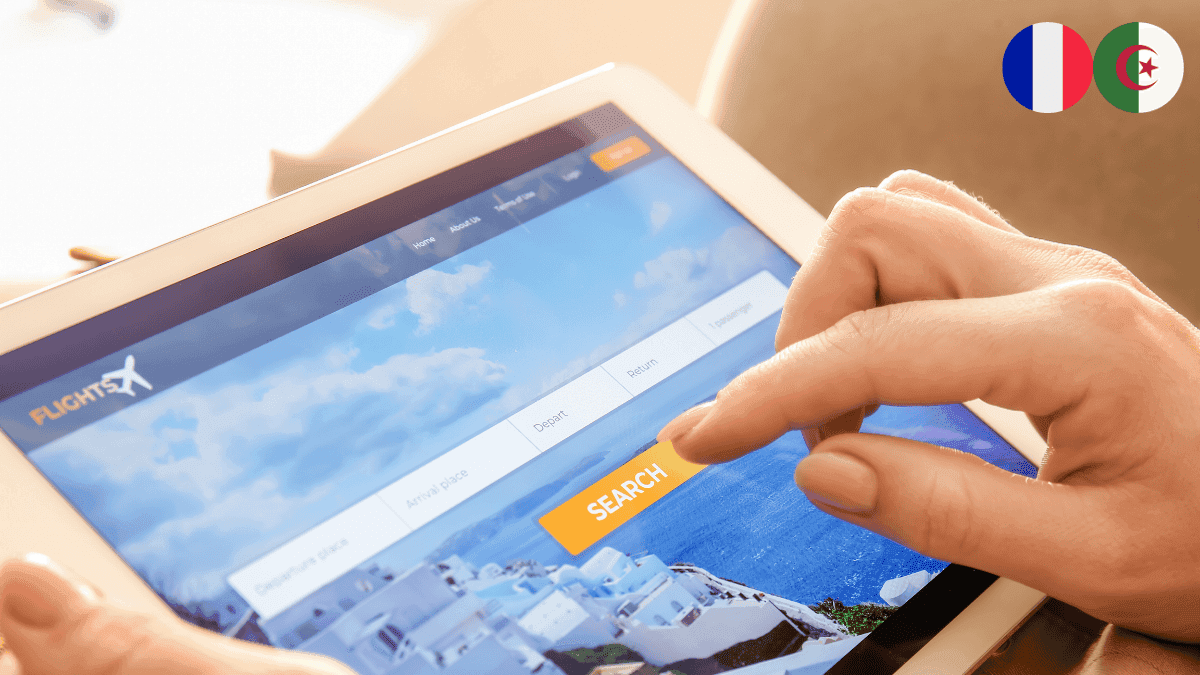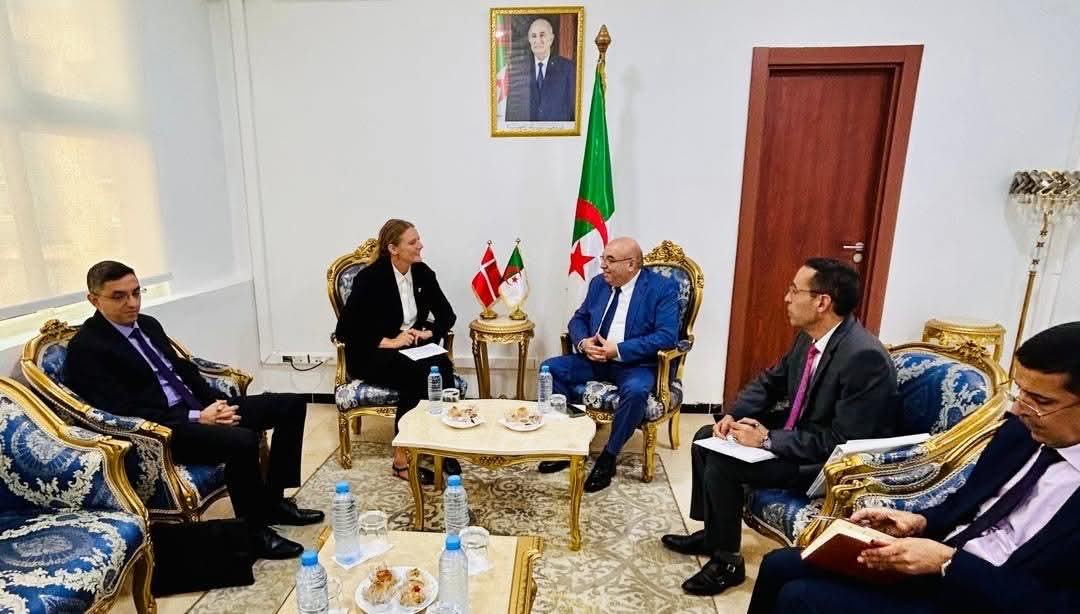Trump, Poutine et l’avenir des relations transatlantiques: Les Européens à la dérive
Le pragmatisme mercantile du président américain Donald Trump et son rapport particulier avec la Russie et son président Vladimir Poutine sont un marqueur essentiel du devenir des relations américano-russes mais surtout de l’avenir stratégique du couple Etats-Unis – Union européenne. Les derniers développements sur le front ukrainien et la vassalisation de l’Europe par Washington à […] The post Trump, Poutine et l’avenir des relations transatlantiques: Les Européens à la dérive appeared first on Le Jeune Indépendant.

Le pragmatisme mercantile du président américain Donald Trump et son rapport particulier avec la Russie et son président Vladimir Poutine sont un marqueur essentiel du devenir des relations américano-russes mais surtout de l’avenir stratégique du couple Etats-Unis – Union européenne.
Les derniers développements sur le front ukrainien et la vassalisation de l’Europe par Washington à la faveur de l’accord inégal imposé par Trump ne finissent pas de jeter dans l’inconnu les relations euro-américaines.
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), l’un des principaux think tanks français spécialisés dans les questions géopolitiques et stratégiques, résume la posture prise par Trump depuis son retour à la Maison blanche. Dans son article intitulé « Etats-Unis – Europe : nos routes se séparent », le directeur adjoint de l’IRIS, Jean-Pierre Maulny écrit « Il était prévisible et l’Europe y était mal préparée, l’appel téléphonique de Donald Trump à Vladimir Poutine a sans aucun doute mis fin à 75 ans de relations transatlantiques ».
Pour cet analyste, l’histoire l’a démontré, les intérêts de sécurité de la France avec les États-Unis n’étaient pas toujours alignés et que ces divergences pouvaient conduire à de graves différends. « Il y a eu le canal de Suez en 1956, l’Irak en 2003 et, plus modérément, le brain dead (mort cérébrale de l’Otan, ndlr) de Macron », écrit Jean-Pierre Maulny.
Aujourd’hui, le risque est désormais clair : une forme d’accord bilatéral entre les États-Unis et la Russie, bénéficiant aux intérêts des deux pays, pourrait affaiblir gravement l’Ukraine, affaiblissant ainsi par conséquent les autres pays européens. L’UE serait le plus grand perdant d’un modus vivendi entre Washington et Moscou. Bruxelles qui dépendait du parapluie américain a lancé un débat sur la substitution de cette protection stratégique qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale par une forme de dissuasion hybride franco-britannique, avec en toile de fond l’équation ukrainienne.
Toujours selon Jean-Pierre Maulny, « cette situation placera les Européens devant un terrible dilemme : soit ils ne souhaitent pas donner de garanties de sécurité à l’Ukraine et se discréditeront complètement aux yeux de puissances telles que les États-Unis, la Russie et la Chine, car les Européens auront montré qu’ils sont incapables de défendre le continent, tout en créant un risque important à long terme pour la sécurité de l’Europe. Soit ils fournissent des garanties de sécurité à l’Ukraine, acceptant le coût d’un fardeau financier qui affectera la compétitivité de l’Union européenne à long terme ».
Un découplage historique
Même pessimisme chez le chercheur chinois, Guo Bingyun. Professeur associé à l’Université d’études internationales du Sichuan, il mentionne dans l’un de ses articles que les relations entre les États-Unis et l’Europe se désintègrent. De plus, l’histoire a prouvé que « la séparation des États-Unis et de leurs alliés n’est pas une nouvelle ». Par exemple, les États-Unis « ont abandonné les Kurdes combattant l’État islamique (DAECH, ndlr) ou ont retiré leurs troupes de manière indépendante et ont permis aux talibans de reprendre le contrôle de l’Afghanistan », de sorte que les États-Unis pourraient bien mettre l’Europe de côté cette fois-ci.
Les références historiques sont importantes pour comprendre le monde d’aujourd’hui, mais surtout le devenir des relations internationales. La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué la conclusion de l’illustre période historique de l’Europe qui a commencé avec l’ère des grandes découvertes. Comme l’a écrit Henry Kissinger dans son ouvrage « L’Ordre mondial », « la capacité matérielle et psychologique de l’Europe à organiser le monde avait pratiquement disparu ». L’Europe, qui venait d’échapper aux griffes de la tyrannie nazie, était désormais confrontée à la menace d’un nouveau régime hégémonique. La menace idéologique et géopolitique soviétique a contraint l’Europe à soutenir les États-Unis dans la rivalité américano-soviétique.
Après la guerre froide, la plus grande rupture dans les relations entre les États-Unis et l’Europe s’est produite en 2003, lorsque les États-Unis ont lancé la guerre en Irak. En 2004, l’UE a connu sa plus grande expansion en termes de membres, avec l’adhésion de 10 anciens pays socialistes et républiques soviétiques comme la Pologne, la Tchéquie et les trois États baltes. L’augmentation soudaine de la population et de la taille économique de l’UE a une fois de plus menacé l’hégémonie du dollar.
Le 20 mars 2003, après avoir falsifié des preuves, les États-Unis ont allégué que l’Irak possédait des armes de destruction massive. Ils ont ensuite contourné l’Onu et se sont associés au Royaume-Uni, à l’Australie et à la Pologne pour attaquer l’Irak. Qualifiant ses partisans européens de « nouvelle Europe », l’administration Bush s’est également moquée des pays européens comme la France et l’Allemagne qui s’opposaient à la guerre en Irak, les qualifiant de « vieille Europe ». Ce propos de l’ancien secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld est entré dans l’histoire des querelles euro-américaines.
Pour Guo Bingyun, le moteur franco-allemand de l’UE s’est replié sur lui-même pour se concentrer sur les affaires intérieures, les affaires étrangères passant au second plan. Avec la guerre russo-ukrainienne en cours, il est peu probable que les relations bilatérales entre l’Europe et la Russie s’améliorent à court terme. L’administration pragmatique de Trump a précisément ciblé cette fenêtre d’opportunité pour promouvoir la paix afin de maximiser les avantages américains. Les grands perdants dans cette affaire ne sont autres que les Européens.
Un jeu de dupes ?
Cependant, l’affaire ne semble pas aussi simple que ça. Comme l’écrit Shane Neagle pour Fair Observer, les responsables américains de la deuxième administration du président Donald Trump se sont moqués publiquement des alliés européens tout en promouvant en privé une stratégie transatlantique qui favorise la domination américaine. Des fuites provenant de discussions internes, associées à des changements de politique européenne et à une coordination médiatique, suggèrent que le fossé perçu entre l’UE et les États-Unis pourrait servir un objectif calculé plutôt que refléter une véritable rupture. Les États-Unis semblent utiliser l’illusion d’un conflit pour consolider leur puissance mondiale tout en reportant les coûts sur leurs partenaires européens.
Ce changement de rhétorique n’est pas passé inaperçu à l’étranger. Début mars, le président français Emmanuel Macron a déclaré dans une allocution télévisée que l’Occident entrait dans « une nouvelle ère », dans laquelle les États-Unis pourraient ne plus être un allié de confiance. Cet avertissement renforce les spéculations selon lesquelles les relations de Washington avec l’Europe pourraient connaître une rupture structurelle.
Pour cet auteur, les États-Unis ont désormais toutes les cartes en main. « Grâce aux outils tarifaires, le président Trump peut commencer à relocaliser l’industrie américaine. Et même sans être redevable au gouvernement fédéral, l’Europe est confrontée à un problème massif de parasitisme bureaucratique, qui décourage la fiscalité et compromet les politiques de neutralité carbone ».
L’essentiel selon Shane Neagle, après la Seconde Guerre mondiale, « l’Europe a noué une relation de vassalité avec les États-Unis. Cette relation n’a fait que se renforcer, grâce à la domination américaine soigneusement entretenue dans les secteurs des grandes technologies, des grandes banques et des grandes sociétés pharmaceutiques. Le cadre actuel ne renforce pas l’UE, mais consolide la domination américaine ». Tout est dit !
The post Trump, Poutine et l’avenir des relations transatlantiques: Les Européens à la dérive appeared first on Le Jeune Indépendant.