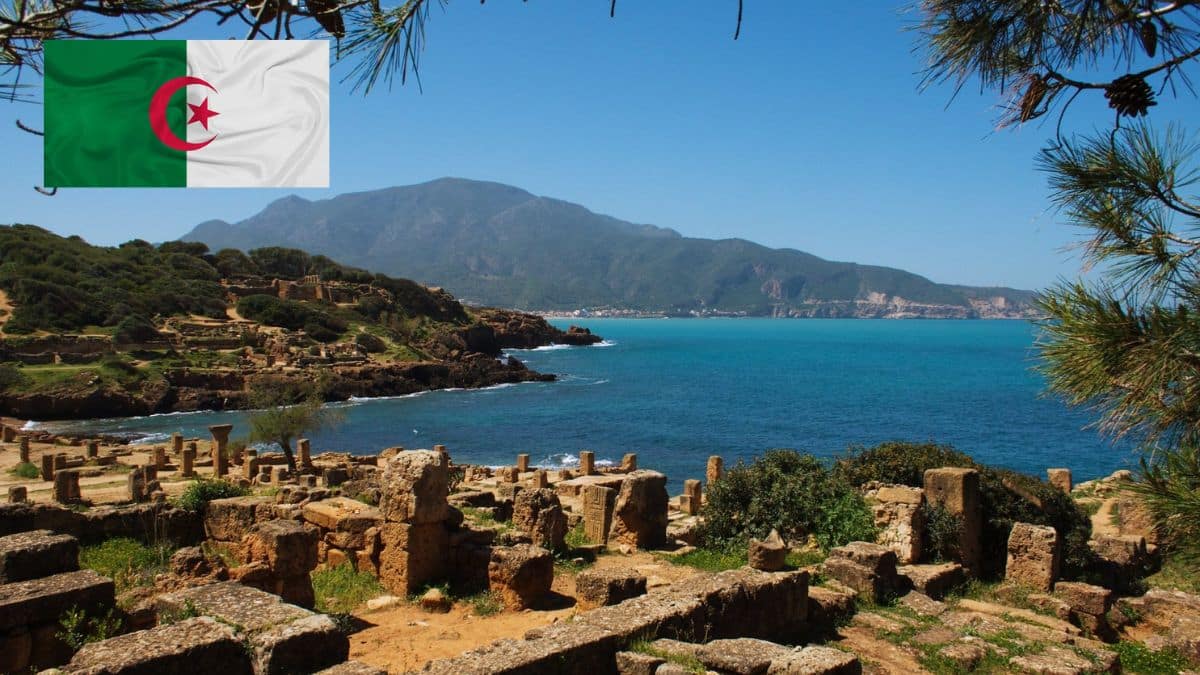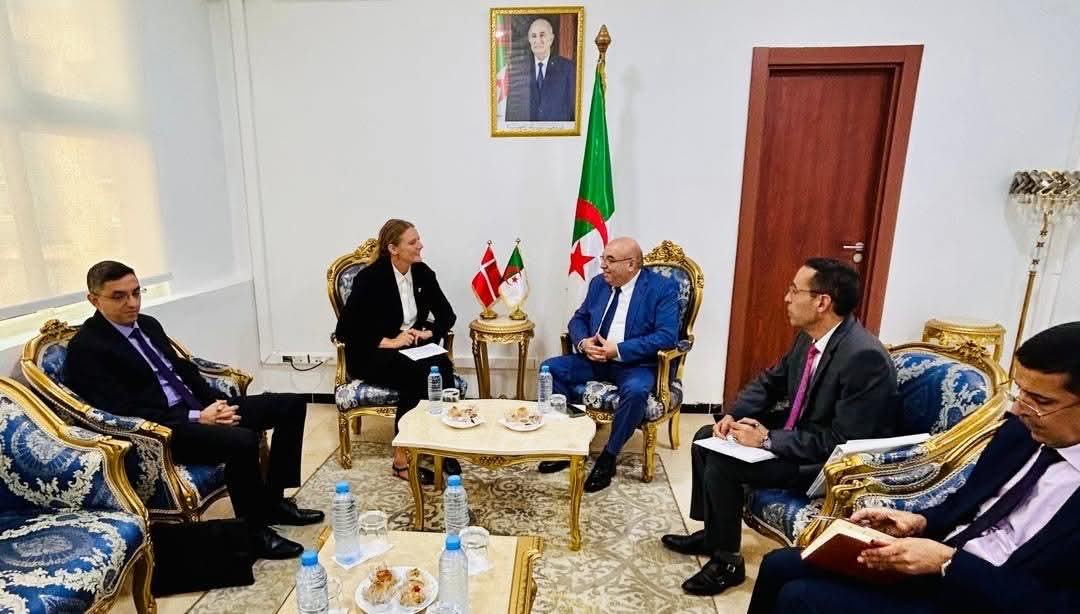A l’Indépendance, les élèves étaient vêtus aux couleurs de l’emblème national
Professeur émérite des universités, sociologue, Aissa Kadri a enseigné à l’université d’Alger à l’aube des années soixante-dix. Ancien directeur de l’Institut Maghreb-Europe (université Paris VIII), il est l’auteur d’une somme de travaux sur la sociologie de l’éducation, l’intelligentsia maghrébine et diverses thématiques liées au mouvement national algérien. Entre autres travaux centrés sur l’école en Algérie […] The post A l’Indépendance, les élèves étaient vêtus aux couleurs de l’emblème national appeared first on Le Jeune Indépendant.

Professeur émérite des universités, sociologue, Aissa Kadri a enseigné à l’université d’Alger à l’aube des années soixante-dix. Ancien directeur de l’Institut Maghreb-Europe (université Paris VIII), il est l’auteur d’une somme de travaux sur la sociologie de l’éducation, l’intelligentsia maghrébine et diverses thématiques liées au mouvement national algérien.
Entre autres travaux centrés sur l’école en Algérie coloniale et post-indépendance, il a publié de nombreux ouvrages collectifs sur les instituteurs et enseignants en Algérie, notamment avec Jean-Paul Roux « L’école dans l’Algérie coloniale, conformer ou émanciper » (Instituteurs et enseignants en Algérie 1945/1962, Paris, Sudel, 2004). S’y ajoutent de nombreux articles : « Transmission des savoirs en situation coloniale : l’imposition du système d’enseignement français en Algérie » in Patrick Pion et Nathan Schlanger ; « Apprendre . Archéologie de la transmission des savoirs » (Paris La Découverte, Inrap, 2020) ; « Le système d’enseignement Algérien entre passé et présent » in Philippe Bance et Jacques Fournier ; « Éducation et intérêt général » (CIRIEC, working paper 18/11/, PURH, 2018) ; «Le SNI et la guerre d’Algérie» in Jean Robert Henry et Florence Hudowicz ; « L’école en Algérie , l’Algérie à l’école » (Éditions du Musée Nationale de l’Education , MUNAE, CANOPE, 2017) ; « Histoire du système d’enseignement colonial » in F. Abecassis et alii « La France et l’Algérie : leçons d’histoire » (Lyon, éditions INRP 2007). Il a également publié — en collaboration avec Fabienne Rio – « Enseignants issus des immigrations : l’effet génération ( Sudel, 2006).
Le Jeune Indépendant : L’Algérie indépendante a bel et bien été au rendez-vous avec la rentrée des classes, session 1962-1963. Quel regard portez-vous sur cette ‘’première’’ scolaire quelques semaines seulement après l’indépendance ? Peut-on parler d’un défi négocié avec succès ?
Aissa Kadri : Oui, en effet., il fallait réussir la première rentrée scolaire de l’indépendance. Pour la plus grande majorité d’entre eux, les Algériens, contrairement à ce que peuvent affirmer les thuriféraires de la colonisation positive, n’ont pas bénéficié de la scolarisation. Ils étaient exclus de l’école qui apparaissait un danger et de nature à éveiller les consciences.
Les Algériens étaient exclus de l’éducation aussi bien par le lobby des colons que par le pouvoir colonial métropolitain. Au début de la guerre d’indépendance, les Algériens effectivement scolarisés représentaient à peine 10% d’une classe en âge d’être scolarisés. Le taux d’analphabétisme dépassait les 90% de la population. A l’indépendance — et très vite –, l’école a donc été mise au centre des objectifs du développement. C’est par l’éducation que l’émancipation pouvait être parachevée.
Il y a eu une vraie mystique du rôle de l’éducation. Des sociologues contemporains parlent « d’une cargaison magique », comme prérequis du développement. Dans une phase de sortie de guerre atroce, le pouvoir indépendantiste s’est vite attelé à mettre en place les conditions de réussite de la rentrée scolaire. Il faut observer que cette rentrée a été préparée tout au long de l’été au sein de l’Exécutif provisoire grâce, entre autres, à l’engagement de personnalités dont certaines étaient issues du monde de l’enseignement.
C’est le cas de Charles Koenig, membre de l’Exécutif provisoire et, plus tard, député de la Constituante Algérienne en septembre 1962. Maire de Saida, il avait été, entre autres, l’instituteur de Ahmed Medeghri (ministre de l’Intérieur sous Ben Bella et Boumediène). André Mandouze, premier recteur de l’université nationale, et Stéphane Hessel ont joué un grand rôle. A partir du mois de mai 1962, il y a eu de nombreux échanges et discussions au sein de l’Exécutif provisoire.
Des représentants de la Fédération de l’Education Nationale (FEN), du Syndicat National des Instituteurs (SNI) et de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) sont venus à Rocher Noir (Boumèrdes) pour négocier la place des instituteurs dans l’Algérie indépendante avec Abderrahmane Farès (président de l’Exécutif), Chawki Mostefai, Charles Koenigm, Abderrahmane Kiouane, Mohamed Farès (syndicaliste, UGTA), Louis Rigaud (enseignant, syndicaliste), etc. Ces négociations ont duré tout l’été 62. Il ne faut pas oublier que la tendance majoritaire du SNI ainsi que la FEN ont été très proches de Messali Hadj et ouverts à l’idée de l’indépendance à travers la proposition de la Table-ronde comme sortie de la guerre.
LJI : Entre la sortie de guerre avec le terrorisme de l’OAS, la période de transition, la crise de l’été 1962, est-ce que l’agenda jouait en faveur de cette rentrée ? L’année scolaire était-elle compromise ?
Oui, en effet, l’été 1962 a connu une acmé des violences avec la politique de la terre brûlée de l’organisation criminelle de l’OAS. Symbole de la volonté de maintenir l’Algérie dans la nuit coloniale, six instituteurs des centres sociaux (Marcel Basset, Mouloud Feraoun, Ali Hammoutène, Max Marchand, Robert Eymard et Salah Ould Aoudia) sont assassinés par les criminels de l’OAS en mars 62. Deux autres ont été assassinés à l’Est du pays dont un qui était descendu de chez lui pour acheter une bouteille de champagne afin de fêter le cessez-le-feu a été exécuté devant son épouse.
Par ailleurs, la mise en place des autorités algériennes a été également très difficile et a connu des affrontements fratricides.
Durant ce laps de temps, sous l’effet de l’organisation du FLN et de la mobilisation des Algériens, des cours de substitution ont pu être organisés dans les quartiers pour parer à la fermeture des classes de mars à juin. La réussite de la rentrée se devait d’être la réponse aux criminels qui visaient à faire du pays un cimetière. Les syndicalistes Algériens comme les Européens, les autorités du moment — Exécutif et responsables du FLN — se sont mobilisées dans des conditions difficiles pour que la rentrée soit une fête.
LJI : Qu’en est-il de la sociologie du corps enseignant européen qui a accepté de s’associer au nouvel État et assurer la rentrée ?
: Sur les 26.000 enseignants qui exerçaient en Algérie avant l’indépendance, 15.000 seront à pied d’œuvre pour assurer la rentrée. La plupart sont restés en Algérie alors que d’autres – effrayés par les menaces de l’OAS – sont partis avant de revenir. Ces instituteurs étaient majoritairement affiliés au SNI, syndicat dont la section algérienne va être remplacée par l’Association Professionnelle des Instituteurs Français en Algérie (APIFA) dirigée par Louis Rigaud. Le SNI était traversé par trois tendances.
Les partisans de l’’’Algérie française’’ se sont séparés du SNI dès 1957 pour créer leur propre syndicat. La rentrée a été encadrée majoritairement par ces instituteurs auxquels il faut ajouter les Algériens recrutés sur le tas — moniteurs, instructeurs, jeunes enseignants — qui vont rejoindre l’institution éducative sans grande formation pédagogique. La rentrée a été une très grande fête. Elle a été portée par des professionnels et des bénévoles avec le concours des parents d’élèves. Pour la circonstance, les élèves étaient vêtus d’habits aux couleurs de l’emblème national.
The post A l’Indépendance, les élèves étaient vêtus aux couleurs de l’emblème national appeared first on Le Jeune Indépendant.