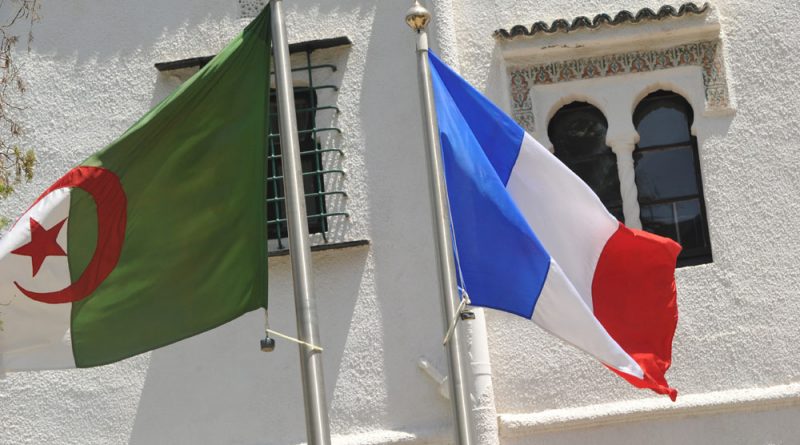Djamaâ El Djazaïr : Une grandeur architecturale sino-algérienne
Debout à quelque centaine de mètres, il observe chaque détail des colonnes de l’édifice. Parfois il lève le doigt pour orienter les regards de ces camarades vers l’imposant chef d’œuvre. Mùchén, 38 ans, natif de Kumning dans le sud de la Chine a travaillé pendant cinq ans à la réalisation de cet ouvrage implanté là […] The post Djamaâ El Djazaïr : Une grandeur architecturale sino-algérienne appeared first on Le Jeune Indépendant.

Debout à quelque centaine de mètres, il observe chaque détail des colonnes de l’édifice. Parfois il lève le doigt pour orienter les regards de ces camarades vers l’imposant chef d’œuvre. Mùchén, 38 ans, natif de Kumning dans le sud de la Chine a travaillé pendant cinq ans à la réalisation de cet ouvrage implanté là où jadis sévissait l’Archevêque Charles Lavigerie, dans une illusoire entreprise de christianisation des algériens au temps de la colonisation.
La Grande Mosquée d’Alger, baptisée officiellement « Djamaâ El Djazaïr », s’impose aujourd’hui comme l’un des édifices les plus emblématiques de l’Algérie indépendante. Symbole de grandeur spirituelle, de prouesse technique et de diplomatie internationale, elle incarne un pont audacieux entre tradition islamique et modernité architecturale. Elle représente aussi l’aboutissement d’une coopération stratégique entre l’Algérie et la Chine.
C’est ce résultat que Mùchén et ses compatriotes sont venus, en compagnie d’une interprète algérienne, admirer dit-il au Jeune Indépendant. « Je ne pensais pas que notre travail allait donner lieu à ce merveilleux résultat », a-t-il admis, expliquant qu’il n’a jamais participé à la construction d’une mosquée auparavant. En comparant les autres mosquées qu’il a vues depuis 2019, date de la fin de son contrat en Algérie, Mùchén dont le prénom signifie « baignade dans le palais céleste », cette mosquée se dresse tel un monument céleste inégalé, affirme-t-il. Aujourd’hui, il est revenu en Algérie pour travailler dans un « chantier gigantesque » celui des ports.
Pour Mùchén et tous les visiteurs ou passante, il suffit de longer la baie d’Alger pour qu’un monument s’impose naturellement au regard. Impossible de l’éviter : la Grande Mosquée capte l’attention dès les premiers instants. Il est à peine 9 heures. Le ciel est clair, la mer étonnamment calme. À l’horizon, une silhouette domine l’ensemble du paysage : Djamaâ El Djazaïr. Difficile de passer à côté.

Dès qu’on s’approche de ce site emblématique, on est frappé par sa taille qui s’élève à perte de vue et par cette silhouette imposante ponctuée par ce minaret monumental de 265 mètres de haut. C’est le plus grand du monde. Nous voilà aux portes d’un chef-d’œuvre de l’architecture islamique moderne, un lieu de culte hors du commun.
En entrant dans l’esplanade. À chaque pas, l’immensité du lieu se fait sentir. Ici, tout est pensé pour émerveiller. Plus qu’un édifice religieux, la mosquée, tout de marbre et de pierre finement travaillé, est un espace où l’ingéniosité technique rime avec spiritualité.
En levant les yeux, on voit le minaret se dresser dans le ciel d’Alger, comme s’il touchait les nuages. Les rayons du matin glissent doucement sur ses parois en verre, faisant briller la façade. Une brise légère venue de la mer traverse l’esplanade. Des touristes prennent des photos, pendant que des fidèles marchent calmement vers l’entrée. « C’est la première fois que je viens ici. J’avais vu des images, mais en vrai, c’est autre chose. On se sent tout petit », confie Salim, venu de Tizi Ouzou avec sa famille.
La cour intérieure est bordée d’arcades joliment décorées. Le sol en marbre reflète la lumière naturelle qui entre par de grandes ouvertures. En entrant dans la mosquée, on est forcément frappé par la beauté et l’immensité de sa salle de prière. On s’y sent tout petit. Le plafond est très haut, orné d’un énorme lustre suspendu à plus de 70 mètres.De grandes colonnes soutiennent l’ensemble sans encombrer l’espace. Le bois utilisé pour les moucharabiehs et les portes dégage une odeur agréable, qui donne de la chaleur à l’endroit.

Imposante salle de prière
Le mihrab, finement sculpté, attire le regard. On entend même un chuchotement résonner à l’autre bout de la salle. « J’ai travaillé sur ce chantier pendant deux ans », raconte Mourad, technicien en génie civil, rencontrée soudainement sur place. « C’était un projet immense, surtout pour les finitions à l’intérieur. Chaque détail devait être parfait. On savait qu’on participait à quelque chose d’historique ».
Pour Fatma Zohra, Morchida, rencontrée dans la salle réservée aux femmes, ce lieu, c’est aussi un centre de savoir. « Ce n’est pas seulement un espace de prière, c’est une mosquée tournée vers l’avenir », explique-t-elle. Et de poursuivre : « Djamaâ El Djazaïr montre qu’on peut allier foi, modernité et connaissance. Il y a ici des espaces pour l’étude, la réflexion et le dialogue. C’est important, surtout pour les jeunes générations ».
Une œuvre signée Chine State Construction
Mais au-delà des chiffres impressionnants, 400 000 m² de surface, une salle de prière pouvant accueillir 120 000 fidèles, une bibliothèque de plus d’un million de livres, c’est la signature architecturale sino-algérienne qui confère à l’édifice une dimension unique, a tenu à rappeler le président de l’Association des architectes, M. Ahmed Bouzidi.
« Le projet a été attribué en 2011 à l’entreprise publique chinoise China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), l’un des géants mondiaux du BTP. Pour mener à bien ce chantier titanesque, plus de 2 300 ingénieurs, architectes et ouvriers chinois ont été mobilisés aux côtés de milliers d’Algériens », a-t-il précisé. Pour lui, la grande mosquée incarne un projet d’envergure qui reflète clairement l’ambition de l’État de s’affirmer sur la scène architecturale et religieuse mondiale.
Selon lui, tout projet de cette dimension mérite que l’on cite, en préambule, les principaux acteurs impliqués dans sa conception, son contrôle et sa réalisation. Il rappelle ainsi que la conception architecturale a été confiée au cabinet allemand KSP Jürgen Engel Architekten, basé à Francfort, en partenariat avec le bureau d’ingénierie INGEROP. Quant à la réalisation, elle a été assurée par la grande entreprise publique chinoise China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).

Des lieux d’ablutions
Pour le volet du contrôle technique, M. Bouzidi précise qu’il a été assuré par Veritas Algérie, en collaboration avec le CTC (Contrôle technique de la construction), notamment pour l’homologation locale.
Il insiste également sur la contribution significative d’artisans algériens, mobilisés pour les éléments décoratifs. Les travaux de pose de marbre ont ainsi été attribués à des producteurs locaux, et les meilleurs produits artistiques nationaux ont été sélectionnés afin de refléter pleinement l’authenticité et l’identité algérienne. Par ailleurs, une commission multisectorielle a été instituée pour examiner dans le détail tous les aspects artistiques du projet. Elle a élaboré un cahier des charges rigoureux encadrant les opérations d’ornementation, de sculpture et de revêtement. L’objectif étant, d’une part, de préserver le cachet artistique local et, d’autre part, de réduire les importations de matériaux.
Sur le plan technique, l’architecte fait savoir que l’édifice se distingue par plusieurs prouesses remarquables. Sa salle de prière, de forme carrée s’étend sur 145 mètres de côté. Elle est surmontée d’une immense coupole de 70 mètres de hauteur et de 50 mètres de diamètre, soutenue sans aucun appui intermédiaire, ce qui constitue un véritable exploit d’ingénierie.
Par ailleurs, le minaret de 265 mètres – le plus haut au monde – constitue un repère urbain majeur. Il abrite un musée, une plateforme panoramique ainsi que des ascenseurs répartis sur 43 étages.
Toujours selon M. Bouzidi, l’ensemble de la structure repose sur du béton armé à haute performance, intégrant un système parasismique avancé combinant isolateurs sismiques et amortisseurs hydrauliques. Ce dispositif permet de réduire considérablement les effets d’un séisme majeur.
Au-delà de l’aspect monumental, il souligne que le projet articule intelligemment les fonctions spirituelles, culturelles et éducatives. La mosquée regroupe ainsi une salle de prière, une bibliothèque de 3 500 places, un musée d’art et d’histoire, une école coranique, un centre de recherche, un amphithéâtre ainsi que des jardins.
Entre tradition et modernité
Enfin, M. Bouzidi attire l’attention sur l’usage innovant de matériaux contemporains – verre, acier, béton fibré – pour la réalisation de motifs décoratifs traditionnels, tels que les moucharabiehs, arabesques et calligraphies. Une manière, selon lui, de concilier modernité architecturale et héritage culturel. Il estime que cette approche ouvre une réflexion sur les références esthétiques fondatrices du projet.
En somme, pour le président de l’Association des architectes, l’architecture algérienne est le reflet d’un équilibre rare. Elle puise dans ses racines tout en s’ouvrant sur le monde. « Sa richesse naît de la diversité de ses influences, mais surtout de sa capacité à les intégrer avec intelligence. Des ksour sahariens aux patios d’inspiration ottomane, des arcs romains aux médinas andalouses, chaque époque a marqué le territoire, laissant derrière elle des empreintes que l’Algérie a su faire siennes, en les réinterprétant avec finesse », a-t-il précisé.
Dans cet héritage en mouvement, Djamaâ El Djazaïr s’impose comme un point culminant. Elle incarne à la fois la mémoire architecturale du pays et ses aspirations modernes. Pour M. Bouzidi, cette mosquée n’est pas seulement un édifice religieux : elle montre comment le patrimoine peut devenir moteur d’innovation, et comment l’Algérie peut dialoguer avec les grandes œuvres architecturales du monde sans renier son identité. C’est peut-être là, selon lui, ce qui fait la force et l’universalité de l’architecture algérienne : sa capacité à se transformer sans se perdre. À travers cette synthèse entre verticalité inspirée des mégastructures et ancrage identitaire, souligne M. Bouzidi, se dessine toute la richesse symbolique du projet.
Un édifice de renommée mondiale
Pour Ismail Chaib, expert en tourisme et spécialiste des circuits patrimoniaux de la capitale, Alger peut aujourd’hui se targuer d’abriter l’un des monuments les plus emblématiques du monde musulman : Djamaa El Djazaïr, la Grande Mosquée d’Alger. « En plus du célèbre Monument des Martyrs, la capitale s’est dotée d’un édifice religieux de renommée mondiale, classé troisième après les deux sanctuaires saints de La Mecque et de Médine », affirme-t-il.
Son minaret, visible depuis les quatre coins du Grand Alger et même au-delà, de Larbaâ à Bouzegza, sert de repère majestueux. Mais au-delà de son apparence imposante, Djamaa El Djazaïr incarne une œuvre symbolique, à forte valeur historique et identitaire.

L’esplanade et le minaret
Selon l’expert, « le choix du site n’est pas fortuit. L’Algérie avait décidé, bien avant le gouvernement de feu Bouteflika, de construire une grande mosquée à l’emplacement du grand séminaire, bâti peu après l’agression coloniale française de 1830. On y formait des curés et des nonnes sous la supervision du cardinal Lavigerie, chargé de christianiser les populations musulmanes ». En érigeant Djamaa El Djazaïr à cet endroit précis, au centre exact du demi-cercle de la baie d’Alger, l’État algérien a réaffirmé une souveraineté spirituelle et culturelle longtemps niée.
Au-delà de sa symbolique, l’emplacement de la mosquée constitue un atout stratégique et touristique majeur. « Elle est intégrée dans un environnement exceptionnel : un complexe de loisirs et d’affaires comprenant un palace cinq étoiles, des tours d’activités, sans oublier la proximité immédiate avec les Sablettes, espace très fréquenté par les familles algéroises. Ce n’est pas un monument isolé, mais une pièce maîtresse d’un ensemble urbain moderne », précise Ismail Chaib.
Un pôle religieux, culturel et touristique d’envergure
Le site offre ainsi une expérience complète. Prier dans la mosquée, visiter son institut supérieur de formation d’imams et de cadres religieux, puis prolonger la journée par une promenade en bord de mer ou un déjeuner en famille, devient une véritable escapade culturelle et spirituelle. « Une visite à Djamaa El Djazaïr peut facilement occuper toute une journée », insiste-t-il.
Architecturalement, la mosquée est un chef-d’œuvre arabo-andalou aux lignes contemporaines, fruit de la collaboration avec des équipes chinoises qui ont scrupuleusement suivi les instructions algériennes pour refléter l’esthétique et le patrimoine national.
A ses yeux, cet édifice rejoint les « Sept Merveilles d’Alger », la Casbah, Djamaa Lekbir, Djamaa Jdid, le Palais du Dey, le front de mer de Bab El Oued aux Deux Moulins, le Monument des Martyrs… et enfin, Djamaa El Djazaïr, en sommet de cette liste authentiquement algérienne.
The post Djamaâ El Djazaïr : Une grandeur architecturale sino-algérienne appeared first on Le Jeune Indépendant.