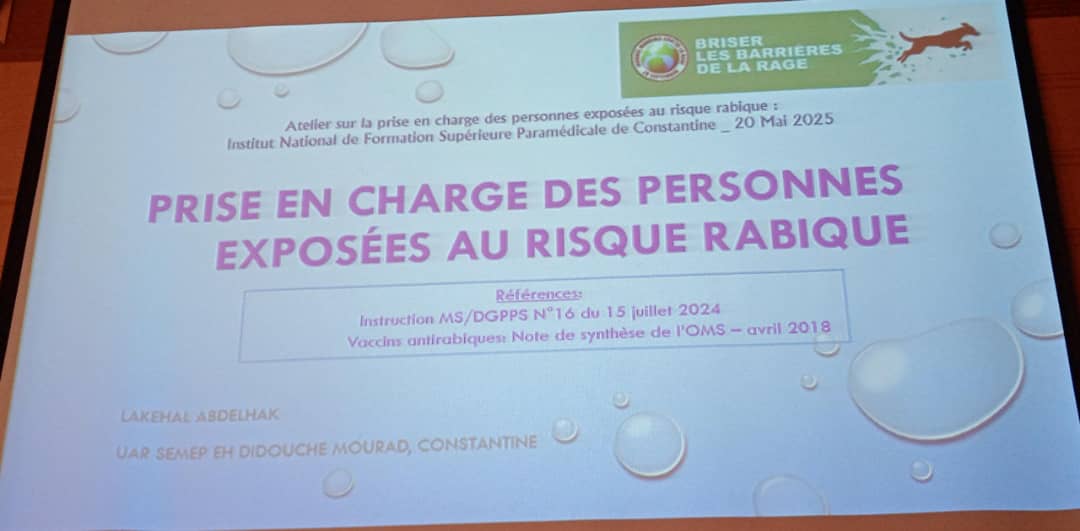La CPI dans l’œil de cyclone : Quand l’Occident trompe le monde
L’Occident intégral saborde les institutions qu’il a créées. Après avoir vidé l’Onu de sa substance, voilà le tour d’une institution que ce même Occident n’a cessé d’utiliser et de manipuler afin de condamner les ennemis géopolitiques des Etats-Unis et de l’Europe, à l’instar des dirigeants africains ou la Russie. Il s’agit de la Cour pénale […] The post La CPI dans l’œil de cyclone : Quand l’Occident trompe le monde appeared first on Le Jeune Indépendant.

L’Occident intégral saborde les institutions qu’il a créées. Après avoir vidé l’Onu de sa substance, voilà le tour d’une institution que ce même Occident n’a cessé d’utiliser et de manipuler afin de condamner les ennemis géopolitiques des Etats-Unis et de l’Europe, à l’instar des dirigeants africains ou la Russie. Il s’agit de la Cour pénale internationale (CPI) d’être la cible de l’Occident intégral.
A l’issue de la Seconde guerre mondiale, les Alliés ont institué les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour condamner les criminels de guerre allemands et nippons. Lorsque les travaux des tribunaux internationaux ont pris fin, des juristes de divers pays ont proposé la création d’un organe judiciaire international permanent, qui pourrait traduire en justice les responsables des crimes les plus violents contre l’humanité. La guerre froide persistante a entravé ces projets. Ce n’est qu’à l’aube des années 1990 que l’idée d’une cour pénale internationale permanente a été relancée et, en 1998, à Rome, le Statut de la Cour pénale internationale a été signé comme document constitutif.
La CPI a été créée en tant qu’organisation internationale indépendante. Son organe principal est l’Assemblée des États parties, qui comprend tous les États membres, 125 actuellement. La fonction principale consiste à traduire en justice les auteurs des « crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble ».
En vertu de l’article 119 du Statut, la Cour peut, de sa propre initiative, détermine la recevabilité de toute affaire. Ainsi, la Cour est la seule instance suprême dans les différends dans lesquels elle est impliquée, c’est-à-dire qu’elle agit en tant que juge dans sa propre affaire (ce qui, en fait, contredit le principe nemo judex in propria causa). Tous les juges et autres employés de la CPI bénéficient de l’immunité et des privilèges internationaux sur le territoire des États membres, y compris les Pays-Bas, où elle siège. La compétence de la CPI se décline pour le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
L’exception israélienne
La pratique judiciaire de la CPI a soulevé des questions légitimes, et pas seulement de la part des juristes. Au fil du temps, la CPI a de plus en plus démontré sa dépendance à l’égard de facteurs politiques et idéologiques censés être exclus de sa pratique. Une tendance évidente s’est développée à condamner ou à pardonner uniquement dans l’intérêt de ce que l’on appelle l’Occident collectif, sur la base de son double standard.
Aussi curieux que cela puisse paraître, cela impliquait de s’attirer les faveurs d’un certain nombre d’États (principalement les États-Unis) qui se montraient assez dédaigneux à l’égard de la CPI et de ses pratiques. En Occident, il existe une hiérarchie stricte des relations, qui s’est récemment manifestée dans le cas de Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant et d’autres, lorsque les pays européens parties au Statut de la CPI ont d’abord exprimé leur intention de poursuivre les dirigeants israéliens, mais après une sévère réprimande de Washington, ils ont commencé à parler du « caractère exceptionnel » de l’affaire et ont refusé de poursuivre les responsables israéliens. À proprement parler, après cela, la CPI aurait dû choisir de se dissoudre, car il est impossible d’imaginer un plus grand mépris.
L’Afrique, cible principale de la CPI ?
En général, selon le site de la CPI, celle-ci a examiné 33 affaires en plus de 20 ans ; certaines affaires sont en cours d’examen, notamment celles concernant plusieurs dirigeants politiques et militaires africains (République démocratique du Congo, Ouganda, Soudan, Rwanda, Kenya, Libye, Côte d’Ivoire, Mali, République centrafricaine). Cependant, un certain nombre de criminels de guerre de haut rang sont restés impunis. La Cour pénale de La Haye a démontré une cécité et une perte auditive discriminatoires à leur égard
Ce n’est pas une coïncidence si l’ancien président de la Commission de l’Union africaine, Jean Ping, a déclaré aux journalistes que la Cour était un jouet des puissances impériales en déclin. Des opinions se sont répandues selon lesquelles la CPI ne s’intéressait apparemment qu’à la poursuite des Africains qui affrontaient l’influence occidentale et utilisait l’Afrique comme laboratoire pour tester la justice pénale internationale. Il ne faut pas oublier qu’en 2017, l’Union africaine a adopté une résolution appelant tous les pays africains à cesser de coopérer avec la CPI en matière d’exécution des mandats d’arrêt contre les suspects africains et à se retirer collectivement de la CPI. Le fait que la CPI soit partiale et agisse dans l’intérêt d’un certain nombre de pays occidentaux refusant de poursuivre des personnes originaires des pays de l’OTAN a été reconnu par les représentants de divers continents. C’est pourquoi, en particulier, le Burundi et les Philippines ont déclaré leur retrait du Statut.
L’Afghanistan des deux poids, deux mesures
Un autre élément a également attiré l’attention. Pour une raison « inconnue », la CPI n’a pas pris en compte les événements survenus dans les pays où la justice, la paix et l’humanisme n’étaient rien de moins qu’un rêve éveillé, mais où les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN défendaient leurs intérêts. Ainsi, pendant près de vingt ans (de 2001 à 2021), les forces de l’OTAN ont été engagées dans des opérations militaires actives sur le territoire de l’Afghanistan, l’État qui a rejoint la CPI en 2003
Selon les médias, pendant toute cette période, ils ont commis des actes qui pourraient être considérés comme des crimes de guerre. Pourtant, la CPI ne l’a jamais fait. Autre exemple : en novembre 2017, Fatou Bensouda, alors procureure de la CPI, a demandé à la Chambre préliminaire de la CPI l’autorisation d’ouvrir une enquête sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par le groupe d’opposition afghan « Taliban », les crimes de guerre commis par les forces de sécurité du gouvernement afghan et les crimes de guerre commis sur le territoire afghan à partir du 1er mai 2003 par des militaires américains et des agents de la CIA. Après dix-huit mois d’examen, en avril 2019, la Chambre préliminaire a rejeté la demande, déclarant qu’« une enquête sur la situation en Afghanistan à ce stade ne servirait pas les intérêts de la justice ».
Cela a été suivi par une réaction sévère des États-Unis, qui ne sont pas membre de la CPI, à l’idée même de traduire en justice leurs personnels militaires et leurs citoyens devant un tribunal international. En juin 2020, le président américain Donald Trump a déclaré que l’affirmation de la compétence de la CPI sur le personnel militaire, de renseignement et autre personnel américain dans le cadre d’enquêtes sur des actes prétendument commis par ce personnel en Afghanistan ou en rapport avec celui-ci « constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis ».
Quand Trump pénalise la Cour
Invoquant les mesures prévues par la loi américaine, le président Trump a signé le décret exécutif 13928, en vertu duquel le secrétaire d’État, en consultation avec le secrétaire au Trésor et le procureur général, est chargé d’identifier toute « personne étrangère » qui, en particulier, a directement participé aux efforts de la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre tout personnel américain sans le consentement des États-Unis.
Ces personnes peuvent faire l’objet d’un blocage de leurs biens si ces biens relèvent de la juridiction américaine ; en outre, l’entrée aux États-Unis peut leur être refusée.
Le 2 septembre 2020, les États-Unis ont imposé des sanctions personnelles à la procureure en chef de la CPI, Fatou Bensouda, et à Phakiso Mochochoko, le directeur de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération de la CPI. En dépit du droit d’ouvrir une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis en Afghanistan, le nouveau procureur de la CPI n’a pas encore inculpé de militaires américains ayant participé aux hostilités en Afghanistan. Cinq ans plus tard, de retour au pouvoir, Donald Trump n’a pas tardé à réitérer sa position à l’égard de la CPI.
Le 6 février 2025, le président américain a signé un décret imposant des sanctions contre la Cour pénale internationale en réponse aux « actions illégitimes et sans fondement visant l’Amérique et notre proche allié Israël ». Trump a déclaré que la conduite de la Cour « menace de porter atteinte à la souveraineté des États-Unis ». Les États-Unis ont menacé d’imposer des sanctions aux fonctionnaires, employés et agents de la CPI, ainsi qu’aux membres de leur famille immédiate, notamment le gel des biens et des avoirs et la suspension de l’entrée aux États-Unis. Il convient de noter que la première personne à faire face aux sanctions du président Trump a été Karim Khan, procureur de la CPI. Dans son décret, Trump a suspendu l’entrée de Karim Khan aux États-Unis, et ses biens qui se trouvent ou qui entreront ultérieurement sur le territoire des États-Unis sont gelés.
Le casse-tête russe
En mars 2023, la Cour pénale de La Haye a docilement lancé des mandats d’arrêt contre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova. D’un point de vue juridique, cette décision n’a essuyé aucune critique. Les pays occidentaux utilisent le terme « agression » de manière purement formelle, au sens que lui attribue la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1974. Selon cette résolution, l’agression est « l’emploi de la force armée par un État contre « souveraineté, intégrité territoriale ou indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies… », ce qui « engendre une responsabilité internationale ».
En appliquant cette définition à l’Opération militaire spéciale, les États occidentaux ignorent des questions majeures de fait et de droit, tout d’abord le soulèvement susmentionné à Kiev en 2014, inspiré par Washington, qui constituait une violation flagrante de l’article 2 (7) de la Charte des Nations Unies (sur la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État). Après ce coup d’État, l’Ukraine n’était de facto plus un État souverain. Une autre circonstance ignorée par l’Occident dans son ensemble est que le recours aux forces armées autorisé par le droit international (à titre de légitime défense, y compris préventive) ne constitue pas une agression.
Il convient de rappeler que parmi les pays qui accusent la Russie d’« agression », figurent, outre les USA, les États membres de l’OTAN, la plupart des membres du Conseil de l’Europe et le G7.
En février 2025, 125 États étaient parties au Statut de Rome (l’ONU en comptait 193). Malgré son nombre, la CPI ne représente pas la communauté internationale des États dans son ensemble et n’agit pas en son nom. Trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU n’y sont pas parties (la Russie, la Chine et les États-Unis), ainsi que des pays asiatiques industrialisés et densément peuplés (l’Inde, le Pakistan, la Turquie, la Malaisie, l’Indonésie) et de nombreux pays arabes et africains.
Les accusations portées à l’encontre du Procureur Karim Khan, l’homme qui a osé inculper le Premier ministre israéliens Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Galant, sont le témoignage de la volonté de l’Occident de saborder toute institution ayant défié Israël, fut-elle la CPI.
The post La CPI dans l’œil de cyclone : Quand l’Occident trompe le monde appeared first on Le Jeune Indépendant.