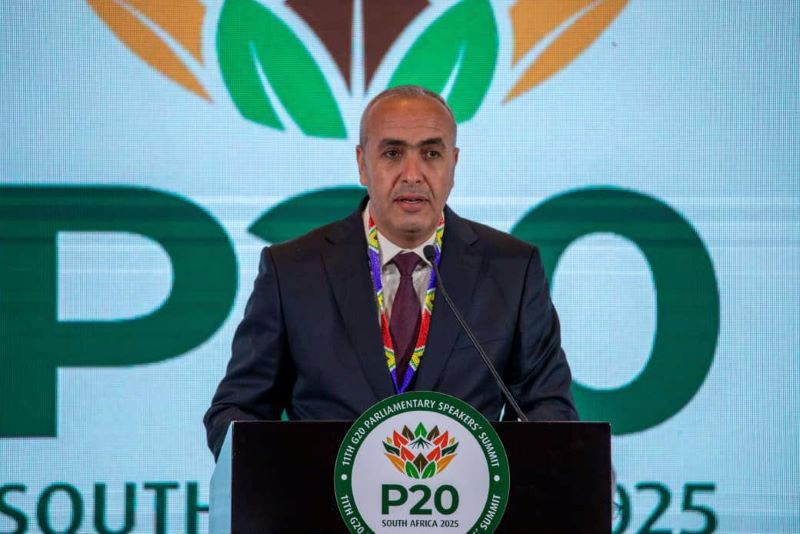La leçon du 05 juillet 1962 : Comment l’Algérie survit dans un monde volatile
Le 05 juillet 1962, loin de symboliser uniquement le recouvrement de la souveraineté nationale, est une date qui marque une rupture épistémologique avec l’ordre ancien, un ordre colonial qui a cru pouvoir déchoir le peuple algérien non seulement de sa patrie, mais de son humanité même. Il est vrai que durant 132 ans de nuit […] The post La leçon du 05 juillet 1962 : Comment l’Algérie survit dans un monde volatile appeared first on Le Jeune Indépendant.

Le 05 juillet 1962, loin de symboliser uniquement le recouvrement de la souveraineté nationale, est une date qui marque une rupture épistémologique avec l’ordre ancien, un ordre colonial qui a cru pouvoir déchoir le peuple algérien non seulement de sa patrie, mais de son humanité même. Il est vrai que durant 132 ans de nuit coloniale, les Algériens ont subi individuellement et collectivement un long et violent processus de dépossession de soi, que ce soit sur le plan de l’état civil, de la propriété, de la culture, de la religion, des traditions et de la représentation politique et civique. C’était sans compter sur sa formidable capacité de résilience et de dépassement de soi.
C’est ainsi que cette date commémorative résume à elle seule ce que le peuple algérien a refusé d’être, une masse d’indigènes compressée par l’arbitraire colonial, et ce qu’il a voulu être, soit sa projection dans l’avenir, un peuple souverain, fort, résilient, entreprenant et jaloux de son Etat, ses institutions et de son histoire. Cette marche vers le recouvrement, de haute lutte, de l’estime de soi, n’a pas été facile pour les Algériens. Loin s’en faut !
La France, dès avant l’expédition coloniale de juin 1830, avait des visées sur l’Etat souverain d’Alger, une république qui avait une quinzaine de traités de paix avec des pays occidentaux (européens et Etats-Unis d’Amérique), y compris avec la France elle-même. L’arrière-pensée des Français était de remplacer les territoires perdus en Amérique du Nord au profit de l’Angleterre et de concurrencer cette dernière dans la maitrise de la Méditerranée et de la route des Indes. Le capital français naissant allait également vouloir trouver à la fois une source d’approvisionnement en matière première et en main d’œuvre, et un déboucher à ses produits.
L’Algérie constituait donc la colonie parfaite pour la France de part sa proximité géographique et la nature du territoire. Il y avait cependant un problème : ce territoire est peuplé. Il y un peuple, le peuple algérien. D’où le caractère génocidaire qu’allait avoir l’entreprise coloniale française en Algérie. Il fallait à tout prix exterminer ce peuple pour piller ses richesses et ses terres.
La politique de la terre brulée théorisée par le criminel général Bugeaud et ses lieutenants Pélissier, Yusuf, Cavaignac, Rovigo et consorts doublée de l’acculturation du père de Lavigerie et ses pères blancs à travers un processus d’évangélisation étaient censés, aux yeux des promoteurs de cette entreprise coloniale, au mieux éradiquer le peuple algérien, au pire maintenir un petit nombre d’indigènes dépossédés, acculturés et aliénés corvéables à merci au profit du colonat.
La résistance du peuple algérien et les différentes révoltes populaires ; celles de l’émir Abdelkader, d’Ahmed Bey, des Zaatchas, de Fatma N’soumer, d’El-Mokrani, de Bouamama, de Mokhtar Ag Amoud, entre-autres, et la lutte politique partisane et associative durant la première moitié du 20ème siècle avec les figures marquantes de l’émir Khaled, Messali Hadj, Cheikh Ben Badis, Ferhat Abbas ont créé les conditions intellectuelles et militantes de la résilience qui allait se cristalliser autour du 1er novembre 1954 et le déclanchement de la lutte de libération nationale. Celle-ci, déboucha après près de huit années de guerre impitoyable et d’un million et demi de martyrs, au recouvrement de la souveraineté nationale.
Aujourd’hui, 63 ans plus tard, le monde connait une redistribution générale des cartes, des nations sont soumis à de complexes processus de déstructuration et de désarticulation par les superpuissances. Les pays de la zone MENA et d’Afrique sont les plus exposés à ces entreprises de type néocolonial. En ligne de mire l’érosion progressive de la souveraineté des nations pour mieux les piller et les vassaliser.
L’entreprise qui a débuté avec le prétendu printemps arabe a ciblé essentiellement la Tunisie, l’Egypte, la Libye, la Syrie et le Yémen. La destruction des structures étatiques de ses pays a été poussé à son paroxysme dans les trois derniers cas. En ce qui concerne la Libye, sa destruction a ouvert la boite de pandore au Sahel africain. Depuis plus d’une décennie, le Mali d’abord, le Niger et le Burkina Faso ensuite ont sombré dans la violence terroriste devenant ainsi l’épicentre mondial du terrorisme.
A la croisée de la région Maghreb-Sahel, l’Algérie est, par sa position géostratégique, ses richesses et ses potentialités, au centre des convoitises des grandes puissances, signifiant ainsi la multiplication de pressions pouvant, par un malheureux concours de circonstances aboutir à une érosion de la souveraineté, comme c’est le cas par les pays du voisinage tombés sous l’escarcelle de l’impérialisme 2.0 et du néocolonialisme.
La leçon du 05 juillet 1962 est convoquée pour servir de balise à la nation, afin d’éviter toute vulnérabilité susceptible de conduire à un effondrement national. L’intelligence collective du peuple algérien, sa résilience, notamment face à l’hydre terroriste, durant les années 1990, les réminiscences d’un passé glorieux et d’une farouche résistance au colonialisme sont autant d’antidotes qui immunisent le corps de la nation algérienne.
Le renforcement du front interne, la création d’une sorte de bloc historique, au sens de Gramsci, capable de mobiliser les ressources de la nation, peuple, armée et institutions sont des impératifs qui garantiront à l’Algérie les outils d’une vigilance nécessaire à sa pérennité dans un monde volatile.
The post La leçon du 05 juillet 1962 : Comment l’Algérie survit dans un monde volatile appeared first on Le Jeune Indépendant.