Par Mohamed Habili
L’offre d’une reprise des négociations d’Istanbul interrompues voilà trois ans, faite par le président russe à une heure tardive le lendemain du Jour de la Victoire, a eu pour premier effet de réduire à rien la proposition des cinq dirigeants européens réunis à Kiev d’un cessez-le-feu immédiat sous peine d’un renforcement des sanctions à l’encontre de la Russie. Le président ukrainien s’en est saisi aussitôt, oublieux de l’ultimatum qu’il venait à peine de poser avec ses meilleurs alliés européens, pour l’instant d’après s’envoler en Turquie, où il mettait au défi son homologue russe de venir discuter sans condition avec lui de la fin de la guerre. Comme il était prévisible, Vladimir Poutine n’a pas répondu à une invitation aussi pressante, bien qu’elle ait été relayée tant par le président turc que par le président américain, ce dernier en particulier se disant tout près de partir pour Istanbul au besoin, paraissant même disposé à écourter sa tournée dans le Golfe si le président russe décidait finalement de se rendre à un rendez-vous qu’il était après tout le premier à concevoir et à proposer.
Quelque chose s’est néanmoins produit le 15 mai à Istanbul, qui certes ne ressemble pas à une rencontre au sommet, mais qui peut très rien se révéler le début d’un processus conduisant à l’arrêt de la guerre, sinon à une paix durable. Les délégations russe et ukrainienne se sont rencontrées en présence des Turcs, cependant dans une même salle, renouant du même coup avec des négociations interrompues en avril 2022 à l’instigation des Européens alors même qu’elles étaient en train d’aboutir. La guerre aurait pu prendre fin dès ce moment, ce qui le cas échéant aurait épargné bien des vies de part et d’autre, et à l’Ukraine seule la perte de territoires, car alors les oblasts aujourd’hui annexés par la Russie n’étaient pas encore conquis par elle, sinon à leurs marges. Il n’est pas question pour la Russie de les rendre. Il est évident qu’elle préfèrerait poursuivre la guerre plutôt que de s’en retirer. Les premiers échanges ont donné lieu à un accord sur un échange d’un millier de prisonniers, sur la promesse de se revoir, et même sur celle qu’un jour Poutine et Zelensky puissent se rencontrer. Les Ukrainiens pour qui le minimum était un cessez-le-feu ont dû s’en contenter. Il existe un moyen indirect de savoir si cela a été un bon début, s’il s’est agi d’anciennes négociations qui reprennent ou de tout à fait nouvelles qui s’amorcent. Ce moyen est la guerre elle-même. Soit elle perd en intensité, soit elle en gagne. Dans le premier cas, il faut s’attendre non seulement à la poursuite des négociations mais également à ce qu’elles progressent. A tout le contraire dans le deuxième. Le seul fait que le président russe ait donné rendez-vous le 15 à Istanbul, et pas ailleurs, pas même à Ankara, moins encore ailleurs, quelque part en Arabie saoudite par exemple, ce que probablement auraient préféré les Etats-Unis s’il leur revenait d’en décider, implique que pour lui les négociations ne doivent par partir de rien mais reprendre au point elles s’étaient arrêtées il y a trois ans.























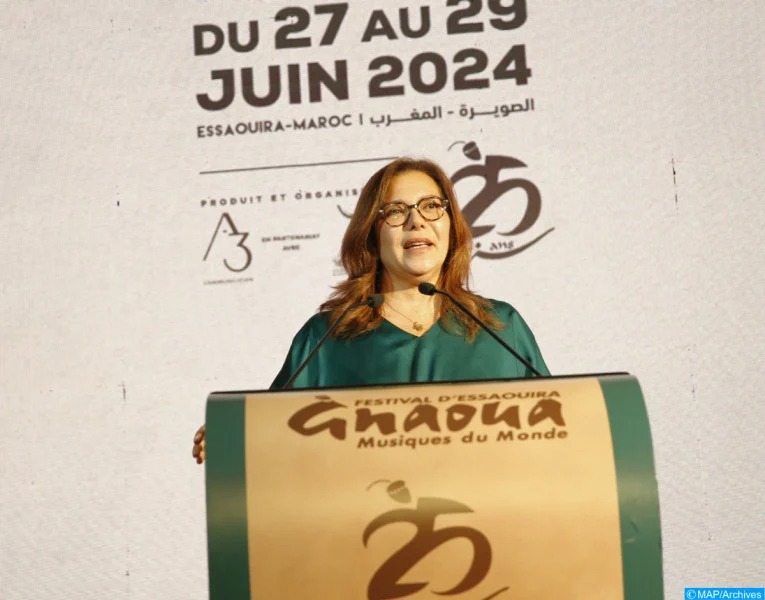

-featured.jpg?#)
































































































