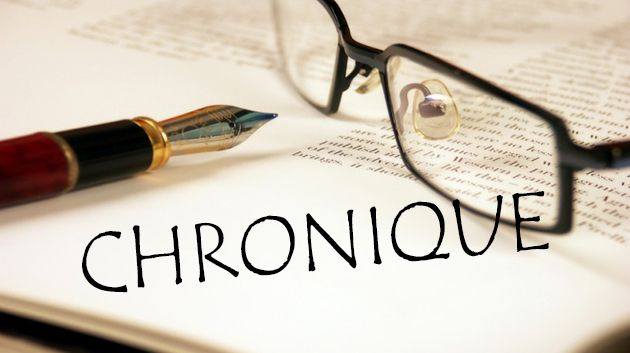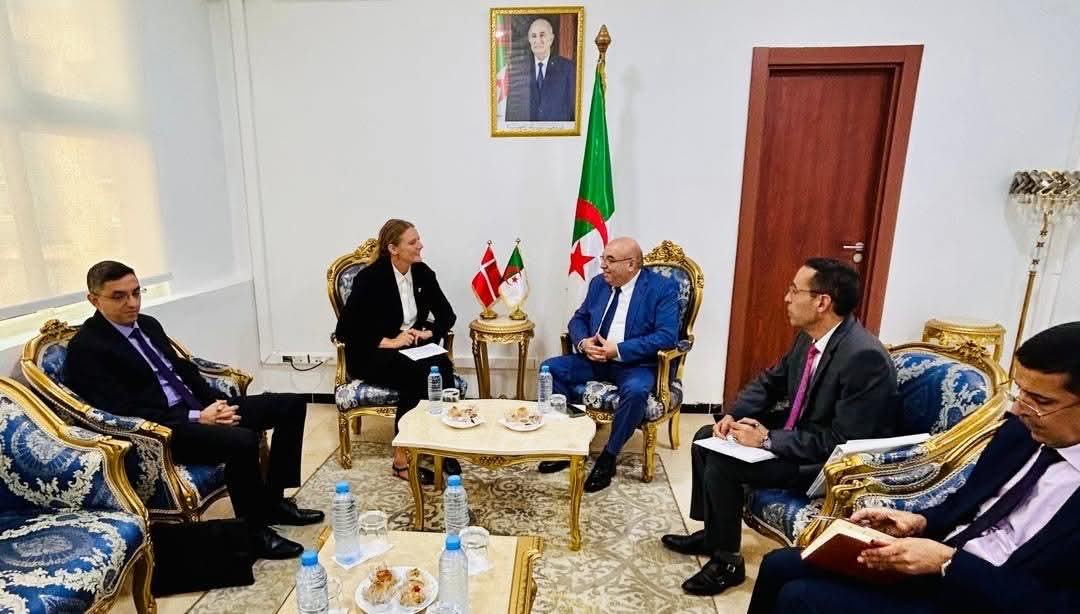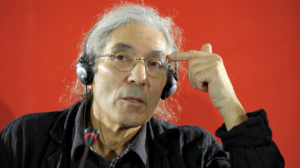Chacun pour soi
Par A. Boumezrag – La normalisation n’a pas été conçue comme un traité entre égaux. Les Etats du Golfe espéraient sécurité et gains économiques ; Israël voulait reconnaissance et accès aux marchés.

Par A. Boumezrag – Les Accords d’Abraham, présentés en 2020 comme un tournant historique, devaient transformer le Proche-Orient : reconnaissance mutuelle, ouverture économique, parapluie de sécurité américain. Cinq ans plus tard, l’illusion se dissipe. La frappe israélienne du 9 septembre 2025 à Doha – visant des négociateurs du Hamas – et le Sommet arabo-islamique qui a suivi en sont l’illustration. La normalisation n’a pas créé la paix ; elle a exposé les contradictions des alliances et les limites du parapluie américain. Du Golfe au Sahel, l’ébranlement se fait sentir.
En frappant un immeuble abritant des négociateurs, Israël a franchi un seuil : une action militaire sur le territoire d’un Etat du Golfe médiateur reconnu. Le Qatar, hôte de bases américaines, dénonce un «meurtre de négociateurs». L’émotion est vive dans tout le monde arabe. Mais le sommet d’urgence de Doha se limite à des mots : condamnation de l’attaque, appels à «des mesures légales et efficaces», pas de rupture coordonnée des relations avec Israël. Les divisions entre signataires et non-signataires des Accords sont trop profondes.
La frappe révèle le cœur du problème : la normalisation n’a pas été conçue comme un traité entre égaux. Les Etats du Golfe espéraient sécurité et gains économiques ; Israël voulait reconnaissance et accès aux marchés. Chacun croyait avoir roulé l’autre. Résultat : un accord fragile qui n’empêche ni les frappes ni les crises. Le nom «Abraham» en lui-même, censé symboliser l’hospitalité du patriarche commun, porte une ironie amère : dans le récit biblique, l’héritage est inégal entre Isaac et Ismaël.
Pour les signataires arabes, Doha sonne comme un rappel brutal que le parapluie américain n’est pas automatique. Washington, épuisé par deux décennies d’engagements coûteux, n’a ni condamné fermement ni empêché la frappe israélienne. Cette ambiguïté érode la crédibilité de l’alliance.
Le résultat est une recomposition en cours : discussions discrètes sur des coopérations renforcées avec la Turquie, la Chine ou même la Russie ; recherche d’architectures de sécurité régionales indépendantes. Si elles se concrétisent, ces évolutions redessineront le paysage stratégique de la Méditerranée et du Sahel, accentuant la compétition entre grandes puissances.
Pour le Maghreb, la situation est délicate. Le Maroc, signataire des Accords, voit les gains économiques menacés par le coût politique de la normalisation. L’Algérie, critique depuis le départ, renforce son rôle diplomatique. La Tunisie, fragilisée, hésite. Partout, l’opinion publique s’impatiente et l’écart se creuse entre diplomatie officielle et sentiment populaire.
Au Sahel, trois effets se profilent. Réduction d’aides et d’investissements : si les bailleurs du Golfe recentrent leurs priorités sur leur sécurité intérieure, l’aide au développement ou les investissements pourraient diminuer. Propagation des narratifs radicaux : les groupes djihadistes utilisent déjà la rhétorique de la «trahison» de la cause palestinienne pour recruter. Multiplication de partenaires extérieurs : dans le vide laissé par l’Occident, la Russie, la Turquie et les compagnies militaires privées avancent, au prix d’une opacité accrue.
Le Sahel devient une zone-tampon entre le désordre méditerranéen et la profondeur du continent africain : instabilité migratoire, trafics, routes d’armes et de personnes peuvent être exacerbés par chaque secousse dans le Golfe.
A court terme, un statu quo tendu est le plus probable : accords maintenus, mais confiance brisée. A moyen terme, deux options se dessinent : soit une refondation stratégique exigeant des contreparties tangibles pour les Palestiniens et des garanties de souveraineté, soit un effritement progressif où chacun se retire sans l’avouer.
Pour éviter d’être emportés, les Etats du Maghreb et du Sahel peuvent diversifier leurs alliances et renforcer leur résilience interne, miser sur un multilatéralisme régional (Union africaine, coopération Maghreb-Sahel) et afficher clairement leurs lignes rouges (souveraineté, frappes extraterritoriales).
Sous la tente d’Abraham, chacun croyait trouver un abri. Cinq ans plus tard, l’abri ressemble à une impasse et la foi commune s’effrite. Dieu peut être pour tous, mais si la confiance en l’autre disparaît, même le plus sacré des abris devient un lieu de méfiance. Pour le Maghreb et le Sahel, le moment est venu de ne plus subir les chocs des alliances à géométrie variable et de redevenir acteurs de leur propre sécurité.
A. B.