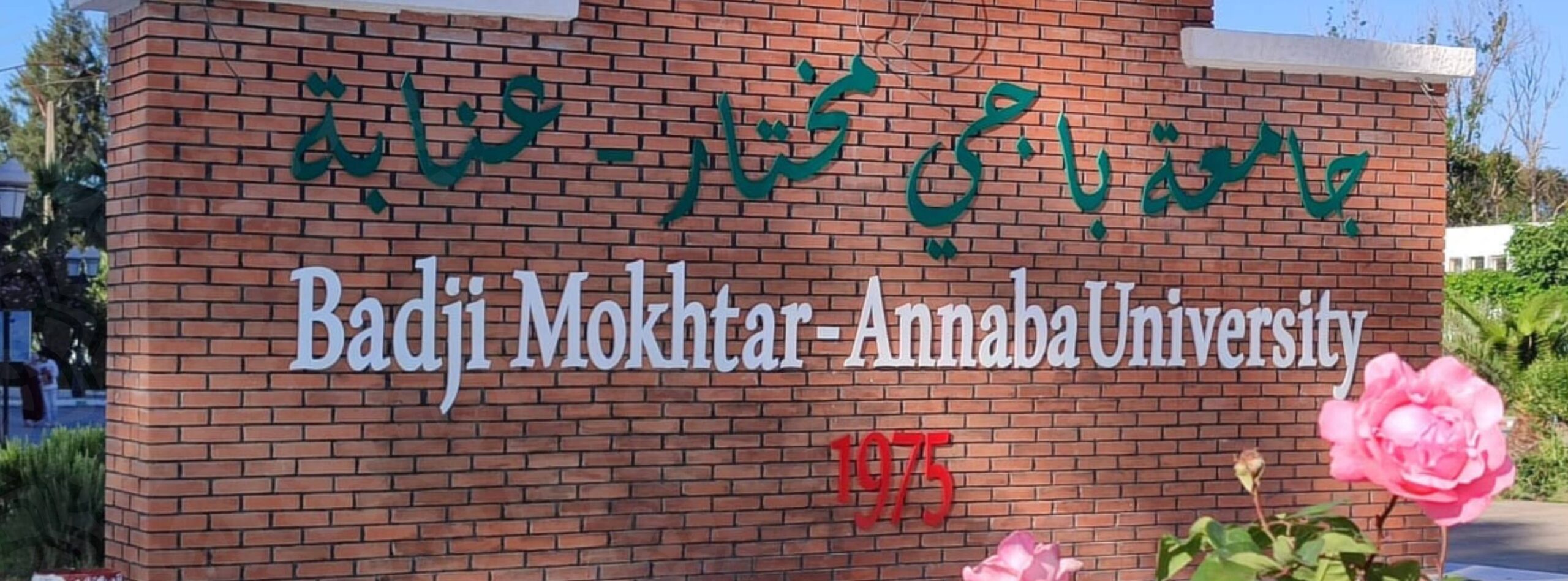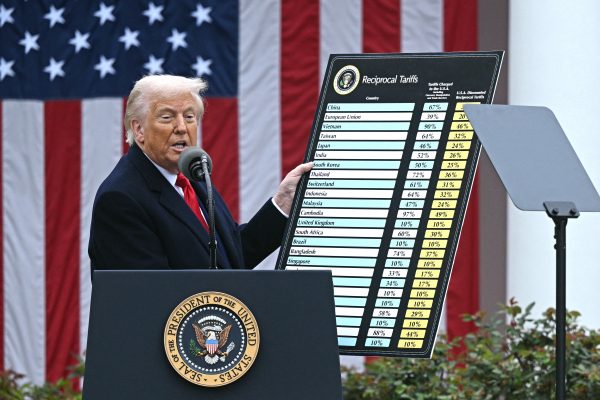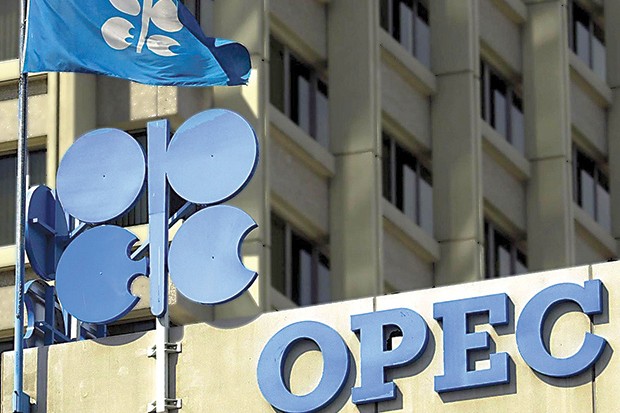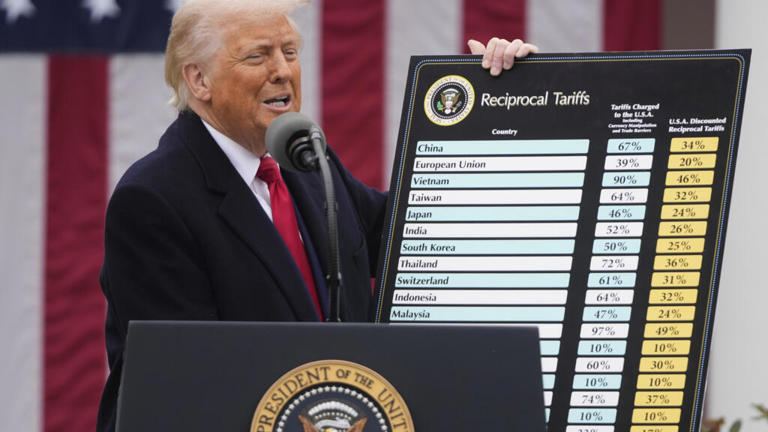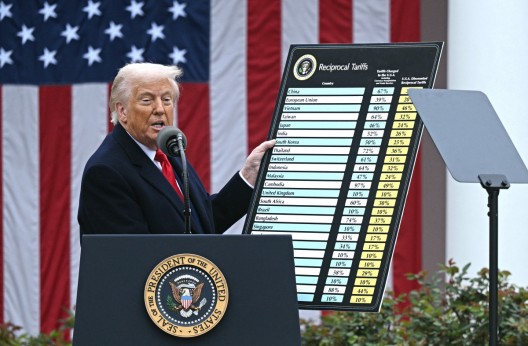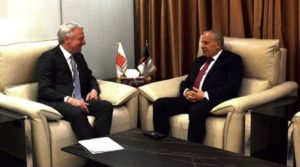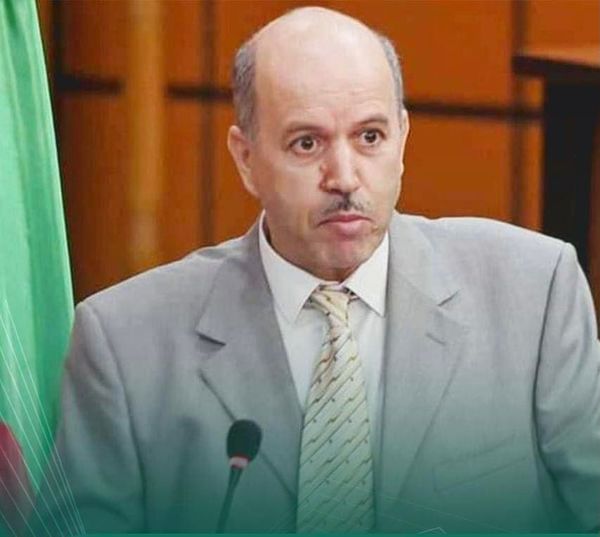Mémoire trahie, patrimoine confisqué : la réconciliation biaisée d’un comité sous influence politique (II)
Une contribution d’Ali Farid Belkadi – Certains analystes estiment que Macron cherchait à plaire à une frange d’électorat conservateur, voire... L’article Mémoire trahie, patrimoine confisqué : la réconciliation biaisée d’un comité sous influence politique (II) est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Une contribution d’Ali Farid Belkadi – Certains analystes estiment que Macron cherchait à plaire à une frange d’électorat conservateur, voire à désamorcer les demandes de reconnaissance mémorielle algérienne, en dépolitisant la colonisation, pour en faire un simple accident de l’histoire.
Une atteinte à la mémoire des résistants. Dire que la nation n’existait pas, c’est aussi insulter ceux qui ont résisté : l’Emir Abdelkader, Ahmed Bey, Lalla Fatma N’Soumer, les tribus du Dahra, les marabouts de Laghouat, ou les soulèvements des Aurès.
L’identité nationale n’est pas un décret d’Etat, c’est une construction lente, tissée de luttes, de cultures, de récits et de résistances, étalées sur des siècles et des millénaires. En cela, la colonisation n’a pas créé l’Algérie : elle l’a combattue.
«Dire que l’Algérie n’existait pas, c’est nier non seulement son histoire, mais aussi celle de ceux qui l’ont défiée.»
L’idée que l’Algérie n’aurait été qu’un espace vague avant 1830 est une thèse forgée au XIXe siècle, au moment même où la France défendait sa conquête face aux critiques humanistes. Dès les années 1840, des auteurs comme Adolphe Joanne ou Camille Rousset affirmaient : «Nous n’avons point conquis une nation, mais soumis des tribus errantes.»
C’est aussi ce que Jules Ferry, chantre de la colonisation, disait en 1885 à la Chambre des députés : «Nous avons en Afrique du Nord des terres sans peuples à donner à des peuples sans terres.»
Ces formules justifiaient la dépossession en prétendant qu’il n’y avait pas de propriétaires légitimes.
Revenons un instant à cette commission mixte franco-algérienne.
Mademoiselle Sid Cara passionaria de l’Algérie française
Cette situation est, en effet, révélatrice d’une mémoire sélective et d’une instrumentalisation persistante de l’histoire à des fins idéologiques. Le comité mixte d’historiens franco-algériens, censé œuvrer à une «réconciliation mémorielle», intègre des figures comme Jacques Frémeaux, dont les prises de position sur la colonisation sont loin d’être neutres. Le fait qu’il ait publiquement honoré Mademoiselle Sid Cara – personnalité emblématique de l’Algérie française, engagée contre l’indépendance, et soutenant l’ordre colonial – en demandant son admission au Panthéon français, en dit long sur la vision de l’histoire que cet historien, né à Alger, défend.
Quant à la focalisation quasi obsessionnelle de certains historiens sur les violences de juillet 1962 – notamment celles visant les pieds-noirs de l’OAS et certains juifs accusés de collaboration –, elle révèle une difficulté à contextualiser ces événements dans l’ensemble du processus de décolonisation, marqué par une violence coloniale multiséculaire.
Ces épisodes sont tragiques, mais leur mise en avant sélective, sans rappeler les décennies de répression depuis 1830, de dépossession, de racisme institutionnel et de massacres perpétrés par le régime colonial, revient à inverser les responsabilités et les mauvais rôles historiques.
Ce déséquilibre est d’autant plus problématique que les victimes algériennes, elles, sont souvent passées sous silence ou réduites à des statistiques. Et le comité, au lieu de rétablir un équilibre mémoriel, semble parfois valider une lecture nostalgique et partielle du passé. Une mémoire sélective circonscrite au seul XIXe siècle.
Un patrimoine algérien majeur reste confiné dans l’oubli
Alors que la France et l’Algérie affichent une volonté de réconciliation mémorielle, le comité mixte d’historiens chargé de cette mission semble reconduire des logiques coloniales. Derrière les discours convenus, un patrimoine algérien majeur reste confiné dans l’oubli des musées français, sans restitution ni reconnaissance.
Pendant ce temps, un autre pan essentiel de la mémoire algérienne reste ignoré, celui du patrimoine spolié.
Depuis 1830, la France a méthodiquement confisqué, expédié, classé puis oublié des milliers d’objets, manuscrits, stèles, crânes, pierres votives, statues, bijoux, manuscrits, objets cultuels et documents historiques algériens. Rien n’est plus révélateur de cette dépossession que le silence qui entoure leur sort dans les institutions françaises.
La liste des maraudages français
Liste (non exhaustive) du patrimoine algérien oublié ou confisqué.
Les stèles phéniciennes de Constantine (site d’El-Hofra) : plusieurs centaines de stèles votives puniques, retrouvées intactes, expédiées au Louvre sous la colonisation. Non étudiées à ce jour, elles dorment dans les réserves, empaquetées dans du plastique, filmées par moi en exclusivité.
Les crânes de résistants algériens : exposés pendant plus d’un siècle au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, dans une salle d’anthropologie raciale, plus de 400 crânes ont été recensés, dont certains clairement identifiés comme appartenant à des chefs de guerre, prisonniers exécutés. Seule une poignée a été restituée en 2020, dans un geste partiel. La majorité demeure en France, conservée dans des armoires métalliques, à l’abri des regards et des chuchotements.
Le tombeau des rois numides : en grande partie pillé, ses inscriptions, objets funéraires et éléments architecturaux ont été transférés au Louvre ou à Saint-Germain-en-Laye. Certains objets ont même été vendus à des collectionneurs privés au XIXe siècle.
Les manuscrits de la Zaouïa de Tamezguida et de Tolga : pillés par l’armée française au XIXe siècle, notamment lors des campagnes contre les confréries, ces manuscrits (corans enluminés, traités de médecine, soufisme, droit malékite) ont été intégrés dans des collections françaises ou dispersés.
Les météorites du Sahara algérien : plusieurs fragments rares collectés dans les années 1930–50 par des géologues militaires sont conservés dans les collections du Muséum. Certains, comme la météorite de Tamentit, sont exposés, d’autres restent invisibles.
Les objets cultuels des Aurès et du Hoggar : bijoux en argent, outils chamaniques, tambours de transe, objets sacrés, offrandes funéraires, statues préislamiques. Nombre de ces objets ont été saisis ou échangés sous la menace durant les campagnes militaires du Second Empire et sont aujourd’hui dans les musées de Lyon, Marseille et Paris.
Les gravures rupestres du Tassili : des calques originaux effectués par les missions françaises (Lhote et Brenans, devenus ce qu’ils sont grâce aux éclaireurs Touaregs) n’ont jamais été rendus. Certains ont été vendus à l’étranger. Le fonds photographique est détenu en grande partie par des institutions françaises.
Le fonds Cid Kaoui : dictionnaires et manuscrits publiés à compte d’auteur par l’un des plus grands linguistes algériens de l’époque coloniale, jamais valorisés ni réédités. Ses originaux sont conservés dans des tiroirs universitaires.
Les stèles libyco-puniques bilingues de Dougga et Cirta : uniques pour la compréhension des langues anciennes d’Afrique du Nord, elles ont été transférées en France ou mutilées. Je n’ai pas pu mettre la main dessus, on me dit que le musée du Louvre n’en détenait pas. D’anciens archéologues ont prétendu le contraire.
Objets liturgiques confisqués dans les mosquées : chandeliers, manuscrits coraniques, portes en bois sculpté, minbars entiers ont été démantelés après 1830 et envoyés en France. Avant la transformation de ces prestigieuses mosquées en écuries par l’armée coloniale.
Une mémoire enfermée
Aucun de ces éléments n’est intégré aux travaux du comité mixte. Aucun plan de restitution global n’a été proposé. L’Algérie n’est ni consultée, ni associée à la gestion de ce patrimoine. Cette confiscation matérielle redouble la confiscation mémorielle.
Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas une simple restitution de biens, mais la reconnaissance d’un pillage structurel.
Comment parler de réconciliation quand les voix algériennes sont tues, les objets algériens retenus, les résistants algériens qualifiés de «droits communs», et que l’on propose au Panthéon Mademoiselle Nafisa Sid Cara, figure politique de la IVe République et fervente partisane de l’Algérie française, qui s’opposa farouchement à toute idée d’indépendance ? Alliée à Mme Massu, elle a œuvré sous la IVe République française de toutes ses forces au maintien de la domination coloniale en Algérie.
Il ne s’agit pas de vengeance, mais de vérité. Une vérité faite de noms, de voix, d’objets, de récits et de silences. Elle exige autre chose que des commissions menées par Panurge, elle requiert le courage politique de réparer, de reconnaître et de restituer.
Des promesses diplomatiques au goût amer de faux-semblant
Alors que le discours officiel évoque une réconciliation mémorielle entre la France et l’Algérie, une part essentielle de cette mémoire reste délibérément occultée : celle des objets, stèles, manuscrits, restes humains et savoirs pillés pendant plus d’un siècle, toujours enfermés dans les réserves des musées français. Derrière les promesses, un silence persistant.
Il y a, dans certaines promesses diplomatiques, un goût amer de faux-semblant. Le comité mixte d’historiens créé pour travailler à la «réconciliation des mémoires» entre la France et l’Algérie prétend établir un dialogue équilibré. Mais ce comité, dans sa composition comme dans ses angles d’analyse, reconduit en sourdine une vision asymétrique de l’histoire. Plusieurs de ses membres, historiens français issus des cercles académiques parisiens, adoptent des perspectives qui minimisent, voire justifient par omission, le système colonial.
Cette proposition, faite au nom de la parité ou de la diversité, vient en réalité légitimer un récit colonial inversé, où les victimes deviennent suspectes et les soutiens de l’ordre établi sont présentés comme des modèles.
Mais l’angle le plus préoccupant de cette réconciliation mémorielle tronquée reste sans doute la question du patrimoine algérien spolié. Car si les archives sont partiellement ouvertes et si les mots circulent dans les colloques, les objets, eux, ne reviennent pas.
Des milliers d’artefacts, stèles, manuscrits, pièces archéologiques, restes humains, objets religieux ou scientifiques, sont encore aujourd’hui conservés en France, invisibles, muets, niés.
Réparer une injustice historique fondée sur le vol
L’ensemble de ce patrimoine – matériel, scientifique, linguistique, humain – constitue une mémoire confisquée.
Une mémoire que les discours officiels n’effleurent que du bout des lèvres, quand ils ne l’ignorent pas sciemment. Le comité mixte n’a, à ce jour, proposé aucun plan de restitution, aucune commission d’experts chargée de dresser l’inventaire de ces objets, aucun calendrier de retour ou de mise à disposition numérique pour les chercheurs algériens.
Parler de réconciliation sans aborder ces biens confisqués revient à ne traiter que la surface du problème. Car il ne s’agit pas seulement de faire dialoguer deux lectures du passé ; il s’agit de réparer une injustice historique fondée sur le vol, l’effacement et la dépossession culturelle.
La mémoire n’est pas une abstraction. Elle vit dans les pierres gravées, dans les manuscrits endormis, dans les objets que les ancêtres touchaient, dans les têtes que l’on expose ou que l’on enferme. La France, qui prétend honorer les arts et les civilisations, doit désormais choisir entre la conservation d’un butin et la dignité d’un dialogue sincère.
Crânes de résistants algériens : le silence des boîtes à chaussures
Parmi les chapitres les plus glaçants de ce patrimoine spolié figure celui des restes humains, conservés jusqu’à nos jours dans les réserves du Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Il s’agit de crânes de résistants algériens, décapités durant les campagnes de conquête au XIXe siècle, transportés en France comme trophées, puis répertoriés à des fins anthropométriques.
Plusieurs centaines de ces crânes, j’ai pu personnellement les répertorier et les documenter grâce à la base de données du MNHN. Je me suis appuyé sur une trentaine de lettres officielles, datées de 1850 à 1880, archivées au Muséum même et publiée en annexes dans mon livre Boubaghla, le sultan à la mule grise, la résistance des Chorfas. Elles émanent de collectionneurs, d’agents coloniaux ou de donateurs, qui y désignent clairement les têtes envoyées comme appartenant à des prisonniers de guerre, à des chefs de tribus insurgés, à des figures reconnues de la résistance algérienne. Ces lettres mentionnent les noms, les lieux, les dates d’exécution, les circonstances de la capture. Certaines évoquent explicitement des insurrections contre l’armée française. Le caractère militaire et politique de ces exécutions ne fait aucun doute.
Et pourtant, dans une déclaration accordée au New York Times, Bruno David, alors président du MNHN, a affirmé que ces crânes ne seraient pour la plupart que ceux de «voleurs» ou de «droits communs». Une négation sèche, sans fondement documentaire, opposée aux preuves tangibles que j’ai publiées. Les lettres d’archives, authentifiées, montrent le contraire. Elles attestent de la violence coloniale, des actes de torture et des bastonnades infligés à ces résistants, de la pratique des décapitations et de leur usage dans un système pseudo-scientifique racialisant.
Plus grave encore : ma lettre de mise au point envoyée au New York Times, contenant les preuves précises, les sources, les extraits de ces lettres, n’a jamais été publiée. Le journal n’a pas daigné répondre, ni donner suite à cette demande élémentaire de droit de réponse. Bruno David, de son côté, n’a jamais démenti les informations contenues dans cette lettre. Son silence a valeur d’aveu.
Ces hommes, combattants pour la liberté de leur peuple, ont été tués une première fois. Puis décapités. Transportés. Exposés. Enfin, pour finir, relégués dans des armoires métalliques, enfermés dans des boîtes à chaussures, comme des spécimens. Parmi eux, 80 têtes de résistants de Za’atcha (Biskra) auquel on inflige une seconde mort : l’effacement de leur identité, la négation de leur combat, le travestissement de leur histoire.
Il ne s’agit pas ici d’un débat académique. Il s’agit de la dignité des morts, de la justice due aux vivants, et de la mémoire que l’on refuse de restituer.
Contre les principes éthiques universels établis
Le principe universel de dignité humaine et le droit international n’autorisent pas la conservation indéfinie de restes humains, surtout lorsqu’ils appartiennent à des combattants identifiés, cela va à l’encontre des principes éthiques établis, notamment par l’Unesco et la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’Homme (2005). Ce n’est pas seulement une affaire algéro-française, mais une question de respect universel des morts.
Il faut souligner aussi que malgré l’émotion suscitée par la restitution de quelques crânes en 2020, aucun effort sérieux n’a été engagé en cinq ans pour restituer l’ensemble des restes documentés. Le contraste entre la communication politique et l’inaction réelle est criant. Cette inertie démontre que la reconnaissance est encore conditionnelle et parcellaire.
Tout cela vient renforcer l’idée que l’on cherche à garder en France ce dossier définitivement sous contrôle.
En France, la résistance à l’occupant est célébrée, honorée
Il faut dénoncer un double discours. En France, la résistance à l’occupant nazi est célébrée, honorée – à juste titre.
Pourquoi cette dignité ne s’appliquerait-elle pas aux résistants algériens, morts pour leur liberté ? Quelle vérité historique cherche-t-on encore à fuir ?
Quel héritage la France souhaite-t-elle transmettre : celui du silence et du déni, ou celui de la justice et de la reconnaissance ? L’Algérie n’est pas un silence entre deux empires. Elle est la toile de fond d’une mémoire active, souvent éclipsée, mais toujours vibrante. Omniprésente ».
A.-F. B.
Historien, anthropologue
(Suite et fin)
L’article Mémoire trahie, patrimoine confisqué : la réconciliation biaisée d’un comité sous influence politique (II) est apparu en premier sur Algérie Patriotique.