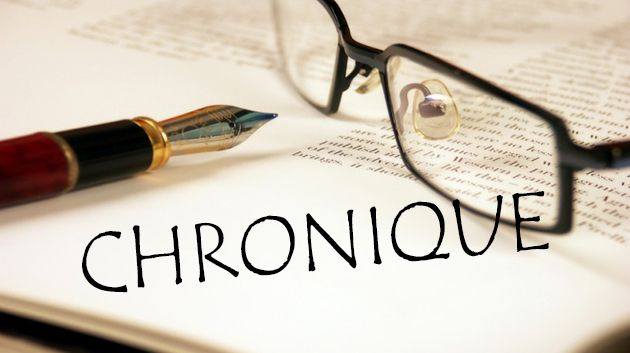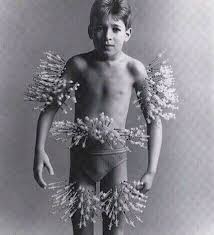Virage vert européen en 2030 : l’Algérie face au piège énergétique américain
Une contribution de Benyoucef Bedouani – Alors que l’Union européenne accélère sa transition post-carbone, les majors américaines Chevron et ExxonMobil... L’article Virage vert européen en 2030 : l’Algérie face au piège énergétique américain est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Une contribution de Benyoucef Bedouani – Alors que l’Union européenne accélère sa transition post-carbone, les majors américaines Chevron et ExxonMobil se positionnent agressivement sur les réserves gazières algériennes, notamment le gaz de schiste et les ressources offshore. Ce mouvement, paradoxal en apparence, s’inscrit dans une stratégie géoéconomique visant à affaiblir la Russie comme fournisseur de l’Europe et à arrimer l’Algérie à l’architecture énergétique transatlantique. Pour Alger, l’enjeu est crucial : transformer ces investissements en leviers de développement souverain ou céder, par des clauses contractuelles asymétriques, une partie de son autonomie stratégique.
«Un peuple qui défend sa dignité et sa liberté est invincible» (Nelson Mandela, Rivonia, 1964).
L’Union européenne a fixé des objectifs ambitieux : réduire la consommation de gaz de 35% d’ici 2030 et de 90% à l’horizon 2045, conformément au Green Deal européen (1) et au plan REPowerEU (2). Cette trajectoire, si elle est respectée, marginalisera les combustibles fossiles dans le bouquet énergétique. Mais dans l’immédiat, Bruxelles affronte des contraintes lourdes : retards du nucléaire, limites technologiques de l’hydrogène vert, déficit d’interconnexions électriques. L’Agence internationale de l’énergie souligne ainsi que le gaz restera indispensable à la stabilisation des réseaux au moins jusqu’au milieu des années 2030 (3).
C’est dans cette fenêtre stratégique, de 2025 à 2035, que Washington entend projeter ses champions pétroliers. Chevron et ExxonMobil, déjà présents dans le bassin d’Ahnet et sur des permis offshore, parient sur une production opérationnelle nécessitant 7 à 10 ans d’investissements, conformément aux standards observés dans l’industrie mondiale (4, 5). Le calcul est clair : profiter du temps que mettra l’Europe à verdir réellement son mix énergétique pour substituer le gaz russe par du gaz «sous influence américaine», en plaçant l’Algérie au cœur de cette redéfinition.
Or, au-delà de la géopolitique, l’exploitation du gaz de schiste pose une question brûlante de légitimité intérieure. Déjà en 2015, les manifestations massives d’In Salah avaient dénoncé les risques de contamination des nappes phréatiques et les atteintes irréversibles aux écosystèmes sahariens. La contestation sociale face à ces projets souligne un point central : la souveraineté énergétique ne peut se concevoir contre le peuple. Une politique qui ignorerait ces résistances populaires fragiliserait sa propre base de légitimité.
La stratégie américaine d’ancrage en Méditerranée
L’Algérie dispose d’infrastructures d’exportation stratégiques : TransMed vers l’Italie, Medgaz vers l’Espagne, et GME. Ces corridors font du pays un pivot énergétique incontournable. Pour Washington, l’entrée de Chevron et ExxonMobil dépasse la logique commerciale. Elle vise à verrouiller l’axe Algérie-Europe du Sud, consolider l’influence américaine en Méditerranée et contrer toute perspective d’alliance énergétique concurrente, qu’elle soit portée par les BRICS ou par l’OPEP+ (6, 7).
En multipliant les pressions diplomatiques et les partenariats industriels, les Etats-Unis cherchent à inscrire l’Algérie dans un dispositif transatlantique où sa marge de manœuvre serait réduite. La diplomatie énergétique se mue ainsi en instrument de projection d’influence, liant les choix énergétiques algériens aux équilibres stratégiques de l’OTAN et de l’UE.
Clauses contractuelles : un piège pour la souveraineté
L’entrée des majors américaines comporte un risque central : l’imposition de clauses contractuelles asymétriques qui limitent la souveraineté énergétique. Trois catégories sont particulièrement sensibles.
Les Priority Export Rights et les Take-or-Pay Provisions peuvent réduire la flexibilité du pays : Alger serait contraint d’honorer en priorité ses engagements extérieurs, même en cas de crise intérieure (8). Les Stabilization Clauses verrouillent la fiscalité et la réglementation environnementale : toute décision de relever les impôts sur les hydrocarbures ou d’imposer des normes plus strictes pourrait obliger l’Etat à indemniser les compagnies (9). Enfin, les clauses d’arbitrage international, souvent placées sous juridiction étrangère (Paris, Londres, Genève, ICSID), délocalisent les contentieux hors du champ souverain. A cela s’ajoutent les clauses de confidentialité, qui limitent l’accès du Parlement et de la Cour des comptes, et l’absence fréquente de mécanismes contraignants de transfert de technologies.
Sans correctifs, Sonatrach risque d’être reléguée au rôle de simple opérateur technique, dépendant des financements et du savoir-faire étrangers. A l’inverse, une architecture contractuelle souveraine devrait inclure un droit de rétention des volumes en cas de besoin domestique, un contrôle majoritaire des infrastructures logistiques, des transferts technologiques obligatoires et des clauses de rupture en cas de désalignement stratégique. Ces garde-fous constituent la condition minimale d’un partenariat équilibré.
Mais ces contraintes externes se conjuguent à des fragilités internes, qui accentuent les risques d’un partenariat déséquilibré.
Pressions internes et vulnérabilités structurelles
L’équation est compliquée par la vulnérabilité de l’économie nationale. Malgré une croissance hors hydrocarbures de 4,8% en 2024 (10), le pays reste exposé à la volatilité des prix, aux déficits budgétaires, aux sécheresses et aux tensions sociales. Dans ce contexte, une dépendance accrue aux majors américaines pourrait accentuer la fragilité budgétaire, notamment si les revenus du gaz de schiste sont captés par des contrats déséquilibrés ou arrimés à des marchés spot instables (11).
Cette fragilité interne rend cruciale la nécessité de conditionner tout partenariat à des retombées tangibles pour le tissu productif national. A défaut, l’Algérie risquerait d’échanger une rente immédiate contre un affaiblissement stratégique durable.
Alternatives et doctrine de souveraineté verte
L’Algérie dispose pourtant de marges de manœuvre. Depuis 2022, elle a lancé un programme solaire de 1 000 MW avec Shaems, en partenariat avec des groupes allemands et chinois (12). Elle développe des corridors d’hydrogène vert avec ENI (via la Sicile) et H2Global (dans les Hauts-Plateaux), ainsi qu’un projet d’interconnexion électrique sous-marine avec l’Espagne (MEDREG) (13).
Ces initiatives élargissent l’espace de négociation. Mais elles doivent s’inscrire dans une doctrine explicite de souveraineté énergétique, imposant des contreparties industrielles (usines locales, emplois qualifiés), des transferts technologiques, des obligations de formation nationale et des normes environnementales strictes. Faute de cette doctrine, les projets verts risquent de se diluer dans une logique d’assistance technique sans véritable impact stratégique.
Conclusion : souveraineté héritée, souveraineté à défendre
L’enjeu pour l’Algérie n’est pas de choisir entre Chevron et ExxonMobil, mais de définir le cadre de ses partenariats. Les investissements étrangers peuvent être utiles, mais seulement s’ils sont enchâssés dans une gouvernance transparente, associant institutions de contrôle et société civile.
A l’ère du virage vert européen, chaque clause contractuelle pèsera pour des décennies. Si l’Algérie impose ses conditions de souveraineté, elle consolidera sa position de pivot énergétique indépendant en Méditerranée. Si elle cède aux pièges contractuels, elle risque de devenir un simple relais des intérêts transatlantiques.
La souveraineté énergétique, prolongement naturel de la souveraineté politique conquise en 1962, doit aujourd’hui se défendre par la transparence et le droit. C’est moins un choix qu’une exigence vitale. Car, au-delà des ressources, il s’agit de dignité nationale et de survie géopolitique.
B.-Y. B.
Références :
1) Commission européenne, The European Green Deal, COM(2019) 640 final.
2) Commission européenne, REPowerEU Plan, 2022.
3) International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2023.
4) Mihályi, D., The Long Road to First Oil, Kiel Institute, 2021.
5) Deloitte, Time-to-First-Gas Benchmarks in MENA, 2022.
6) Bloomberg, Algeria Nears Deals With Exxon and Chevron in Shale Gas Push, mai 2023.
7) U.S. Department of Energy, Strategic Outlook on Mediterranean Energy Corridors, 2024.
8) ResourceContracts.org, Oil & Gas Contracts Database (consulté en 2024).
9) International Monetary Fund (IMF), Stabilization Clauses and Their Fiscal Impact, 2023.
10) Banque d’Algérie, Bulletin économique trimestriel, 2024.
11) World Bank, Country Economic Memorandum: Algeria, 2024.
12) Ministère de la Transition énergétique algérien, Plan solaire Shaems 1 000 MW, 2023.
13) MEDREG, North Africa–Europe Interconnection Study, 2023.
L’article Virage vert européen en 2030 : l’Algérie face au piège énergétique américain est apparu en premier sur Algérie Patriotique.