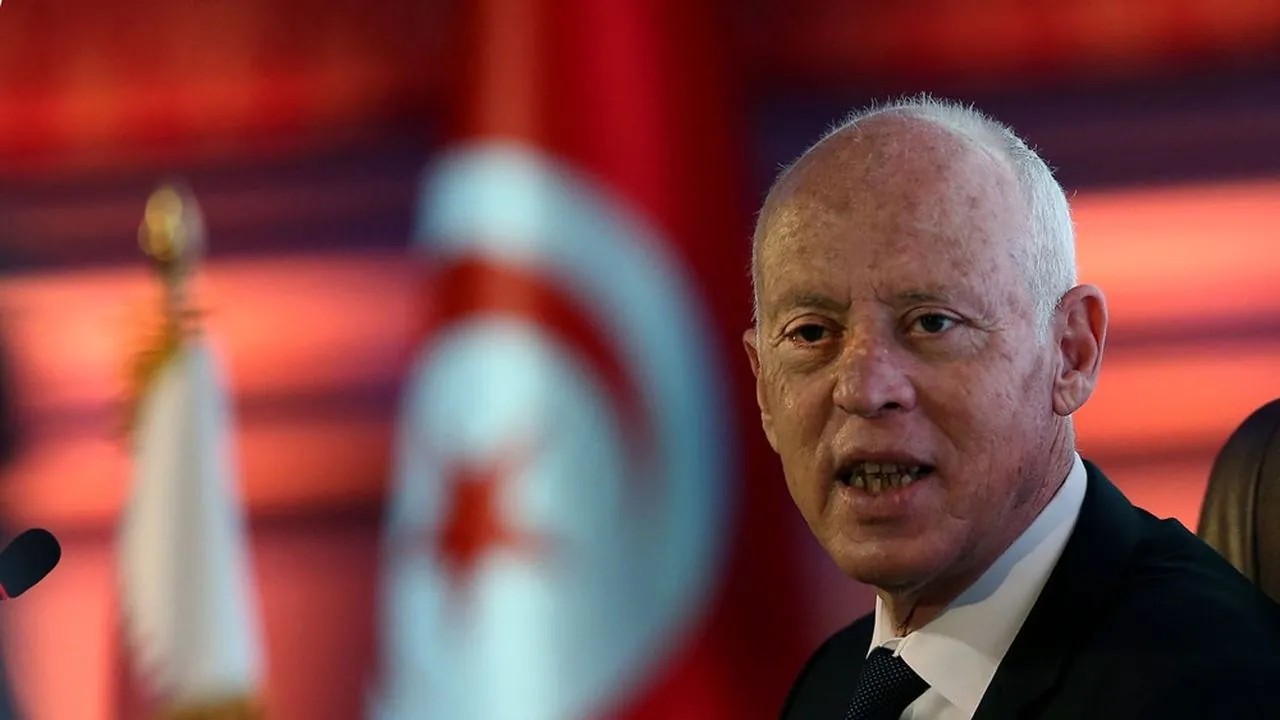Allocation touristique : pourquoi la mesure ne fait pas reculer le marché parallèle
Une semaine après l’entrée en vigueur du nouveau montant du droit au change touristique (750 € par adulte et 300 € par adolescent), la ruée redoutée n’a pas eu lieu. Après l’afflux des premiers jours, les agences bancaires sont redevenues calmes. Quant au marché parallèle, il s’est adapté en quelques heures, catapultant à nouveau l’euro au-dessus des […]

Une semaine après l’entrée en vigueur du nouveau montant du droit au change touristique (750 € par adulte et 300 € par adolescent), la ruée redoutée n’a pas eu lieu. Après l’afflux des premiers jours, les agences bancaires sont redevenues calmes. Quant au marché parallèle, il s’est adapté en quelques heures, catapultant à nouveau l’euro au-dessus des 260 DA.
C’est désormais presque une certitude : les gros cambistes ont volontairement bridé l’offre pour faire remonter les cours. Une semaine après l’entrée en vigueur du nouveau droit au change touristique, l’euro s’échange toujours autour de 262 DA au marché parallèle, contre 160 DA au taux officiel. Plus qu’un choc monétaire, cette mesure révèle surtout la faiblesse du pouvoir d’achat et la lente, difficile reconstitution d’une classe moyenne laminée par des années d’inflation.
Une semaine après son lancement, le nouveau dispositif d’allocation touristique n’a pas provoqué la bousculade que beaucoup imaginaient ou redoutaient. Passé les trois premiers jours, la fréquentation des agences bancaires est vite retombée, comme nous avons pu le constater ce matin dans plusieurs agences d’Alger.
En plein été, on s’attendait à ce qu’un tel mécanisme fasse baisser la pression sur le marché parallèle et entraîne une chute du cours de l’euro. Il n’en est rien : après un modeste repli d’environ 2 %, la monnaie européenne est vite revenue à son niveau d’avant, autour de 262 dinars au marché parallèle, contre 160 dinars au taux officiel. Soit un écart de près de 64 %.
Dans les coulisses d’un marché résistant
À El Eulma, dans une petite supérette connue pour être l’un des épicentres du change parallèle, nous abordons un quadragénaire chétif mais d’une énergie fébrile, rivé à deux téléphones “hatba”, ces vieux modèles intraçables. « À combien tu achètes l’euro ? Je prends tout », lâche-t-il d’emblée, sans même chercher à savoir combien nous avons à proposer. Un appel le coupe aussitôt ; nous prêtons l’oreille, bien malgré-nous… « Achetez tout, et si les dinars te manquent appelle Zoubir, il prendra l’autre moitié. Rani ngoulek : achète, achète tout ce que tu peux. Je prends à 258 !» Quelques secondes plus tard, nous prenons congé, invoquant la nécessité de consulter notre «associé».
Même ambiance à Alger, dans le quartier de Messonier comme au Square : les cambistes retiennent volontairement une partie des devises achetées. Pris de court par la mise en place du nouveau droit au change, ils s’étaient retrouvés avec des stocks payés à 263/264 DA ; la chute à 255 leur faisait perdre des milliards. Leur parade ? La moyenne pondérée : racheter massivement, raréfier l’offre et forcer la remontée des cours. Une stratégie qui, selon un employé d’une agence bancaire de la rue de la Liberté, devrait durer quelques jours, le temps d’absorber les pertes. « Ils continuent de déposer beaucoup de devises sur leurs comptes, mais leurs retraits quotidiens ont nettement diminué », précise-t-il.
Une demande légale bridée par la faiblesse des revenus
Derrière ce paradoxe, une évidence : le pouvoir d’achat, bien plus que la mesure, limite l’accès aux devises. Pour un adulte, obtenir 750 € au guichet suppose de mobiliser près de 120 000 DA. Pour un couple avec deux adolescents, cela représente près de 336 000 DA (pour 2 100 €), sans compter les billets d’avion (200 000 à 280 000 DA). Autant dire que la majorité des ménages modestes et la classe moyenne inférieure ne peuvent pas suivre.
L’exception tunisienne
Autre facteur : le calendrier. Pour la première destination des Algériens, la Tunisie, la plupart des séjours sont bouclés dès le printemps. Les agences de voyages, attirées par des tarifs plus avantageux, règlent alors les hôtels en euros ou en dinars tunisiens obtenus auprès des cambistes frontaliers. Quand le nouveau dispositif est finalement entré en vigueur, la majorité des familles avaient déjà payé leurs vacances et pris la route, souvent par le moyen le moins coûteux : le bus. Résultat : cette allocation arrive trop tard pour eux… peut-être sera-t-elle davantage sollicitée l’an prochain, si la mesure est maintenue.
Une prévisiond’un demi-milliard de dollars
Et si, malgré tout, un million d’Algériens en profitaient d’ici la fin de l’année ? 500 000 adultes utilisant leur quota complet de 750 € et autant d’adolescents (12 à 19 ans) bénéficiant de 300 €, cela représenterait 525 millions d’euros, soit 574 millions de dollars. C’est autant de réserves en moins, alors que le solde global de la balance des paiements affichait déjà un déficit de 2,77 milliards USD au premier trimestre 2025, selon les données publiées par la Banque d’Algérie. À ce rythme, les réserves de change pourraient retomber, d’ici fin 2025, autour de 60 à 62 milliards USD.
Une économie parallèle incontournable
La petite demande touristique ne représente qu’une fraction d’un marché parallèle dominé par le commerce informel, qui contourne les restrictions et pénuries, les importateurs qui financent sous-facturations et fraudes diverses, et l’épargne en devises, perçue comme plus sûre que le dinar. Les barrières directes ou indirectes à l’importation alimentent ce recours permanent aux devises hors circuit officiel.
Le pouvoir d’achat, un débat absent
En creux, ce nouveau droit au change agit comme un révélateur : la question centrale n’est pas uniquement monétaire mais aussi sociale. Avec un SNMG fixé à 20 000 DA, une inflation persistante et des salaires stagnants, la classe moyenne s’est réduite et peine à se reconstituer. Et tant que le débat sur la redistribution des richesses et l’amélioration du revenu ne sera pas ouvert, la hausse du PIB restera un chiffre abstrait pour la majorité des ménages algériens. Aujourd’hui, une grande partie des familles n’a tout simplement plus les moyens d’en profiter.
Par Larbi Ghazala