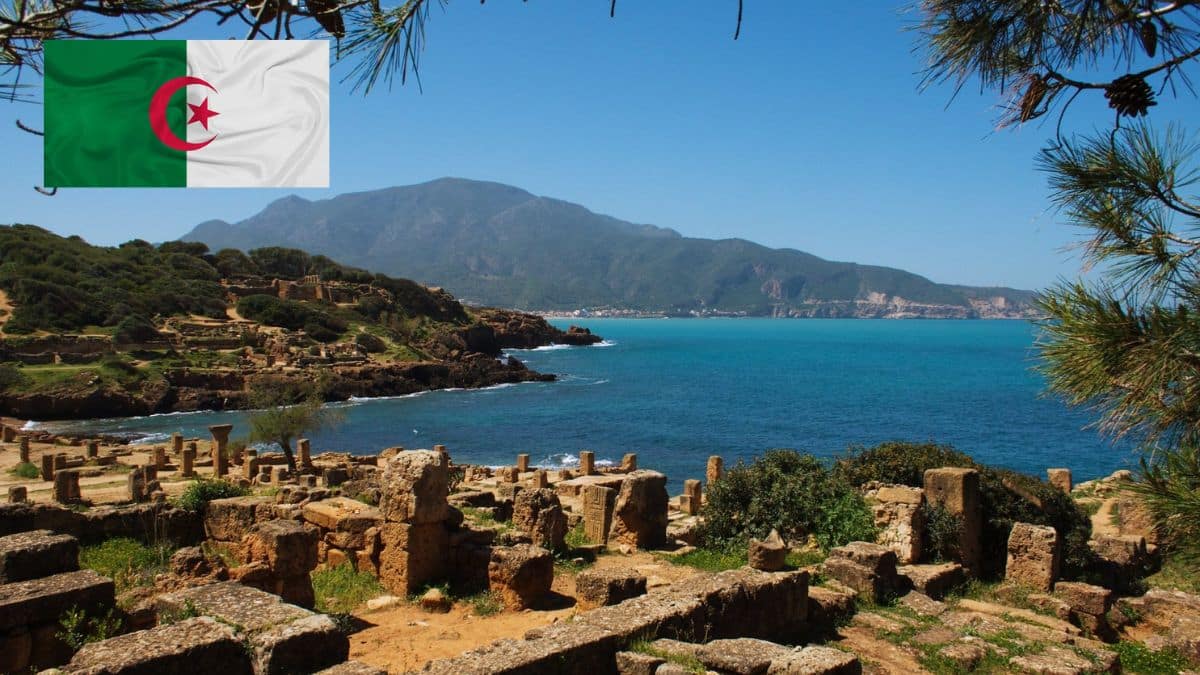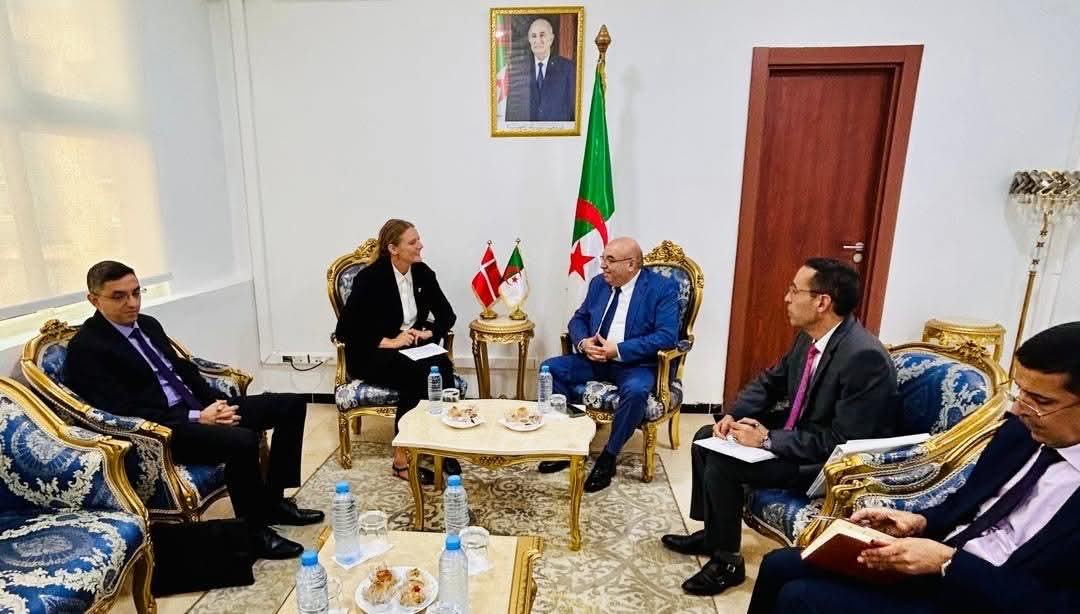Il y a 63 ans, l’Algérie indépendante gagnait la bataille de la première rentrée scolaire
Automne 1962, de part et d’autre de la Méditerranée. Soldats perdus d’une guerre perdue malgré la puissance des armes, les lois d’exception, la torture à grande échelle et le terrorisme, les chefs de l’OAS n’en finissent pas de ruminer leur ‘’nostAlgérie’’ et de pleurer le ‘’paradis perdu’’. Le lundi 15 octobre 1962, à leur grand […] The post Il y a 63 ans, l’Algérie indépendante gagnait la bataille de la première rentrée scolaire appeared first on Le Jeune Indépendant.

Automne 1962, de part et d’autre de la Méditerranée. Soldats perdus d’une guerre perdue malgré la puissance des armes, les lois d’exception, la torture à grande échelle et le terrorisme, les chefs de l’OAS n’en finissent pas de ruminer leur ‘’nostAlgérie’’ et de pleurer le ‘’paradis perdu’’.
Le lundi 15 octobre 1962, à leur grand dam, l’Algérie indépendante depuis trois mois a rendez-vous avec une échéance capitale de son histoire : la rentrée des classes. Heureux et enthousiastes, des centaines de milliers d’élèves matinaux franchissent les portes des écoles. C’est la première année scolaire à l’heure d’Al hamdoulilah mabkach istiîmar fi b’ladna.
Quand les directeurs des établissements scolaires rassemblent les élèves dans les cours dédiées aux récréations avant de les répartir à travers les classes, les généraux Salan et Jouhaud sont derrière les barreaux en région parisienne. Condamnés par contumace, les autres membres du commandement de l’organisation terroriste, les fuyards Jean-Jacques Susini, Pierre Lagallairde et Yves Godard sont réduits à l’exil clandestin entre l’Espagne, l’Italie et une contrée provinciale. Après avoir échoué à faire voler en éclats le cours des pourparlers puis des négociations – Evian I, Lugrin, Les Rousses, Evian II –, ils décrètent la ‘’politique de la terre brûlée’’.
Entre terrorisme au quotidien et actions de sabotage, leur stratégie terroriste vise la paralysie totale de l’Algérie indépendante. Si leurs commandos ‘’delta’’ endeuillent des centaines de familles, incendient la Bibliothèque universitaire et poussent au départ massif des Européens, Salan et ses alliés de l’’’Algérie française’’ ne parviennent pas à l’objectif suprême : empêcher l’Algérie indépendante de se mettre en ordre de marche.
A leur grand dam et au grand désespoir de tous ceux qui scrutent, en l’appelant de leurs vœux, les ratés de l’allumage moteur, la rentrée des classes 1962-1963 résonne comme la plus implacable des défaites. Le ‘’Jour d’Ecole’’ résonne, surtout, comme un temps à la fois fondateur et prometteur.
C’est la preuve que l’Histoire est en marche et que plus rien ne sera comme avant. Le 15 octobre 1962, l’Algérie indépendante a réussi l’un de ces tous premiers challenges et réussi l’un de ses premiers examens de passage. Confronté à un agenda des plus serrés et une conjoncture émaillée d’embûches, la République algérienne a été bel et bien au rendez-vous de la rentrée scolaire.
Les kiosques célèbrent la première rentrée
Alger Républicain, qui venait de reparaitre après une interdiction par les autorités coloniales, et Al Chaâb (Le Peuple) – quotidien nouvellement crée – sont heureux d’enjoliver les kiosques algériens de ‘’une’’ célébrant la première année scolaire de l’Algérie indépendante. Collectionneur d’imprimés et de de vieux journaux, Amar Sifi Yassi, un jeune enseignant de Annaba qui se prépare pour une formation d’archiviste, garde précieusement un numéro d’Alger Républicain. Acheté dans une brocante, cet exemplaire lui rappelle une rentrée des classes. Une rentrée inaugurale qui a précédé de longues années avant ses rentrées comme élève et futur enseignant.
Quelques semaines avant le 15 octobre 1962, rien ne laissait présager un début concluant pour la saison scolaire 1962-1963. Sous l’effet de la crise de l’été 1962 et les luttes fratricides pour le pouvoir, la période de transition s’est étirée au-delà des délais initiaux, retardant la proclamation de la République algérienne et la mise en place des institutions. Il va falloir attendre le 20 septembre et les élections à l’Assemblée nationale constituante pour voir le processus institutionnel s’accélérer et déboucher sur la proclamation de la République algérienne démocratique et populaire le 25 septembre.
‘’ On assiste alors à la formation d’embryonnaires ministères en charge de dossiers tous plus urgents les uns que les autres pour l’Algérie indépendante, rappelle l’historienne Malika Rahal dans « Algérie 1962. Une histoire populaire » (éditions La Découverte). Urgences parmi tant d’autres qui s’impose au premier gouvernement, ‘’organiser la rentrée scolaire et universitaire, pallier les départs de nombreux fonctionnaires français, relancer l’industrie et l’agriculture pour éviter une famine, définir une prise en charge sociale pour ceux qui sont dans le besoin’’.
Si la rentrée scolaire est une mission qui engage l’ensemble du gouvernement, un homme se retrouve au cœur du challenge : Abderrahmane Benhamida (1931-2010), ministre de l’Education nationale dans le premier gouvernement dirigé par Ahmed Ben Bella (27 septembre 1962-18 septembre 1963). Il hérite d’un portefeuille large qui englobe tous les paliers de l’enseignement : primaire, collège, lycée, technique et université).
Engagé dans la lutte de libération nationale quelques semaines après son déclenchement, il a été une des figures de proue de la Zone autonome d’Alger dirigée par Yacef Saâdi sous les auspices du premier CCE (Comité de coordination et d’exécution, issu du Congrès de la Soummam). Son cursus scolaire – élève du lycée franco-musulman de Ben Aknoun – en a fait un commissaire politique de la Zone et le chargé du ‘’Bulletin intérieur’’.
Arrêté en octobre 1957 au plus fort de la grande répression d’Alger dite ‘’bataille d’Alger’’ et au plus fort des ‘’pouvoirs spéciaux’’, il a été condamné à mort le 3 juillet 1958 par le tribunal permanent des forces armées d’Alger. Détenu à Barberousse (Serkadji), il a échappé à la guillotine après le moratoire décidé par la Ve République suivi de la grâce présidentielle pour l’ensemble des condamnés à mort.
De Serkadji, il a été transféré à Berrouaghia puis à l’Ile de Ré (Charente maritime). Il sera libéré après les accords d’Evian. Elu comme député à la première Assemblée nationale constituante, il se retrouve très rapidement sur la brèche comme ministre de l’Education, ministère de l’urgence s’il en est.
Les nuits blanches du ministre de l’Education
Sitôt nommé et avant même d’être installé, il prend la mesure de la difficulté de la mission : présider aux destinées d’un département ministériel à mettre en place en partant de rien. Sa responsabilité ministérielle, il le sait, est loin d’être une sinécure. Fort d’un état d’esprit de battant forgé durant les années de lutte, il s’engage dans une véritable course contre la montre.
Objectif avoué – il le soulignera dès ses premières prises de parole devant ses collaborateurs et face à la presse –, « gagner la bataille de la première rentrée scolaire ». Entre formation de son équipe, mise en place du premier embryon du Ministère, visites d’inspection des structures d’accueil et réunions de travail, il enchaîne les journées de travail quasiment au rythme du « H 24 ».
Habitué aux nuits blanches à l’heure des activités de la Zone autonome d’Alger ou durant les périodes de détention et les attentes anxiogène de l’aube – moment où les gardiens de Serkadji viennent chercher un condamné à mort pour l’emmener vers la cour de la guillotine –, Abderrahmane Benhamida a vécu une autre période ‘’nuits blanches’’.
Passionnantes celles-là – du 27 septembre au 15 octobre 1962 –, ces deux semaines marquées par un ‘’déficit en sommeil’’ l’ont vu vivre des jours parmi les beaux de sa vie et pour cause ! Avec le concours des services en rodage de l’Etat, il a réussi ce qui, au soir de l’été 1962, tenait bien de la mission impossible : éviter aux écoliers, lycéens et étudiants algériens une année blanche. Et apporter la preuve par les bambins que l’OAS n’a pas vaincu et l’Algérie indépendante n’a pas raté son allumage au démarrage.
En bon communicant – il a appris les rudiments de la communication à l’épreuve du militantisme nationaliste –, il a adopté un discours convaincant en direction des enseignants français qui ont quitté l’Algérie entre janvier et juillet 1962 sous les effets des menaces de l’OAS. « La valise ou le cercueil » a fait fuir la quasi-totalité des instituteurs français.
Le 12 octobre 1962, dans une allocution diffusée par la radio, Abderrahmane Benhamida a lancé un appel aux enseignants qui étaient de l’autre côté de la Méditerranée. S’adressant à ceux qui sont partis sous le coup des menaces de l’OAS et également à ceux qui ne connaissent pas le pays à venir ou revenir « contribuer à la magnifique œuvre d’éducation et de formation des jeunes esprits dans un climat de liberté et de fraternité ». « L’heure est venue de mettre votre énergie et votre compétence au service de l’Algérie nouvelle. Vous ne pouvez pas vous dérober à ce nouveau combat pour la paix et l’instruction ».
Urgence de la rentrée et besoins en ressource humaine obligent, le ministre de l’Education a également appelé les étudiants algériens à rester au pays. « Il n’y a aucune raison d’aller étudier dans une université étrangère, puisque votre université nationale est là.
Votre présence au sein de notre peuple est indispensable. Tout en étudiant, vous prendrez conscience des réalités algériennes et des difficultés qui, chaque jour, se présentent ». Le 15 octobre au soir, à l’heure d’un premier débriefing et un premier bilan avec ses collaborateurs, Abderrahmane Benhamida aux anges qui commente les indicateurs : 600 000 enfants pleinement scolarisés. Un chiffre inespéré au regard du contexte – gouvernement formé trois mois après l’indépendance –, les écoles ciblées par l’OAS et une année scolaire 1961-1962 inachevée en raison des menaces des soldats perdus.
The post Il y a 63 ans, l’Algérie indépendante gagnait la bataille de la première rentrée scolaire appeared first on Le Jeune Indépendant.