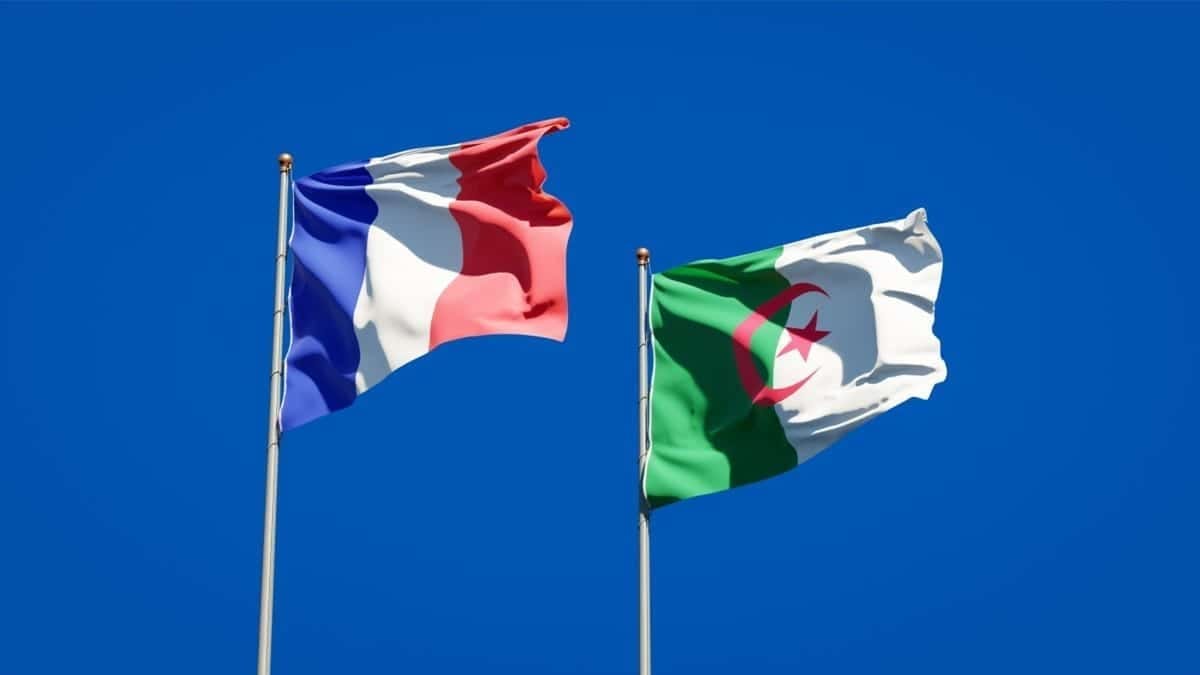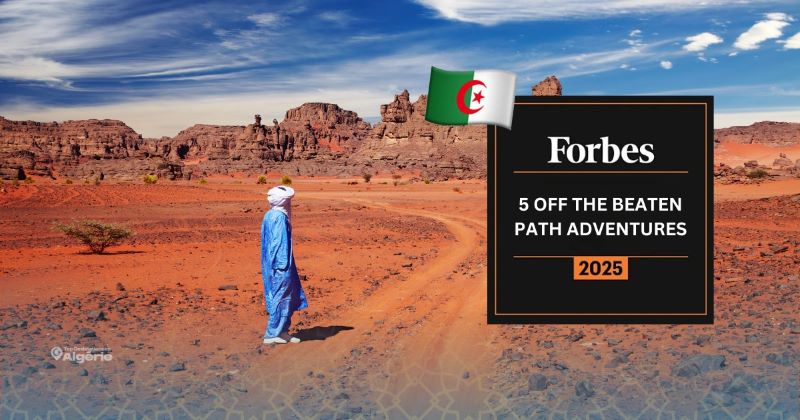« Aménorrhée » de Sarah Haïdar : une révolte contre le patriarcat et l’autoritarisme
Dans un territoire jamais nommé, où l’émancipation féminine se heurte à un mur de coercitions patriarcales, Aménorrhée, dernier roman de Sarah Haïdar, surgit comme un cri de révolte. Publié aux éditions Barzakh et chez Blast (France), ce troisième titre en français frappe par son audace et sa lucidité. L’anticipation y frôle le réel, dénonçant frontalement […] The post « Aménorrhée » de Sarah Haïdar : une révolte contre le patriarcat et l’autoritarisme appeared first on Le Jeune Indépendant.

Dans un territoire jamais nommé, où l’émancipation féminine se heurte à un mur de coercitions patriarcales, Aménorrhée, dernier roman de Sarah Haïdar, surgit comme un cri de révolte. Publié aux éditions Barzakh et chez Blast (France), ce troisième titre en français frappe par son audace et sa lucidité. L’anticipation y frôle le réel, dénonçant frontalement les systèmes phallocrates et totalitaires.
Dans ce régime orwellien, le corps des femmes n’est plus qu’un territoire de contrôle. L’avortement y est puni de la peine capitale, la pensée libre muselée et toute forme d’insoumission impitoyablement réprimée. La moindre incartade, aux yeux de l’ordre établi, devient subversion. C’est là que Sarah Haïdar place au cœur de son récit une figure de résistance, celle d’une accoucheuse, graine de rébellion. À travers elle, c’est donc toute une insurrection clandestine féministe, qui prend corps, scandée non par des slogans, mais par les chairs, les souvenirs et les traumatismes, « autant d’archives vivantes » que le régime ne parvient plus à bâillonner.
Sarah Haïdar compose ainsi une véritable galerie de personnages hauts en couleur et profondément marquants. On y croise la protagoniste, à la fois bienfaitrice et sadique, dont l’influence, comme souligné précédemment, s’étend bien au-delà de son rôle médical. Autour d’elle gravitent plusieurs êtres de papiers tout aussi singuliers, parmi lesquels sa fille aux penchants non genrés, une assistante meurtrie devenue vengeresse, un psychologue désabusé, ainsi qu’une geek infiltrée, figure de l’ombre. S’y ajoutent de nombreux préfets, notamment le mari de l’accoucheuse. Tous, qu’ils soient bourreaux ou victimes, voguent à l’aveugle dans les eaux troubles d’un pouvoir totalitaire où la morale religieuse sert de prétexte à la surveillance généralisée et où le progressisme n’est qu’un vernis craquelé dissimulant la brutalité du régime.
À cet égard, le lecteur devine que certains s’arrogent la vérité et tirent les ficelles d’un système qu’ils prétendent maîtriser. Mais d’autres, surtout des femmes éveillées à l’absurdité du monde qui les étouffe, décident, malgré elles, de briser les chaînes et de désobéir.
UN CRI LITTÉRAIRE CONTRE L’ORDRE PATRIARCAL
Ce qui saisit dans «Aménorrhée», c’est autant la force de la dénonciation que la manière dont elle se déploie, s’incarne pleinement au fil tranchant des mots. Son style ? Vibrant, disloqué, habité d’une urgence incantatoire. Cette tension se manifeste, de façon notable, dans les monologues intérieurs et les narrations, où les mots semblent déraper dans une sorte de « transe verbale lucide ». Son écriture oscille finement entre poésie et dissection, où chaque phrase semble extraite d’une plaie encore vive.
Le corps féminin, omniprésent, devient le théâtre d’une « guerre éternelle », réduit à ses fonctions reproductives, contrôlé, surveillé, cloué au pilori. Quant à la sexualité, telle qu’elle est décrite, page après page, elle est arrachée à toute velléité de décor, d’esthétisme, maintes fois nauséeuse, crue, quasi objectivée. De ce point de vue, Sarah Haïdar ose, bien entendu, dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. À l’opposé d’un voyeurisme « marchand », le sexe y devient d’ailleurs un « champ de bataille », terrain miné où s’affrontent Éros et Thanatos, analgésique versus dépossession.
Aménorrhée bouscule. Secoue. Griffe. Rien ici n’est attiédi. Les scènes de violence sont d’une intensité révoltante, les dialogues tendus comme des cordes prêtes à rompre et les images, d’une puissance symbolique inouïe. Nonobstant, jamais la violence n’est gratuite, cette dernière est, en fait, un outil de dévoilement, d’éveil. La littérature, chez Sarah Haïdar, est une torche dans la nuit, pas un ornement superficiel.
Dans cette même veine incisive, le roman dénonce la violence faite aux femmes — physique, symbolique, conjugale — et met en lumière l’illégalité dangereuse de l’avortement, la remise en question de l’assignation maternelle en révélant les contraintes, les injonctions et les ravages de la dépression post-partum.
À la croisée de la fiction et de l’engagement, ce roman pose des questions aussi urgentes que légitimes. En dénonçant la banalisation de la misogynie, l’autrice confronte le lecteur à « la réalité des féminicides », d’autant plus que le récit s’achève sur cette note tragique. Sarah Haïdar questionne ainsi les structures sociales, culturelles et judiciaires qui permettent à ces crimes de perdurer. Dans ce système sexiste, la justice applique ses règles à géométrie variable : tandis que les hommes peuvent être pardonnés, les femmes, elles, sont implacablement sanctionnées.
UNE ŒUVRE COUP DE POING, ENTRE LUCIDITÉ ET RÉVOLTE
Encore que l’avortement soit illégal dans ce récit, cette pratique s’effectue clandestinement, avec le consentement des femmes concernées. L’interdiction ne suffit donc pas à faire disparaître ce choix ; elle la rend simplement plus dangereuse. Enfanter n’est, par ailleurs, jamais présenté comme un geste allant de soi. Loin d’être une évidence biologique ou une vocation naturelle, l’acte de mettre au monde devient un enjeu fort problématique.
Le roman ne propose pas de solutions magiques. Il n’endort pas avec des uto-pies. Sarah Haïdar opte pour la lucidité, lecourage de regarder l’ennemi sans ciller. Et pourtant, dans cette nuit oppressante, une lumière persiste, à juste titre, c’est celle des féministes qui n’abdiquent jamais. Malgré la toute folie du monde et le retour perpétuel du même, leur lutte demeure, nécessairement, permanente.
L’un des grands mérites du roman, c’est d’éviter les raccourcis manichéens. Les hommes ne sont pas réduits à des caricatures. Tous, à leur manière, sont happés par l’engrenage d’un patriarcat tentaculaire, qui les broie autant qu’il aliène. Au demeurant, ce roman pulvérise la rhétorique masculiniste ambiante. Il montre à quel point elle est « creuse », « brutale » et « dénuée de style ». Il dévoile également le retournement toxique de certains hommes, qui se sentant menacés ou lésés, adoptent une posture encore plus violente.
Aménorrhée est aussi un roman rondement philosophique. Par l’entremise d’une analyse des dynamiques d’emprise autoritaire et de la spoliation du corps des femmes, le lecteur s’interroge sur l’aberration d’un contrôle totalitaire poussé à son paroxysme. Sarah Haïdar explore également les zones les plus sombres de l’expérience humaine pour en extraire l’absurdité. La psychothérapie, de son côté, n’a pas échappé à la critique. Sa présence semble davantage servir à souligner la vacuité ou l’inefficacité des discours « abstraits ou professionnels » face à la détresse humaine. Le temps circulaire, motif récurrent, fonctionne comme une allégorie de l’oppression, de la répétition des cycles de domination infligée aux femmes.
Avec Aménorrhée, Sarah Haïdar ne se contente pas d’écrire, elle tranche, elle exhume, elle fait tomber les masques. Son roman s’inscrit avec force dans une tradition de « littérature combattante », militante, qui n’a que faire du confort du lecteur. Elle ne cherche ni le consensus, ni l’adhésion. Elle exige. Elle dérange. En refusant toute forme de mollesse, elle fait penser à cette sentence glaçante de Voltairine de Cleyre, célèbre théoricienne anarchiste : « La terre est une prison, le lit conjugal est une cellule, les femmes sont les prisonnières et vous [les hommes] êtes les gardiens ». Mais Sarah Haïdar ne se limite pas à cette affirmation, elle la met en scène, la rend tangible, puis la retourne contre ceux qui voudraient en faire une fatalité.
« Tout était écrit dans le sang, par le sang […] La rue est rouge de femmes ». «Aménorrhée» est un poème. Une colère. Une mutinerie. C’est un roman qui ne laisse aucune échappatoire. Il oblige à penser, à ressentir, à faire face. Et dans cette arène où les mots saignent, les voix étouffées font tâche d’huile. Un roman choc ? Oui. Mais avant tout, une œuvre nécessaire.
The post « Aménorrhée » de Sarah Haïdar : une révolte contre le patriarcat et l’autoritarisme appeared first on Le Jeune Indépendant.