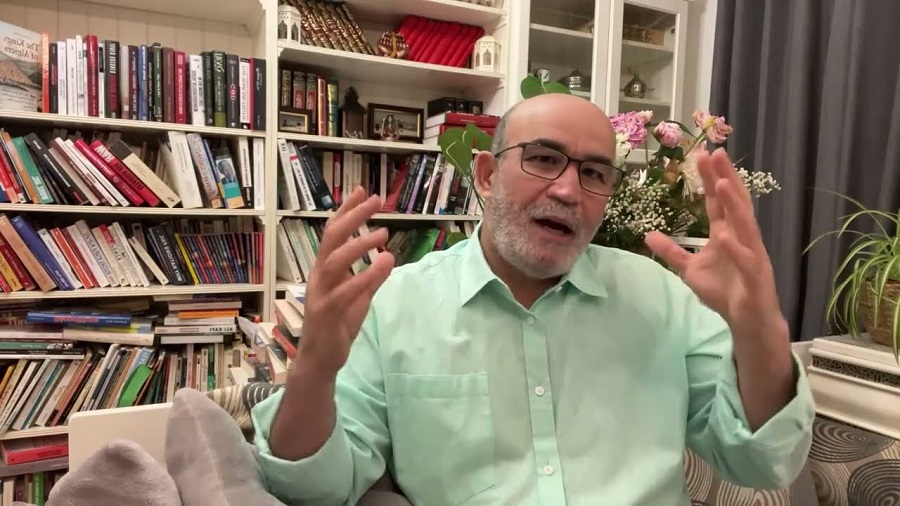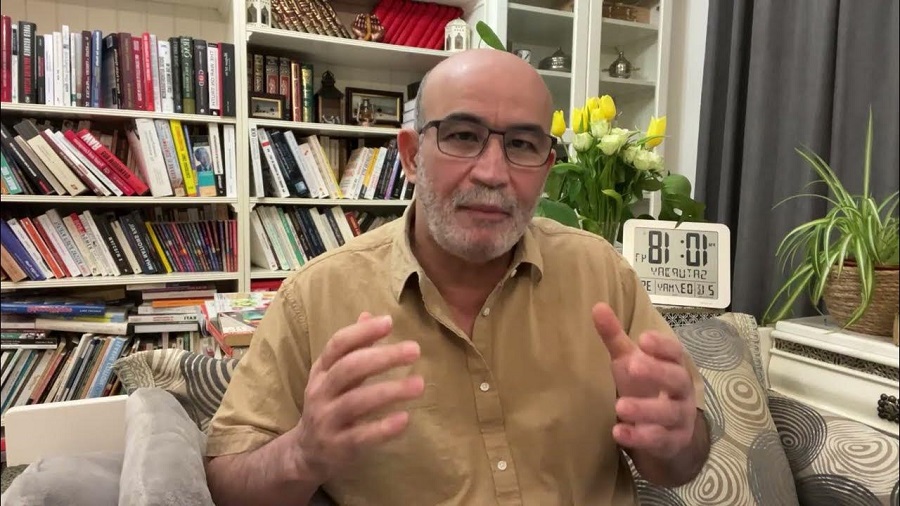Commentaire: Gangs
Cela fait des décennies désormais que les Nations unies ne sont plus, concrètement, la force diplomatique qu’elles étaient à leur création et que leur utilité est bien souvent remise en question. Toutefois, l’ONU continue, entre autres, à tenter d’influer sur les politiques intérieures des pays en proie à de grandes agitations. C’est notamment le cas […]

Cela fait des décennies désormais que les Nations unies ne sont plus, concrètement, la force diplomatique qu’elles étaient à leur création et que leur utilité est bien souvent remise en question. Toutefois, l’ONU continue, entre autres, à tenter d’influer sur les politiques intérieures des pays en proie à de grandes agitations. C’est notamment le cas de Haiti qui a malheureusement connu une instabilité politique chronique : sur les 58 présidents de la République qui se sont succédé depuis l’instauration de la fonction (dont 14 différents depuis l’approbation de la Constitution de 1987), 6 seulement ont terminé leur mandat. Mardi, le Conseil de sécurité de l’ONU a donné son feu vert à la transformation de la Mission multinationale de soutien à la police haïtienne en une force antigangs plus robuste pour tenter d’endiguer la violence qui ravage le pays. «Il s’agit-là d’un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l’un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée», a salué l’ambassadeur haïtien à l’ONU, Pierre Ericq Pierre, notant que la mission en cours avait été dépassée par «l’ampleur et la sophistication de la menace». L’adoption de cette résolution, préparée par les États-Unis et Panama, «offre de l’espoir, un espoir qui disparaissait rapidement face aux gangs terroristes qui étendent leur territoire, violent, pillent, tuent et terrorisent la population haïtienne», s’est également félicité l’ambassadeur américain, Mike Waltz. Pour essayer d’enrayer les exactions des gangs qui contrôlent la quasi-totalité de la capitale Port-au-Prince, le Conseil avait approuvé en 2023 la création de la Mission multinationale de sécurité (MMAS), menée par le Kenya, pour aider la police haïtienne dépassée. Mais sous-équipée, sous-financée, et avec seulement un millier de policiers sur les 2 500 espérés, ses résultats sont plus que mitigés. La nouvelle force, qui n’est pas une mission de maintien de la paix de l’ONU, pourra compter un maximum de 5 500 personnels en uniforme, des policiers mais aussi des militaires, contrairement à la MMAS. Elle sera accompagnée par la création d’un «bureau de soutien de l’ONU», suggéré il y a plusieurs mois par le Secrétaire général, Antonio Guterres. «Avec l’aide des Nations unies fournissant le soutien logistique et administratif nécessaire pour une force plus forte, plus robuste sur le terrain, le Conseil peut aider à rétablir la paix dans une nation aujourd’hui asphyxiée par des gangs sans pitié», a commenté juste avant le vote l’ambassadeur du Panama, Eloy Alfaro de Alba, lisant devant la presse une déclaration au nom de 50 pays. Le président kenyan, William Ruto, dont le pays dirige la mission actuelle, avait lui aussi plaidé pour une force renforcée. «Je peux assurer à tous les partenaires et acteurs qu’avec le personnel et les ressources adéquates, l’équipement et la logistique nécessaires, la sécurité d’Haïti peut être rétablie», a-t-il affirmé la semaine dernière. «J’attends avec impatience la participation du Kenya à la transition (…). Le Kenya ne quittera pas Haïti à la hâte», a-t-il indiqué. La Chine, qui s’était déjà montrée sceptique en 2023 sur la création de la MMAS sans transition politique en Haïti, a en revanche clairement exprimé ses doutes sur la nouvelle mission. Pays le plus pauvre des Amériques, Haïti subit depuis longtemps la violence des bandes criminelles, qui commettent meurtres, viols, pillages et enlèvements, dans un contexte d’instabilité politique chronique. La situation s’est encore largement détériorée depuis le début de l’année 2024, lorsque les gangs ont poussé le Premier ministre de l’époque, Ariel Henry, à la démission. Le pays, qui n’a pas connu d’élections depuis 2016, est depuis dirigé par un Conseil présidentiel de transition. Mais ce n’est pas la première fois que l’ONU tente de régler la crise haïtienne, sans succès. L’influence de l’Organisation internationale ne peut rien faire pour contrer le chaos interne de l’île et les résolutions et autres missions onusiennes semblent bien dérisoires au vu des résultats positifs inexistants apportés jusqu’ici par ce semi-interventionnisme dont la vigueur n’est pas suffisante pour éteindre le feu qui ravage le pays caribéen.
F. M.