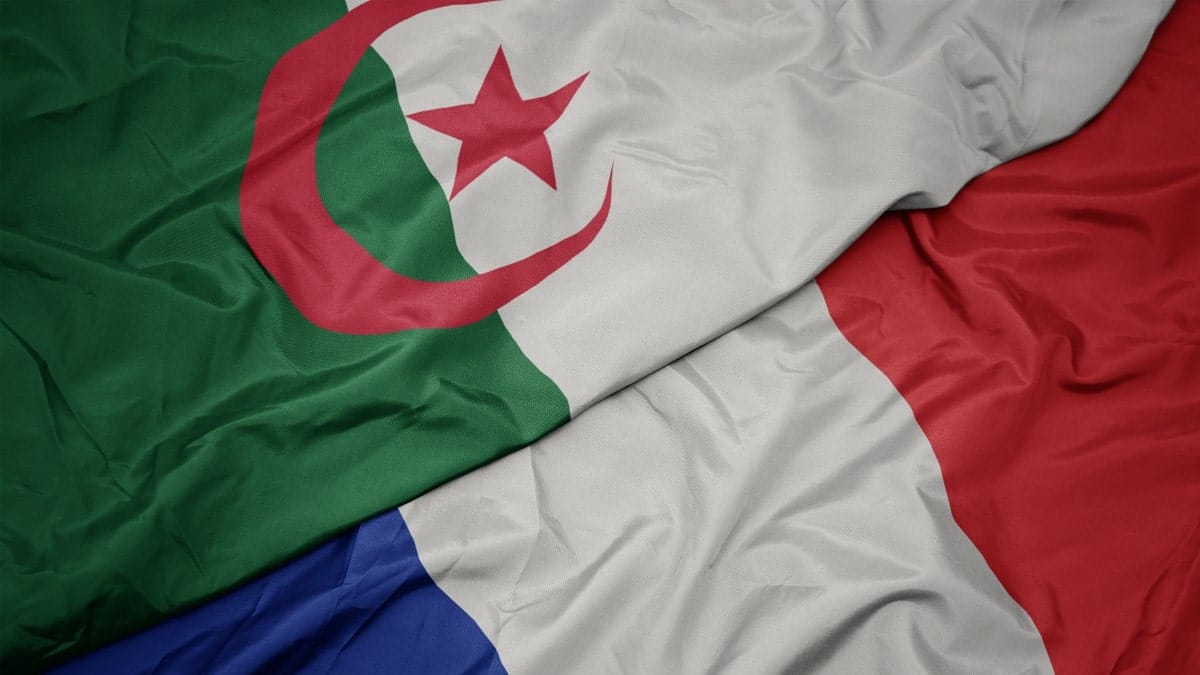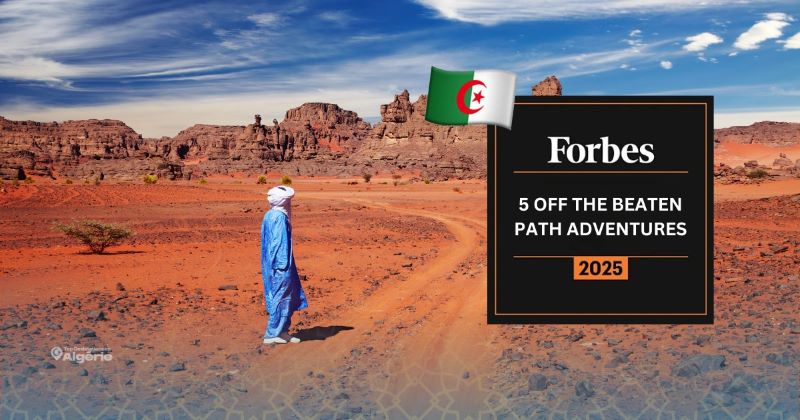Le Maroc, un narco-état pourvoyeur des groupes terroristes du Sahel
Entre trafics de cannabis, psychotropes transitant par la Libye et réseaux criminels sahéliens, le Maroc se positionne comme un acteur central d’un continuum criminel visant à fragiliser l’Algérie et déstabiliser toute la région. Et pourtant, Washington ferme les yeux sur cet allié stratégique, en violation de ses propres lois antinarcotiques et antiterroristes, laissant prospérer un […]

Entre trafics de cannabis, psychotropes transitant par la Libye et réseaux criminels sahéliens, le Maroc se positionne comme un acteur central d’un continuum criminel visant à fragiliser l’Algérie et déstabiliser toute la région. Et pourtant, Washington ferme les yeux sur cet allié stratégique, en violation de ses propres lois antinarcotiques et antiterroristes, laissant prospérer un système qui alimente indirectement les groupes djihadistes.
L’Algérie fait face à une guerre asymétrique et atone, menée depuis ses frontières terrestres à travers au moins trois pays voisins. Une guerre sans déclaration ni champ de bataille classique, mais dont les armes sont la drogue, la contrebande, les trafics transnationaux, et en parallèle, un flot continu de fake news et d’attaques récurrentes sur les réseaux sociaux. «L’objectif de guerre» est par contre limpide : fragiliser à la fois l’économie et la sécurité nationale.
À l’Ouest, le Maroc, premier producteur mondial de résine de cannabis, continue d’inonder ses voisins du Nord comme de l’Est. Vers l’Europe, via l’Espagne, mais aussi vers l’Algérie, malgré les saisies record opérées chaque année¹. À ce jour, 80 % de l’offre mondiale de cannabis provient du Royaume chérifien, mais aucune sanction internationale ne vise, directement ou indirectement, ce pays producteur².
Au Sud-Est, autour de Tamanrasset, In Guezzam ou Illizi, les contrebandiers sahéliens jouent un rôle logistique central. Ce n’est pas le cannabis qui transite en quantité ici, mais la cocaïne venue d’Amérique latine et les psychotropes débarqués en Libye, acheminés à travers les routes du Mali, du Niger et parfois de la Mauritanie. Ces flux renforcent les capacités financières des groupes terroristes de la région, alors même que leur première source de revenus – les rançons issues des enlèvements – s’est progressivement tarie³.
À l’Est, la Libye demeure une brèche. Le chaos qui y règne encore, notamment dans les zones tenues par le maréchal Haftar et son clan, offre une porte d’entrée aux réseaux criminels transfrontières. Aujourd‘hui la frontière libyenne est un point de passage pour les psychotropes qui inondent l’Algérie, mais aussi pour l’émigration clandestine, sur la même filière que certains trafics de drogue⁴. La piste des psychotropes mène jusqu’à l’Inde : officiellement expédiés vers la Libye, ces produits sont débarqués dans les ports de l’Est libyen. On peut évoquer un possible détournement après expédition, mais la récurrence du phénomène interpelle : comment croire que les autorités locales, côté Haftar, puissent l’ignorer ? Leur passivité pose la question d’une complicité tacite dans cette guerre asymétrique qui se mène contre l’Algérie. Une connivence qui s’inscrit dans la continuité des relations étroites qu’entretient le camp Haftar avec le Maroc, tant sur le plan diplomatique que sécuritaire. Le relais de cette influence se matérialise à travers Aguila Salah, président de l’Assemblée libyenne et véritable homme de paille de Haftar, régulièrement mis en avant lors des «shows» diplomatiques organisés à Rabat sous couvert de réconciliation nationale. Derrière la mise en scène, l’objectif est limpide : un entrisme marocain assumé en Libye, avec comme prétexte récurrent les accords de Skhirat, devenus l’alibi permanent de l’agenda chérifien dans ce pays voisin.
À travers ces trois fronts, un même fil conducteur se dessine : les trafics transformés en arme hybride, alimentant les caisses du terrorisme et installant un continuum mortifère où crime organisé, déstabilisation économique et menaces sécuritaires se confondent, non seulement contre l’Algérie mais aussi contre l’ensemble du Sahel et, au-delà, jusqu’à l’Afrique de l’Ouest.
Mais face à cette offensive diffuse, l’Algérie semble reproduire un schéma déjà connu : celui des années 1990, lorsqu’elle avait combattu seule le terrorisme djihadiste, isolée et privée de tout soutien extérieur en raison de l’embargo international sur les armes. À l’époque, ce fut une contrainte subie. Aujourd’hui, c’est un choix qui interroge : pourquoi maintenir une telle posture d’isolement alors que les dispositifs de coopération bilatérale, régionale ou multilatérale existent et pourraient alléger le poids de cette guerre asymétrique ? On peut également s’interroger sur l’absence apparente de stratégie vis-à-vis de l’Inde, pays de départ des psychotropes qui inondent l’Algérie. Aucun effort coordonné de pression diplomatique, de partage de renseignement ou de suivi des flux financiers ne semble être formellement exprimé pour endiguer ce trafic. Dans un contexte où chaque maillon de la chaîne transnationale est connu, cette passivité interroge et soulève des questions sur l’efficacité globale de la politique algérienne face à la guerre asymétrique qu’elle subit.
La comparaison devient encore plus frappante lorsque l’on observe les postures occidentales. Les États-Unis, absorbés par la lutte contre le fentanyl qui ravage leur société, continuent de ménager le Maroc, premier producteur mondial de cannabis, en fermant ostensiblement les yeux sur l’ampleur de son rôle dans le trafic global. Comment les États-Unis peuvent-ils fermer les yeux sur un allié comme le Maroc, dont le trafic massif de cannabis alimente les caisses du terrorisme djihadiste au Sahel ? Et pourtant, pour infiniment moins que cela, l’administration Trump a frappé de sanctions des pays comme Cuba, le Panama ou la Guinée-Bissau. Le comble du cynisme : dans le même temps, Rabat et ses relais de lobbying s’acharnent à faire passer le Polisario pour une organisation terroriste, en recyclant des fake news sans la moindre preuve.
Un paradoxe américain flagrant : en ménageant le Maroc, Washington piétine ses propres lois. Le Kingpin Act (1999), visant à sanctionner les États impliqués dans le narcotrafic à grande échelle, n’a jamais été appliqué au premier producteur mondial de cannabis. Le Foreign Assistance Act (1961), qui interdit toute aide aux pays liés au trafic ou au terrorisme, est contredit par les milliards injectés dans la coopération militaire et sécuritaire avec Rabat. Le Patriot Act (2001), imposant la traque des flux financiers alimentant le terrorisme, est lui aussi ignoré, alors que les revenus du cannabis marocain profitent autant au Makhzen qu’aux groupes djihadistes du Sahel. La logique du Trafficking Victims Protection Act (2000) est également bafouée : les filières de drogue, de psychotropes et de migration clandestine forment un continuum criminel transnational toléré. Enfin, l’antiterrorisme post-11 Septembre, pilier des doctrines de sécurité nationale américaines, est vidé de son sens : comment lutter réellement contre le lien drogue-terrorisme tout en fermant les yeux sur le Maroc, véritable narco-État ?
Pendant que Washington ferme les yeux, la France se montre également indulgente, notamment à travers la posture de son ministre de l’Intérieur, Bruno Retaillaut, qui proclame faire de la sécurité sa priorité n°1. Pourtant, jamais il ne mentionne l’origine du cannabis qui empoisonne le pays et gangrène des centaines de quartiers, alors même que 80 % de cette drogue provient du Maroc. Des annonces de mesures sécuritaires sont régulièrement faites, mais jamais la France ne critique ou ne cible le Royaume chérifien. À l’inverse, l’Algérie se retrouve régulièrement sous le feu de critiques, parfois pour des motifs bien plus marginaux. Le fait que les extraditions des gros bonnets se fassent depuis le Maroc, seulement lorsque le Royaume accepte de coopérer, confirme en creux une réalité troublante : le pays agit également comme une base de repli sanctuarisée pour ces trafiquants, facilitant le maintien et la circulation des réseaux criminels, pourvu qu’ils dépensent au Maroc, tout en laissant prospérer le trafic vers l’Europe et l’Algérie.
En ménageant le Maroc, Paris et Washington préservent leurs intérêts immédiats, mais ferment les yeux sur un trafic qui nourrit le terrorisme qu’ils prétendent combattre. Un calcul cynique où les gains de court terme priment sur la sécurité régionale et sur les véritables solutions.
Par Larbi Ghazala
- APS – Saisies record de cannabis et psychotropes en Algérie, 2023
- Le Monde – Les États-Unis et le fentanyl, 2024
- ADF Magazine – Trafic de drogue et terrorisme au Sahel, 2024
- Voyage.gc.ca – Frontière libyenne et trafic, 2024