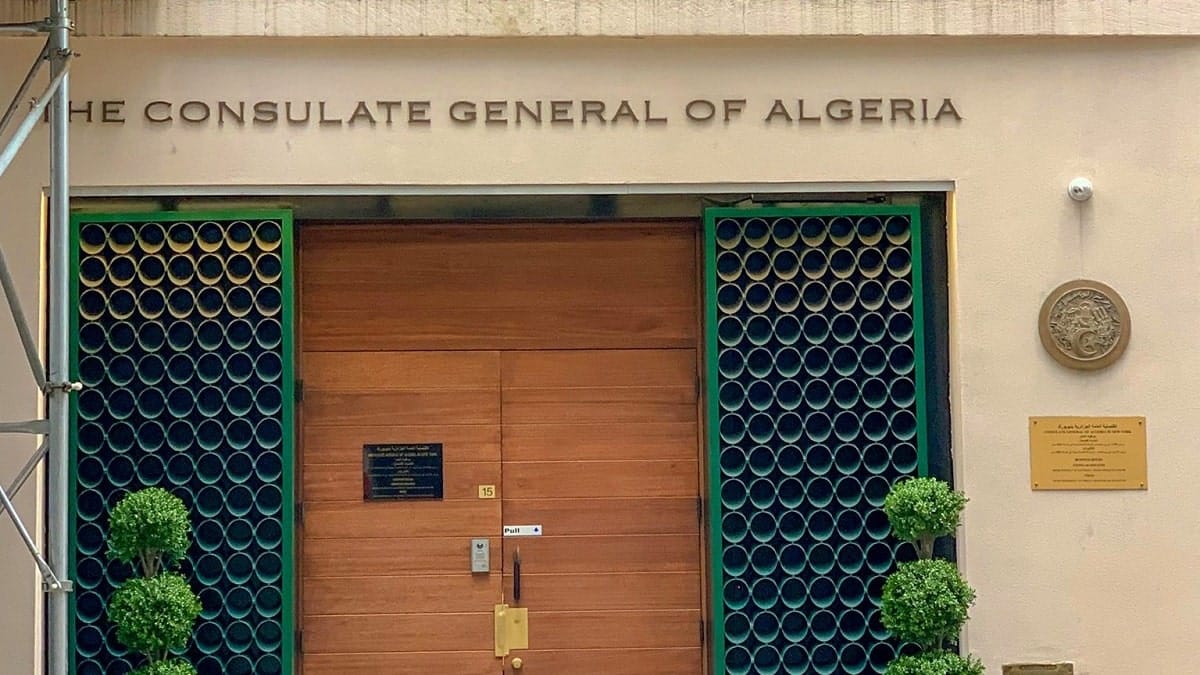Nostalgie d’un paradis américain perdu : de quoi Trump est-il le nom(*) ?
Une contribution d’Ali Akika – Il ne s’agit pas de sonder l’âme du citoyen Trump mais celle du président des... L’article Nostalgie d’un paradis américain perdu : de quoi Trump est-il le nom(*) ? est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Une contribution d’Ali Akika – Il ne s’agit pas de sonder l’âme du citoyen Trump mais celle du président des Etats-Unis, dont l’ambition est de «rendre l’Amérique à nouveau grande», derrière ce slogan qui renvoie à la nostalgie d’un paradis perdu, mais aussi à une certaine inquiétude d’avoir perdu du terrain et de voir poindre à l’horizon l’insupportable menace sur la suprématie des Etats-Unis dans le monde. L’Etat profond américain a diagnostiqué les causes du terrain perdu et les «remèdes» nécessaires pour consolider le socle sur lequel reposerait à nouveau le drapeau étoilé de l’Amérique. Ajoutons que la base sociale du trumpisme est constituée des classes petites et moyennes, dont l’image sociale a été abimée. Le trumpisme est aussi présent au sommet de la pyramide sociale, à travers les majors de l’industrie pétrolière et les nouveaux riches de l’économie numérique
En raison des leviers de la puissance américaine, qui englobe à la fois l’économie, les finances et le complexe militaro-industriel, Trump pense que son pays a tous les atouts pour faire une «révolution» du type de Reagan aux Etats-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne, dans les années 1980-90. Mais le monde d’aujourd’hui n’est plus tout à fait comparable à celui de l’après-guerre 39/45. C’est un monde où la mondialisation, enfant du capitalisme financier, a engendré des concurrents auxquels on ne s’attendait pas. L’un d’eux relève de ces ruses de l’histoire ; bien que communiste, il semble maîtriser les secrets du capitalisme mieux que les cols blancs de Wall Street. Et, paradoxe des paradoxes, ce pays, c’est la Chine, est en passe de détrôner l’Oncle Sam de son piédestal. Et il revient à Trump, l’homme d’affaires, de neutraliser ce coriace concurrent. La bataille sera rude et Trump devra être au four des problèmes économiques et au moulin exposé au vent de la politique internationale.
Trump, en arrivant à la Maison-Blanche, savait que le monde entier l’attendait sur les problèmes économiques de son pays. Une dette abyssale et les intérêts de celle-ci étaient financés par la planche à billets qui faisait perdre du poids et du prestige au dollar. Et qui dit faiblesse du dollar, monnaie internationale, dit grésillement dans les circuits de la finance internationale. Pour empêcher que l’économie, le bouclier et le sabre de la puissance du pays, sombre dans des crises de longue durée, Trump va sortir de sa poche secrète les taxes douanières pour remplir les caisses du Trésor américain en faisant les poches de tous les pays qui commercent avec l’immense et solvable marché américain. Parallèlement à ces taxes, Trump va se lancer dans l’aventure de la politique internationale pour stopper ou ralentir l’arrivée de la Chine et de la Russie dans des pays jadis chasse gardée de pays européens, aujourd’hui incapables de résister à la Chine devenue une obsession pour les Américains.
L’activité débordante de Trump sur la scène internationale
Pour son second mandat, Trump est arrivé au pouvoir dans un monde chamboulé et traversé par des guerres de très haute intensité. Pareille situation conditionne évidemment les succès ou non de son objectif, d’autant plus que les Etats-Unis, bien que dominant l’économie mondiale, se trouvent dans une posture qui les fragilise avec l’émergence de nouvelles données politiques et économiques qui compliquent les équations à résoudre. Les problèmes qui encombrent leurs chemins vers les succès espérés sont la guerre en Ukraine et la Palestine. Avec sa légèreté feinte ou réelle, Trump pensait régler la guerre en un tour de main. Quant à Gaza, il réduit ce problème centenaire à une opération immobilière dans une station balnéaire. Il s’est rendu compte qu’en Ukraine, il avait en face un partenaire coriace et en Palestine, un allié encombrant dont l’armée massacre et affame tout un peuple, une image de désastre qui rejaillit sur la propre image des Etats-Unis.
Mais revenons brièvement à l’Ukraine. La guerre dans ce pays avait un double but : encercler la Russie avec l’Otan pour limiter ses possibilités d’action sur le plan international. Cet objectif est lié, corolaire au suivant, à diviser et à mettre à mal les relations entre la Chine et la Russie. Echec total. Preuve que les stratèges américains ont oublié que ces deux pays sont frontaliers et que leurs relations se sont nouées et amplifiées après la Révolution russe, laquelle a aidé les Chinois à combattre les Anglo-Américains et devenir un Etat communiste. A défaut d’éloigner la Russie de la Chine, qui reste le cauchemar des Américains, Trump a choisi de «lâcher» l’Ukraine, de passer cette patate chaude aux Européens. Trump, en laissant la Russie atteindre ses objectifs en Ukraine, espère voir la Russie lui ouvrir son sous-sol riche en matières premières. En faisant des «cadeaux» à la Russie en Ukraine et en inondant l’économie russe en dollars, Trump croit appâter Poutine. Voyons son activisme diplomatique ailleurs. En Afrique et en Asie de l’Ouest où l’Iran pose à l’Amérique d’énormes problèmes.
Les gains recherchés par la diplomatie américaine
Trump se réserve la diplomatie dans des pays où tonne la guerre ou bien dans des lieux de rencontres prestigieuses en Grande-Bretagne, en Italie, en Hollande, en France, et ordonne à ses diplomates de courir le monde, mais pas n’importe où ; là où il y a un conflit à résoudre, où on peut sentir l’odeur de matières premières, des pays contrôlant des routes maritimes ou terrestres. Le premier pays visité a été le Congo Kinshasa en conflit avec le Rwanda. Les Américains font faire la paix entre ces deux pays qui peuvent les écouter et remplacer la Belgique et la France, ex-pays colonisateurs de la région mais incapables d’aider à faire la paix entre deux pays voisins. Une signature de paix qui vaut son pesant d’or et ramène dans l’escarcelle de l’Oncle Sam des matières rares du sous-sol congolais.
Le deuxième succès diplomatique américain sera l’arrêt de la guerre entre le Pakistan et l’Inde, deux pays détenteurs de l’arme nucléaire et partageant des centaines de kilomètres de frontières avec la Chine. Réussir une prouesse diplomatique avec de telles puissances en conflit depuis leur indépendance dans une région aussi géostratégique a dû susciter des jalousies dans les chancelleries. Le dernier succès en date a été la «paix» signée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux pays dans une région géostratégique où «cohabitent» diplomatiquement la Russie, l’Iran et la Turquie. L’arrivée des Etats-Unis qui veut acheter ou louer un corridor appelé Zanzighar ne plaît pas à l’Iran, ni, du reste, à la Russie. La déjà présence d’Israël en Azerbaïdjan et ce corridor américain vont faire monter la tension. La venue des Etats-Unis dans la région n’a d’autre objectif que de gêner la future route de la soie de la Chine et rivaliser avec elle. Ainsi, cet activisme diplomatique que les Américains tentent de transformer en gain politique n’est pas le fruit du hasard.
Aussi bien en Afrique et en Asie de l’Ouest qu’au Sahel, les Etats-Unis comptent remplacer le temps perdu à cause des griseries incontrôlées de la mondialisation par des gains d’influence dans les régions citées. La visite du haut conseiller de Trump, Massad Boulos, en Algérie n’est pas non plus un hasard. Un pays ayant deux balcons, l’un donnant sur les pays du Sahel et l’autre sur la Méditerranée, avec vue sur le détroit de Gibraltar, sur l’Espagne et l’Italie, qui accueille dans ses ports la 6e flotte américaine, ne laisse pas les Etats-Unis indifférents. Contrairement aux pays cités plus haut, Congo-Rwanda, Pakistan-Inde, Azerbaïdjan-Arménie, où les Américains ont éteint le feu de la guerre, la visite du conseiller de Trump à Alger cherche plutôt à éviter que le feu de la guerre n’embrase l’Afrique du Nord et le Sahel. Les Américains semblent inquiets du vide créé par le départ de la France du Sahel et le feu qui couve en Libye et au Sahara Occidental.
L’Algérie, étant donné sa position géostratégique – elle partage des frontières avec tous ces pays –, a suscité l’intérêt des Etats-Unis qui ont déjà fait appel à ses services sur ses otages à l’ambassade à Téhéran à la naissance de la République islamique. Le fait que le président Tebboune ait reçu le conseiller américain, qui a déclaré «vouloir partager avec le président algérien la vision du président Trump». La discussion a donc porté sur des problèmes hautement politiques et stratégiques, et passé au filtre des deux présidents les relations dans les domaines de la défense et de l’énergie, lesquels ont été laissés aux soins des délégations des deux pays. Voici donc l’activité diplomatique des Etats-Unis qui accompagnerait les décisions à appliquer au monde entier en fonction de la nature et des volumes d’échange avec chaque pays
Les taxes douanières : remède miracle ou mirage pour fortifier l’économie américaine ?
Le «docteur» Trump constatant que le monde entier «vole» les Etats-Unis en leur vendant tout et n’importe quoi, alors que, avait-il dit, le même monde leur achète peu, il ne veut pas voir la réalité car les problèmes sont ailleurs : désindustrialisation du pays, la planche à dollars pour financer à gogo les guerres, donc producteur et exportateur de l’inflation chez les autres, etc. Pareille situation a déréglé le commerce international et la dictature du dollar comme monnaie internationale devenait insupportable pour beaucoup de pays.
Faire appel aux taxes douanières pour faire la poche aux exportateurs étrangers n’est pas la meilleure façon de fidéliser une clientèle. De plus, cette manie de se croire tout permis et de croire que l’autre, tous les autres n’ont pas les moyens de riposter et de résister, va réserver des surprises à Trump. Une telle mentalité élevée en stratégie par les temps qui courent mènera fatalement, un jour ou l’autre, droit dans le mur et dans la déchéance éthique et morale, quand bien même les taxes douanières jouent, certes, un certain rôle dans la balance du commerce et des paiements : entrée de devises, fluidité des échanges, lutte contre l’inflation, etc.
En aucun cas les taxes ne peuvent résoudre une économie biberonnée à la planche à billets, ni remplir le rôle de banquier avec un dollar qui devient une arme politique en cas d’embargo. Bref, faire croire à son pays que les taxes vont faire financer indirectement la réindustrialisation du pays, empêcher la dette de glisser vers des profondeurs abyssales, et que les investisseurs vont courir vers une situation de futur chaos en la peignant avec des couleurs printanières, c’est ignorer le b. a.-ba de l’économie qui obéit au politique, laquelle se méfie des miracles et encore plus des mirages.
Conclusion en une phrase
Le monde est entré dans une phase nouvelle. Mais, contrairement aux autres fractures depuis l’Antiquité jusqu’au capitalisme que nous connaissons, le passage d’un système à un autre obéissait à une horloge réglée par un temps qui épousait son époque. De nos jours, la dialectique qui régit le rapport temps/époque est brisée par deux nouvelles variables, celle de l’arrogance et des mots qui ne nomment pas les choses de la vie, préférant les manipuler pour enterrer la vérité. Un grand économiste, John Keynes, se voulant prophète, a dit : «A long terme, nous serons morts.» Et ce n’est pas un hasard si la formule «le temps c’est de l’argent» est une formule anglo-saxonne qui a fait de Londres The City, le temple de la finance.
A. A.
(*) Le titre est une formule du philosophe Badiou, professeur de philosophie à l’Ecole normale supérieure.
L’article Nostalgie d’un paradis américain perdu : de quoi Trump est-il le nom(*) ? est apparu en premier sur Algérie Patriotique.