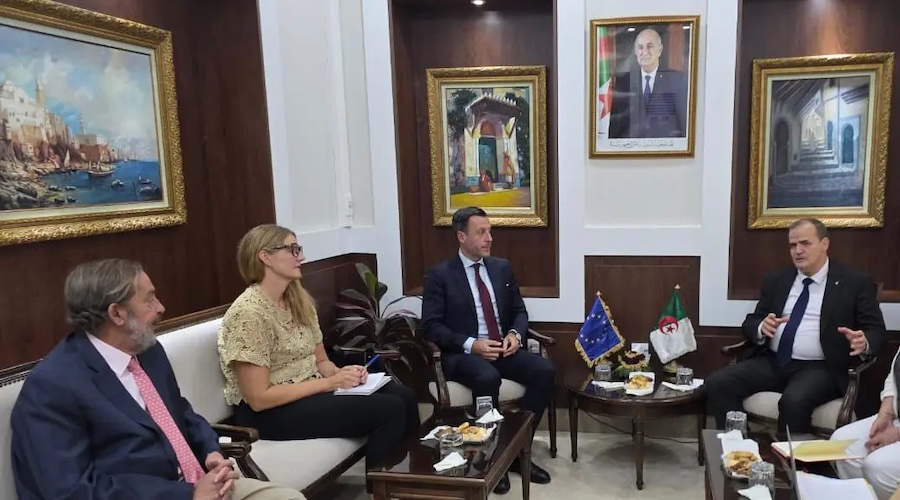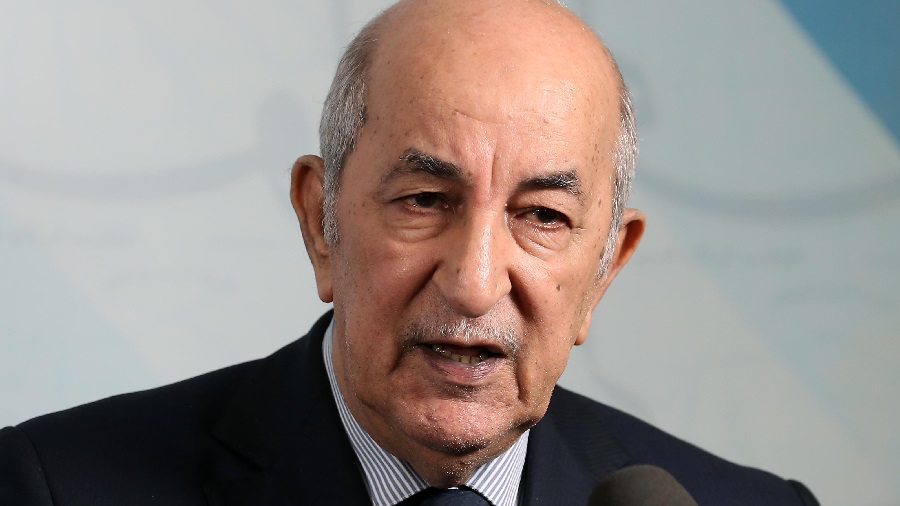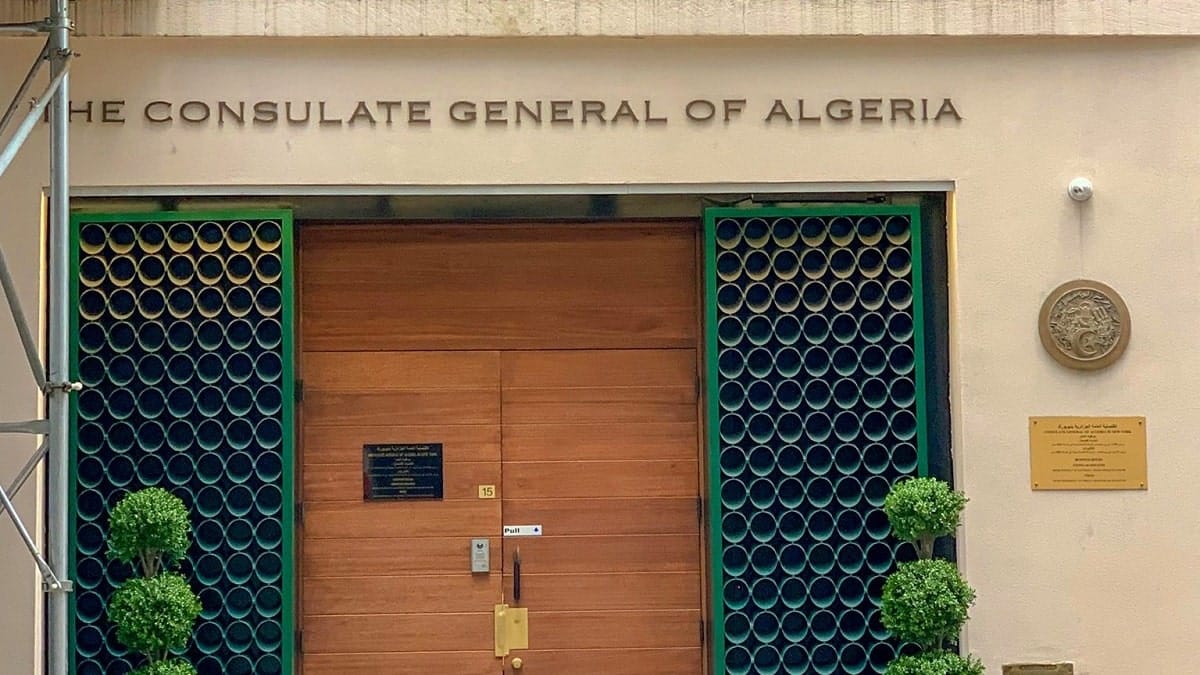Lettres: Nadia Sebkhi, la plume au service de la liberté et de la mémoire
Dans le tumulte des mots et le silence pesant des non-dits, Nadia Sebkhi s’est forgé une place singulière dans le paysage littéraire algérien. Par Hafit Zaouche Romancière, poétesse, éditorialiste, mais aussi fondatrice et directrice du magazine littéraire L’IvrEscQ, elle est l’une de ces voix qui refusent de se taire, une femme qui écrit pour briser […]

Dans le tumulte des mots et le silence pesant des non-dits, Nadia Sebkhi s’est forgé une place singulière dans le paysage littéraire algérien.
Par Hafit Zaouche
Romancière, poétesse, éditorialiste, mais aussi fondatrice et directrice du magazine littéraire L’IvrEscQ, elle est l’une de ces voix qui refusent de se taire, une femme qui écrit pour briser les murs invisibles de l’omerta et pour offrir à la littérature algérienne un espace de résonance.
Née à Alger, elle appartient à cette génération d’écrivaines de la post-indépendance, pleine d’espérances et de désillusions. Sa plume interroge sans relâche la place de la femme, la mémoire des blessures, mais aussi l’horizon de la Méditerranée, ce vaste berceau de cultures qui, pour elle, est une identité en soi.
De «Un amour silencieux» (2004) à «La Symphonie des sept nuits» (2023), en passant par «Les sanglots de Césarée» ou «La Danse du jasmin», Nadia Sebkhi a bâti une œuvre où le féminin se fait miroir et cri, où l’histoire collective rejoint l’intime. Sa prose est empreinte de lyrisme et de mysticisme, une quête constante entre l’amour terrestre et l’amour céleste, entre l’exil intérieur et le combat pour l’émancipation.
Dans ses essais, notamment «Assia Djebar, sur les traces d’une femme engagée» (2018), elle rend hommage aux pionnières, celles qui ont osé ouvrir des brèches dans un monde souvent hostile aux voix féminines. Elle rappelle que la mémoire littéraire se transmet, mais aussi qu’elle se défend, face à l’oubli, la régression et les résistances patriarcales.
En 2009, elle fonde L’IvrEscQ, un magazine littéraire unique en Algérie, qui a survécu plus d’une décennie malgré les obstacles financiers et institutionnels. Grâce à ce magazine, des centaines d’auteurs, jeunes ou confirmés, arabophones, amazighophones ou francophones, ont trouvé une visibilité et une reconnaissance. Forums, colloques, traductions, coéditions, tout un écosystème littéraire a émergé autour de ce projet.
Mais derrière la passion, il y a les épreuves : retards de paiement de la part des institutions, indifférence de certains décideurs, mépris parfois. Nadia Sebkhi n’a jamais caché la difficulté d’être une femme à la tête d’une telle entreprise culturelle. Elle le dit avec une pointe d’amertume : «Si j’étais un homme, L’IvrEscQ aurait moins de difficultés».
Dans sa vision, la Méditerranée n’est pas seulement une mer mais un lien vital, une promesse d’échanges et de reconnaissance mutuelle. Pourtant, elle constate avec douleur que les barrières politiques et les fractures sociales empêchent encore ce rapprochement.
Dans ses interventions, elle refuse les modèles imposés, qu’ils viennent d’un Occident en crise ou d’un Orient englué dans les dérives intégristes. Écrire, dit-elle, c’est «oser titiller l’ordre établi», et son écriture, oscillant entre poésie et révolte, en est la preuve éclatante.
Ce qui frappe chez Nadia Sebkhi, c’est ce mélange de lucidité et de fragilité, de colère et d’espérance. Elle n’idéalise ni son pays ni sa société, mais elle croit au talent de ses écrivains et à la vitalité de la création. Elle croit au pouvoir des mots pour résister, pour relier, pour soigner.
Son dernier roman, «La Symphonie des sept nuits», en est une belle illustration : une dystopie poétique où deux femmes interrogent l’avenir de l’humanité dans une citadelle blanche de 2062. Comme toujours, derrière la fiction, il y a la question essentielle : que sauve-t-on quand tout s’effondre ?
Dans l’Algérie d’aujourd’hui, où la littérature peine parfois à trouver sa place, Nadia Sebkhi incarne une ténacité rare. Elle a fait de son magazine une arme contre l’oubli, de ses romans un cri d’alerte, de ses essais un espace de transmission. Elle n’est pas seulement une écrivaine : elle est une passeuse, une résistante des mots.
À travers son parcours, on retrouve une vérité universelle : la littérature n’est pas un luxe, mais une nécessité. Elle est mémoire, combat et promesse. Et Nadia Sebkhi, avec ses mots habités et ses luttes incessantes, nous rappelle que les voix féminines algériennes, malgré les entraves, continuent de tracer leur sillon.
H. Z.