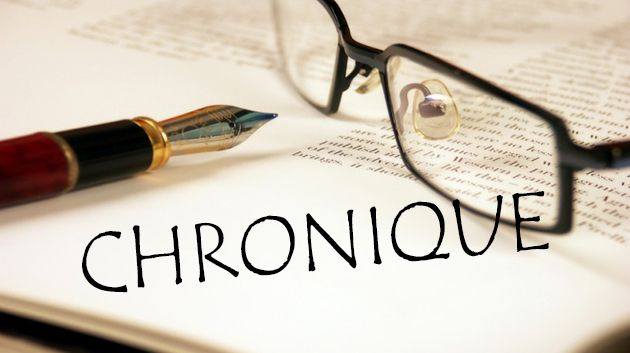Sahara occidental : la diplomatie marocaine perd du terrain
La scène diplomatique internationale est un théâtre où les principes finissent souvent par triompher des manœuvres éphémères. La récente déclaration du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, depuis la tribune de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, en est une illustration éclatante et un revers cinglant pour la diplomatie marocaine, qui s’enfonce dans une […]

La scène diplomatique internationale est un théâtre où les principes finissent souvent par triompher des manœuvres éphémères.
La récente déclaration du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, depuis la tribune de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, en est une illustration éclatante et un revers cinglant pour la diplomatie marocaine, qui s’enfonce dans une stratégie d’évitement de plus en plus intenable.
Le 23 septembre, à New York, la voix de l’Afrique du Sud, poids lourd du continent et conscience morale en matière de décolonisation, a résonné avec force.
En réaffirmant solennellement « la responsabilité des États membres de l’ONU de garantir le droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination », le président Ramaphosa n’a pas seulement exprimé une position nationale ; il a rappelé au monde entier le fondement juridique et moral de ce conflit.
Cette déclaration, officiellement mise en avant par la présidence et le ministère des Affaires étrangères sud-africains, ancre la question sahraouie là où elle a toujours appartenu : au cœur du droit international.
Ce rappel puissant déconstruit méthodiquement l’édifice de propagande bâti par le Makhzen. Pendant des années, Rabat a multiplié les prouesses machiavéliques : une « diplomatie des consulats » illégale dans les territoires occupés, un chantage migratoire à peine voilé, et des accords de normalisation servant de monnaie d’échange pour une reconnaissance de sa prétendue souveraineté.
Or, ces manœuvres se heurtent à une réalité juridique inébranlable. Comme le soulignent les rapports et correspondances onusiens récents, le droit à l’autodétermination est imprescriptible. Il ne « s’éteint » pas avec le temps, ni ne se dissout face à des faits accomplis illégaux.
La solidité du dossier sahraoui ne réside pas seulement dans les résolutions de l’ONU et du Conseil de sécurité, qui qualifient sans équivoque le Sahara Occidental de « territoire non autonome » dont le statut final doit être décidé par son peuple.
Elle est également renforcée par un soutien international en pleine évolution, qui s’élargit bien au-delà des alliés traditionnels. Des pays d’Amérique latine aux puissances émergentes, en passant par une opinion publique européenne de plus en plus sensible à la dernière colonie d’Afrique, la cause sahraouie gagne en légitimité.
La déclaration de l’Afrique du Sud n’est donc pas un événement isolé. Elle est le symptôme d’un isolement croissant du Maroc sur le plan des principes.
Tandis que Rabat investit des fortunes dans des opérations de lobbying et des victoires diplomatiques factices, le camp de la légalité internationale accumule des soutiens de poids, fondés non pas sur des intérêts transactionnels, mais sur le respect de la charte des Nations Unies.
Face à ce consensus grandissant, le Makhzen se retrouve piégée par ses propres mensonges. Sa proposition d’autonomie, présentée comme un « geste généreux », n’est en réalité qu’une tentative de contourner le cœur du problème : le droit inaliénable du peuple sahraoui à choisir librement son avenir.
Chaque prise de position comme celle de Pretoria rappelle que toute approche qui exclut l’option de l’indépendance est vouée à l’échec et met en péril la paix et la stabilité régionales. L’Histoire, elle, avance dans une seule direction : celle de la liberté des peuples.