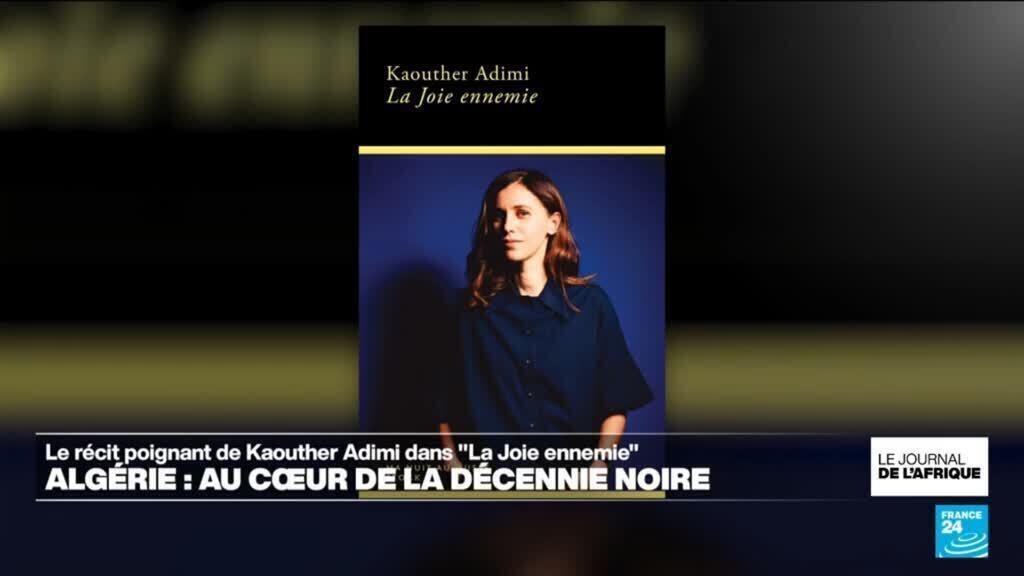Financement étranger des associations : 17 milliards de dinars sous surveillance
Plus de huit cents associations au niveau national ont bénéficié de financements extérieurs pour un montant total dépassant 17 milliards de dinars, soit près de 119 millions de dollars américain. C’est ce qu’a révélé le rapport national portant sur l’état des lieux de la société civile et de ses éventuelles vulnérabilités face aux risques d’exploitation par […] The post Financement étranger des associations : 17 milliards de dinars sous surveillance appeared first on Le Jeune Indépendant.

Plus de huit cents associations au niveau national ont bénéficié de financements extérieurs pour un montant total dépassant 17 milliards de dinars, soit près de 119 millions de dollars américain. C’est ce qu’a révélé le rapport national portant sur l’état des lieux de la société civile et de ses éventuelles vulnérabilités face aux risques d’exploitation par des réseaux de financement du terrorisme, publié hier par l’Observatoire national de la société civile.
Le rapport réalisé sous la direction du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec la Banque mondiale et l’ensemble des institutions concernées, précise qu’il a été recensé 845 associations recevant des financements extérieurs. La France est de loin le principal pourvoyeur, représentant 62,45 % des apports. Viennent ensuite les Emirats arabes unis avec 4,49 %, le Canada avec 3,97 %, l’Espagne avec 3,8 %, la Turquie avec 3,46 %, puis la Suisse et l’Allemagne avec 1,9 % chacune.
La valeur absolue, manne considérable, illustre la vitalité et la crédibilité de nombreuses initiatives locales, mais impose aussi une plus grande vigilance aux tentatives de détournement pour financer des actions terroristes. D’autant plus que, même si cette étude a conclu à un risque globalement faible, il reste que les associations caritatives, religieuses et certaines fondations requièrent une plus grande vigilance
Cette réalité financière s’inscrit dans un paysage associatif particulièrement dense. Le pays compte 41 807 associations entrant dans le champ défini par le Groupe d’action financière (GAFI). Parmi elles, les associations religieuses sont les plus nombreuses avec 20 034 structures, souvent liées à la gestion des mosquées et à la collecte de dons. Viennent ensuite 9 619 associations caritatives, actives dans l’aide aux plus démunis, 8 198 associations culturelles, 3 615 environnementales, 335 fondations et six bureaux d’ONG internationales autorisés à exercer en Algérie.
A côté de ce noyau, plus de 50 000 associations dites « hors champ GAFI » poursuivent des activités sportives, scientifiques, professionnelles, de jeunesse, ou encore comités de quartiers. Ces structures, qui ne collectent pas de fonds à redistribuer, sont considérées comme beaucoup moins exposées aux tentatives d’abus financiers.
Des alertes limitées mais révélatrices
Malgré l’ampleur des associations et de leur financement, les signalements de dérives demeurent rares. Entre 2020 et 2024, la Cellule de traitement du renseignement financier a recensé quatre cas d’opération suspecte. Trois concernaient des associations caritatives et un seul une association religieuse. Aucun n’a débouché sur une condamnation. Ces chiffres, relativement faibles, traduisent une situation maîtrisée, mais confirment que le risque existe et qu’il touche prioritairement les segments manipulant des fonds humanitaires ou religieux.
L’évaluation distingue clairement les niveaux de risque. La menace est considérée comme faible, avec un score indicatif de 0,20 pour la plupart des catégories. Mais la vulnérabilité apparaît plus marquée chez les associations caritatives, qui atteignent 0,60 et chez certaines fondations, évaluées à 0,53. Le risque intrinsèque reste globalement modéré, mais il atteint 0,70 pour les associations caritatives et 0,78 pour les associations religieuses. Les fondations sont évaluées à 0,20 et les ONG internationales à 0,17, ce qui traduit une exposition moindre. Les rapporteurs tiennent à préciser qu’ils ne minimisent pas les risques. La menace est jugée globalement faible, mais elle se concentre sur certaines catégories.
Au total, 3 115 associations ont été classées comme potentiellement exposées. Parmi elles, 928 sont caritatives, 1 852 religieuses et 335 sont des fondations. Ce chiffre, qui représente moins de 10 % du total, montre que le danger est circonscrit mais qu’il doit être traité avec sérieux et justifie une surveillance renforcée.
Stratégie de prévention en 5 axes
A partir de ces constats, les autorités ont tracé une stratégie de prévention qui doit s’échelonner entre 2025 et 2026. Elle prévoit d’intensifier la sensibilisation des associations les plus exposées, et ce à travers des campagnes d’information et des formations pratiques. Une base de données nationale centralisée sera mise en place pour mieux suivre les flux financiers et croiser les informations. Des inspections ciblées seront lancées dès décembre 2025, notamment dans les wilayas frontalières, zones jugées plus vulnérables. En 2026, un nouveau cadre juridique renforcera les obligations de transparence, à l’instar de la déclaration des bénéficiaires effectifs, de rapports financiers réguliers et de sanctions en cas de manquements. Enfin, la coopération internationale sera consolidée afin de faciliter l’échange d’informations et le suivi des transferts transnationaux.
Il convient de noter que cette étude rappelle que la lutte contre le terrorisme s’est profondément transformée au cours des vingt dernières années. Autrefois centrée sur l’action militaire et les opérations de renseignement, elle s’étend désormais au champ financier. Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un basculement historique, celui où la communauté internationale a pris conscience que l’argent est l’oxygène des réseaux terroristes. Sans flux financiers, pas d’armes, pas de logistique, pas de propagande. C’est dans cette logique qu’a été renforcé le rôle du Groupe d’action financière, créé en 1989 par les pays du G7. Initialement chargé de lutter contre le blanchiment d’argent, le GAFI a vu son mandat élargi à la lutte contre le financement du terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive. Ses recommandations, devenues des normes de référence, imposent aux Etats des obligations de transparence et de vigilance. Parmi elles, la recommandation numéro huit a suscité une attention particulière ; elle cible les associations à but non lucratif, jugées vulnérables en raison de leur rôle de collecteurs de fonds et de leur capacité à agir dans des zones sensibles, parfois même en dehors du contrôle direct des autorités nationales.
L’engagement précoce de l’Algérie
L’Algérie, qui a vécu dans sa chair les ravages du terrorisme durant la décennie noire des années 1990, n’a pas attendu la communauté internationale pour s’attaquer au financement de la violence. Elle a très tôt ratifié les conventions multilatérales et régionales relatives au blanchiment et au financement du terrorisme, et s’est engagée à renforcer sa législation nationale. Depuis 2004, le pays est membre du MENAFATF, le GAFI régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. En 2022, un rapport d’évaluation mutuelle avait reconnu les avancées de l’Algérie, tout en l’encourageant à intensifier le suivi du secteur associatif. Dans un contexte où les associations jouent un rôle de plus en plus central dans la vie sociale, il devenait urgent de concilier liberté associative et impératif sécuritaire. C’est ce qui a conduit, en janvier 2025, au lancement d’une évaluation nationale des risques. Cette initiative a été confiée au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, mais elle a mobilisé l’ensemble de l’appareil d’Etat. Ont pris part aux travaux la Défense nationale, la Justice, les Affaires religieuses, la Banque d’Algérie, les Douanes, la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale, ainsi que la Cellule de traitement du renseignement financier, organe clef de la surveillance des flux financiers. Pour donner à l’évaluation un ancrage concret, des associations représentatives ont été sollicitées, parmi lesquelles Kafil El-Yatim, connue pour son action auprès des orphelins, la Jeunesse algérienne, la Scoutisme islamique et Hope Dz. Leur participation a permis d’intégrer la voix de la société civile et de mieux cerner la réalité du terrain. La méthodologie suivie s’est inspirée des standards internationaux établis par le GAFI et de l’expertise technique de la Banque mondiale. Elle a combiné des données quantitatives et qualitatives, l’analyse des statuts juridiques, l’examen des rapports financiers et l’évaluation des flux transfrontaliers. Les rédacteurs du rapport soutiennent que ce travail, mené durant plusieurs mois, a permis de livrer une image fidèle et documentée du paysage associatif algérien.
Finalement, ce rapport, destiné à contrer les risques de financement terroriste sous couvert des structures de la société civile, dévoile un double enjeu. D’un côté, l’Algérie dispose d’un mouvement associatif foisonnant, riche en dizaines de milliers d’initiatives qui contribuent à la solidarité nationale, à la culture et au développement local. De l’autre, certains segments, notamment caritatifs et religieux, présentent une fragilité qui impose une attention particulière et qu’il serait imprudent d’ignorer. La stratégie adoptée par les autorités repose sur un équilibre délicat, celui de préserver la liberté et la vitalité de la vie associative, tout en neutralisant toute tentative de détournement. Dans une région où les menaces sécuritaires persistent, la transparence et la traçabilité apparaissent comme des conditions essentielles pour protéger le secteur associatif, garantes d’une société civile forte, crédible et protégée contre toute exploitation malveillante et tentative d’instrumentalisation.
The post Financement étranger des associations : 17 milliards de dinars sous surveillance appeared first on Le Jeune Indépendant.