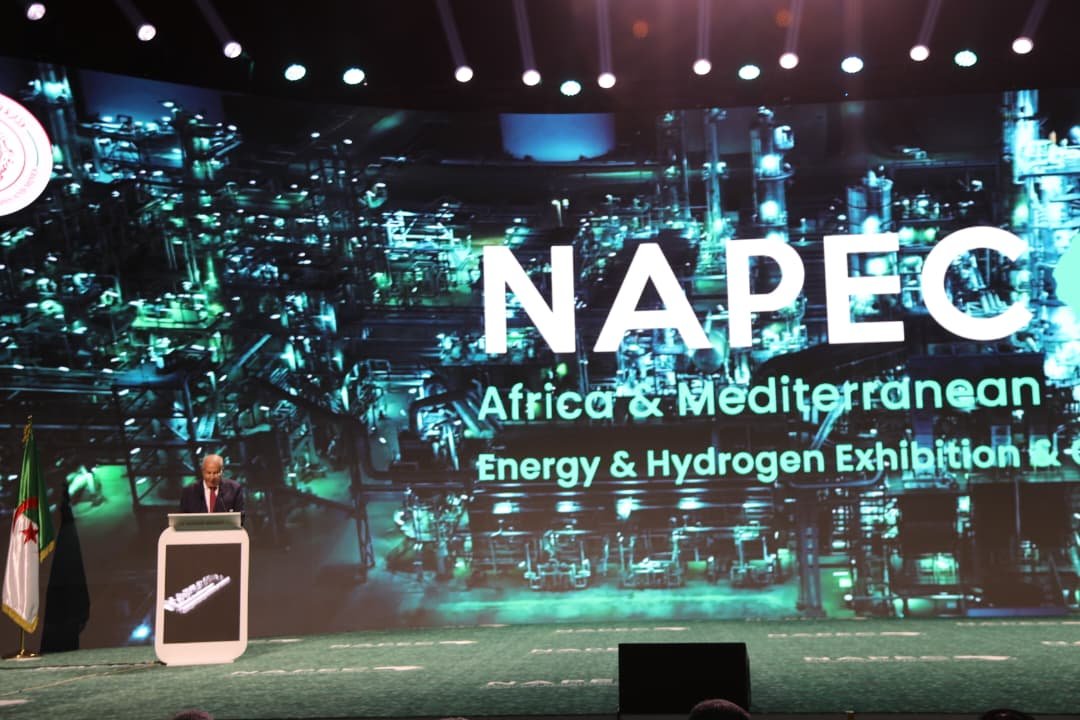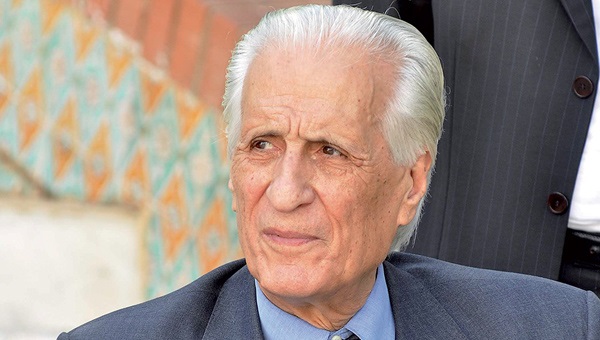Meriem Chabani : « On cherche à suivre les sujets plutôt que les frontières ».
Récemment nommée Design critic en architecture à l’université de Boston, Meriem Chabani est une architecte-urbaniste qui commence à se faire un nom dans l’univers architectural. Pour Dzairworld, la co-fondatrice de l’agence New South nous explique l’approche originale et internationaliste qu’elle a de son métier. Qu’est ce qui vous a poussé à vous tourner vers l’Architecture […] L’article Meriem Chabani : « On cherche à suivre les sujets plutôt que les frontières ». est apparu en premier sur Dzair World.


Récemment nommée Design critic en architecture à l’université de Boston, Meriem Chabani est une architecte-urbaniste qui commence à se faire un nom dans l’univers architectural. Pour Dzairworld, la co-fondatrice de l’agence New South nous explique l’approche originale et internationaliste qu’elle a de son métier.
Qu’est ce qui vous a poussé à vous tourner vers l’Architecture et le Design ?
Meriem Chabani : Mes parents sont venus en France en 1992, puis sont repartis en Algérie en 2012. On a toujours grandi avec l’idée de faire des études en France, de prendre la science et de revenir en Algérie pour construire au sens très large, d’être productif au service du collectif.
Cette forme de déracinement vous a-t-elle amenée à vouloir construire des choses solides ?
Certainement. Cela dit, c’était un peu particulier car jusqu’à mes 18 ans, on passait chaque année toutes les vacances scolaires au pays. J’ai l’impression d’avoir grandi avec un attachement très fort à ma famille là bas, et à la maison dans laquelle on a grandi en banlieue parisienne. Moins qu’un déracinement, c’est plus le fait d’être écartelée entre deux rives. On cherche à stabiliser quelque chose entre les deux.
En 2015 vous créez, avec John Edom, New South. Pouvez vous nous en dire davantage sur cette structure ?
Cela a commencé, en 2015, par une association issue d’un collectif. C’est ensuite devenu une agence – en 2020 – avec une équipe resserrée. Aujourd’hui, je suis associée avec John Edom qui a été anthropologue avant d’être architecte. On travaille à partir du processus de co-conception. C’est une façon, selon John, d’écouter les silences et de faire émerger des récits qui sont invisibles.
Que symbolise le nom de votre agence ?
C’est initialement la volonté de travailler sur la question du Sud. L’idée était d’aborder cela comme une condition issue d’une dynamique de pouvoir et non comme une géographie. Le Sud est par essence une fabrication. Cela nous renvoie à une dynamique entre une position dominante, le Nord – l’exploitation des ressources -, et le Sud qui est le site de l’extraction des ressources humaines, physiques et planétaires. Aujourd’hui, on est dans un monde qui fait face à une crise climatique qui est aussi le résultat de cette dynamique de domination qui s’exerce sur les territoires. L’architecture joue un rôle qui peut être coupable et complice. On se met au service d’un pouvoir qui est en place, d’un client, d’un capital. C’est alors important de comprendre notre rôle dans le renforcement de ces dynamiques. Si on en a conscience, on peut naviguer pour essayer de s’y opposer ou pour faire les choses autrement.
Comment définiriez vous la philosophie de Newsouth ?
On emprunte les mots de l’Afro-féministe Bell Hooks pour définir notre positionnement. On cherche à mettre « la marge au centre » en repositionnant le Sud comme une centralité, comme le lieu de fabrication de la valeur, comme un horizon et une perspective d’avenir. C’est un mode de survie face à des dynamiques de pouvoir extrêmement défavorables.On peut être dans un rôle d’exécutant face à des maitres d’ouvrage qui vont avoir beaucoup de pouvoir. On a beaucoup de responsabilités mais des marges de manoeuvre de plus en plus réduites.Ce qui nous sauve aujourd’hui, c’est la règlementation, ce sont les plans locaux d’urbanisme, les chartes de qualité de certaines villes qui imposent un certain nombre de matériaux nobles en façade, des dimensions minimales pour les logements, où l’accès à des espaces communs. Si ces choses ne sont pas codifiées, c’est très difficile de négocier avec des maitrises d’ouvrage privées ou publiques.
Qui sont ces marges dont vous parlez ?
Ce sont des récits et des identités marginalisés telles que les enfants ou les adultes suivant leur genre, leur âge, leur capacité, leur appartenance raciale, religieuse, ethnique… Cet ensemble n’est jamais considéré comme la norme. Si on regarde ainsi le Modulor de Le Corbusier, c’est un homme standard qui fait 1m80 quand j’en fais 1m55. Il va utiliser ce Modulor pour tout dessiner : les hauteurs de la cuisine, du mobilier, des sièges… Cela crée des lieux qui représentent cette norme tout en excluant les autres corps. Mettre la marge au centre, c’est tuer ce Modulor.
La marge est d’ailleurs plus nombreuse que le centre…
Je ne sais plus qui disait qu’il fallait arrêter de parler « tiers monde » mais de dire : « monde majoritaire ». Cette idée recouvre une réalité qui fait que ces marges sont majoritaires. On habite dans un monde étriqué par une norme très restrictive qui ne tient pas compte de la majorité des habitants de la planète.
C’est ce qui vous distingue de vos confrères parisiens ?
La façon dont on exerce ce métier n’est pas limitée à la question de l’architecture en tant qu’objet – forme – mais plutôt comme une discipline qui permet de synthétiser des conditions qui sont sociale, économique, politique, anthropologique et spatiale. C’est cette interdisciplinarité qui nous définit et la façon dont on cherche à se situer en permanence en faisant valoir – quelle que soit la situation – des postures minoritaires. Par exemple, nous avons travaillé sur un centre culturel en Birmanie pour une maitrise d’ouvrage privée. Nous avons questionné la forme pour se servir de l’argent privé et faire de l’espace public. Il y a eu une négociation avec le client pour concevoir un escalier qui faisait le tour du bâtiment en desservant tous les espaces culturels. Notre position pirate a permis de gratter des éléments qui allaient être au bénéfice du client mais également d’une population plus large tout en rapportant plus d’argent. Nous sommes allés au delà de notre mission pour lui donner d’autres usages et pour que le client se rende compte que cela n’était pas une si mauvaise idée.

Il y a une forme de militantisme qui vous anime, non?
Tout forme d’action nous oblige à faire des compromis. On est une entreprise. C’est davantage la question de la ligne rouge à ne pas franchir. Si on fait du logement, on veut que cela soit de bonne qualité. Comme il y a moins d’argent, on réduit la qualité. La question, c’est à quel moment doit-on dire : « stop ». On essaie d’être vigilants à s’engager sur des projets qui nous permettent de maintenir ce fil éthique. Face à des réalités complexes, on passe d’une jambe à l’autre comme en boxe.
Sur quels types de projets vous positionnez vous ?
On aune position un peu atypique. Une agence d’architecture, c’est un projet. Si cela marche, on nous donne un autre projet similaire. On se spécialise finalement avec un certain type de programme.
C’est le microcosme français que Vous décrivez là ?
Oui, on est dans des boites. Si on est un architecte qui fait du logement, on fait du logement. C’est très difficile d’obtenir un projet de médiathèque ou de salle des fêtes. Pourquoi? Parce que la commande répond à un appel d’offres. Pour être sélectionné, il faut prouver qu’on a fait trois projets similaires. On a été confrontés à cette mentalité. Finalement, on a réussi à obtenir des commandes assez différentes dans les domaines culturel, de réhabilitation ou de transformation de bureaux. Chaque projet qu’on a obtenu, on est vraiment allés le chercher avec les dents. Aujourd’hui, on commence à atteindre un corpus de projets qui nous permet de démontrer de l’expérience sur de l’espace public, sur du logement, sur du bureau et sur des programmes culturels.
Vous arrive-t-il que des clients viennent maintenant vers vous grâce à ce que vous avez réalisé ?
Oui. Il y a même des clients qui sont venus nous voir avant qu’on ait construit des projets parce qu’on s’était positionnés sur un sujet. C’est le cas du projet de la mosquée.Le monde professionnel dans lequel on évolue nous comprend un peu mieux. On peut être appelés pour des sujets où on est le plus pertinent. On a envie de faire notre métier correctement dans un domaine où il y a un besoin.
De quelles manières le Sud vous inspire-t-il ?
Il nous inspire d’un point de vue thématique. C’est une façon de se rappeler qu’il n’y a pas de normes. Ce qu’on considère comme des réalités hégémoniques, ce sont des constructions qui effacent d’autres réalités, d’autres récits et d’autres façons d’être au monde. Une ville comme Alger a été affecté par la colonisation avec la destruction de la Casbah au niveau du front de mer, et par l’importation de modèles avec une forme d’architecture haussmanienne légèrement réinterprétée. Les grands ensembles que l’on construit à tour de bras, c’est aussi de l’importation de modèles. Cela ne vient pas de chez nous. C’est une forme d’architecture standardisée, mondialisée. Il va falloir se demander comment faire émerger quelque chose qui ait du sens localement. En 2017, on avait fait un atelier avec l’université d’Alger. On a fait travailler des étudiants algériens et étrangers sur le vivre ensemble, du quartier (« houma ») jusqu’à la cellule d’habitation individuelle.Comment fait-on des logements collectifs qui aient du sens pour Alger ? Il y a de vraies questions d’agencement et d’aménagement. Il y a un champ d’exploration énorme. Si on s’attelle à cette tâche, on se positionne vraiment en avant-garde et on arrête de récolter les invendus de la pensée internationale.
Le sud, c’est aussi l’Algérie. Sur quel projet avez vous travaillé là bas ?
J’ai beau être algérienne, mon diplôme français n’est pas reconnu en Algérie.Je ne peux donc pas déposer directement un permis de construire. On est donc forcément dans une collaboration avec une entreprise locale. Jusqu’à présent on a eu du mal à faire valoir certaines choses en termes de conception parce que si on ne fait pas comme d’habitude, c’est toujours plus compliqué. C’est important de faire évoluer les choses de manière intelligente et d’éviter la tabula rasa. Je me bats pour qu’on puisse faire émerger des projets qui aient le visage de l’Algérie d’aujourd’hui et de demain.
Vous avez écrit dans un article : « la première mosquée française, c’est pour quand ? ». Que serait selon vous une mosquée française ?
C’est une mosquée qui prend comme point de départ le fait que l’Islam est local.C’est une religion qui n‘est pas par essence étrangère. Elle opère selon les critères qui régissent toutes les constructions faites sur le territoire français : un plan local d’urbanisme, des principes d’insertion urbaine. Elle ne va pas chercher à imiter coute que coute des imitations d’architecture qui viennent d’ailleurs.Ce qui m’intéresse, ce sont les besoins exprimés de manière très concrète par les personnes qui pratiquent l’islam en France. Il y a déjà le besoin de lieux de culte car il y a des difficultés énormes de construction de mosquées. Il y a beaucoup de refus avec la question des autorisations administratives. Dans les faits, on constate aussi une inégalité avec le principe de laïcité. Par exemple, les églises qui sont antérieures à la loi de 1905 peuvent bénéficier de financement public pour leur rénovation. C’est considéré comme du patrimoine.

Vous travaillez sur un projet de mosquée. En quoi sera-t-elle différente des autres ?
C’est une mosquée avec laquelle on a travaillé pendant un an avec l’association The muslim Think tank. Au sein de cette association, on voyait plein de français d’origines diverses et variées qui avaient pour but de penser la place du musulman en France. Un des sujets de réflexion était : qu’est ce que la mosquée de demain? On a passé un an à échanger pour comprendre quelles étaient leurs attentes. Personne ne nous a dit qu’il aimerait qu’il y ait des motifs arabe-andalou sur la façade. Les personnes voulaient que cela soit propre, lumineux, qu’il y ait des livres, qu’on puisse préparer des repas aux nécessiteux, se faire couper les cheveux…C’était des usages de la vie de tous les jours, en communauté. Le projet que l’on a développé s’est orienté sur un bâtiment qui ne soit pas statique. Pour nous, c’est l’essence de l’Islam. Cinq prières par jour veut dire que le corps se met en mouvement cinq fois. On va avoir des ablutions, la préparation des corps à la prière et ensuite un retour au profane. Cela signifie que le bâtiment est utilisé de différentes manières. A telle heure, c’est la prière. A telle autre heure, c’est l’aide au devoir. Spatialement, on a développé une façade mobile avec de la maille métallique. Si elle est fermée ou ouverte, elle raconte une histoire différente. Il y avait aussi l’idée de renouer avec l’innovation technique et technologique qui a toujours été central dans l’architecture sacrée et des mosquées.
A quelle date les fidèles pourront-ils y prier ?
A partir de 2028, si Dieu le veut. On est actuellement dans un temps administratif et de levée de fonds. Il y a un enjeu énorme. Cela représenterait la deuxième plus grande mosquée de Paris en terme de dimension. Il y a aussi pour nous un enjeu de réconciliation car il y a beaucoup de crispation et d’hystérie autour de cette question.Les gens du quartier ne veulent pas d’attroupements les vendredis devant la mosquée. Enfin, ce projet est très transparent avec un volume qui s’ouvre sur la ville d’un point de vue fonctionnel. Il a des programmes ouverts à tous, musulmans comme non musulmans. Et visuellement, elle ne se ferme pas à la ville et au quartier.
Entretien réalisé par Nasser Mabrouk
L’article Meriem Chabani : « On cherche à suivre les sujets plutôt que les frontières ». est apparu en premier sur Dzair World.