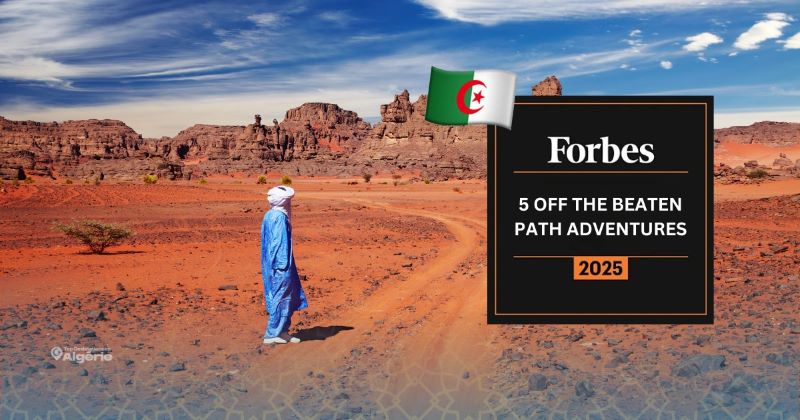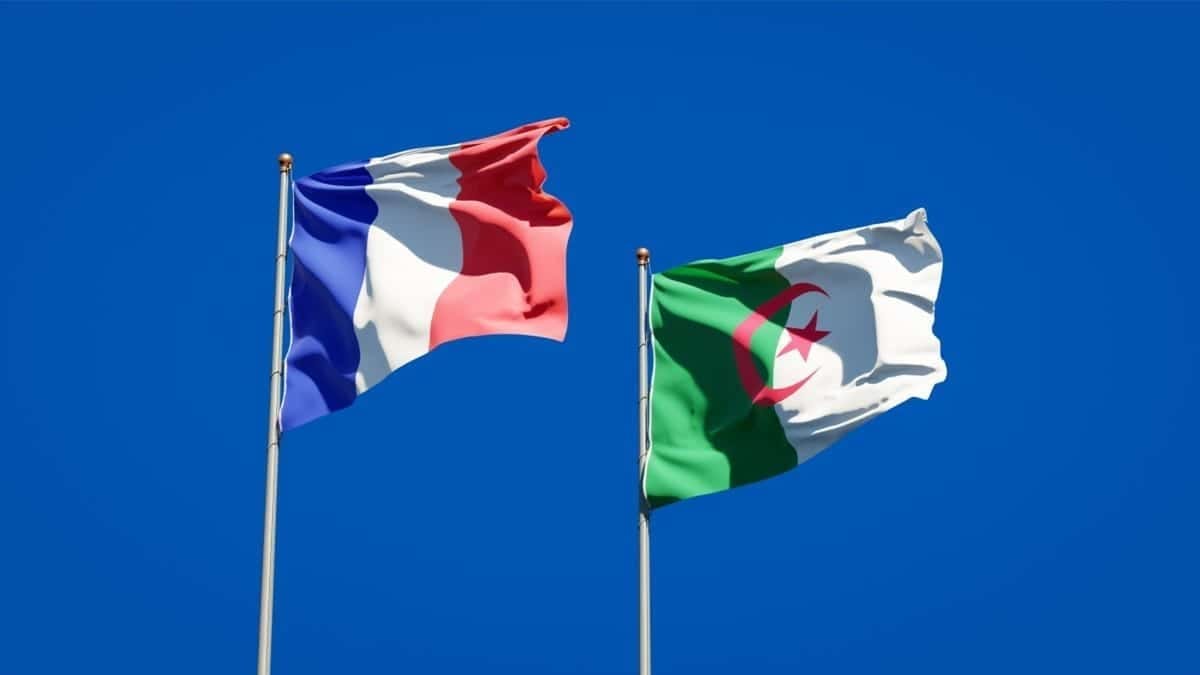Guerre de libération : une stratégie coloniale répressive après le congrès de la Soummam
BEJAIA - L’organisation et le succès retentissant du congrès de la Soummam, le 20 août 1956, ont suscité une réaction violente de l’armée coloniale qui, jusqu’en 1958, y a répondu avec fureur en adoptant une politique répressive et vengeresse implacable, ont souligné des moudjahidine et des chercheurs en histoire. Raids, bombardements, incendie de villages, exécutions sommaires et regroupements forcés de populations dans des zones militarisées, ont été les méthodes employées par l'armée coloniale au quotidien dans toute la vallée de la Soummam, ont-ils relevé, à la veille du 69e anniversaire du congrès de la Soummam. L'armée française a mené une escalade punitive enragée visant essentiellement à terroriser et à dissuader les villageois accusés de porter assistance aux moudjahidine, notamment en matière de ravitaillement, d'hébergement, de soins et de renseignements. "Les méthodes utilisées étaient brutales et sauvages", a expliqué Chaallal Zaidi, un moudjahid de la Wilaya III historique qui note, à ce propos, que "sur la base d’un simple soupçon d’accointance avec les combattants de l'Armée de libération nationale (ALN), des Algériens ont été immolés au feu". "Ils voulaient choquer les esprits et en faire des exemples", a-t-il ajouté, l’esprit encore tourmenté par les horreurs qu'il a vécues. Pour beaucoup, ces représailles n'avaient pas changé de mode opératoire depuis le 1er novembre 1954. Néanmoins, elles se sont ostensiblement radicalisées au lendemain du congrès de la Soummam, soit quelques semaines plus tard, lorsque l’administration coloniale a découvert son existence, selon l’historiographe de la Révolution, Ali Battache. "L’information sur la tenue du congrès n’est parvenue aux oreilles de l’ennemi que près de 30 jours plus tard, tant le secret avait été jalousement gardé", a-t-il souligné à l’APS, expliquant le désarroi et la consternation de toute l’armée coloniale, qui a perçu la tenue de cette réunion comme un pied de nez et un défi à sa puissance, en plus du sentiment d’humiliation ressenti. Le professeur Ouatmani Settar, doyen du département d’histoire de l’université de Béjaia, abonde dans le même sens. Il relève que l’administration coloniale n’a pris connaissance du contenu de la plateforme de la Soummam issue du congrès dans ses moindres détails qu’une fois les actes de cette dernière publiés dans les colonnes du journal El-Moudjahid, ce qui a été un véritable affront pour l'armée coloniale. Outre les renforts envoyés sur place, qui sont ainsi passés d'un effectif de 60.000 à 300.000 hommes en quelques semaines, une stratégie de terre brûlée a été mise en œuvre et appliquée avec férocité. Quatorze villages ont été bombardés, dont Tiliouine qui avait accueilli, avec Ifri, une partie du congrès et qui a été entièrement incendié, a noté le professeur Settar. L'universitaire a souligné que cet épisode "a pris fin avec une bataille éponyme et épique (Tiliouine), survenue en janvier 1958, et qui a vu la soldatesque coloniale payer un lourd tribut".


BEJAIA - L’organisation et le succès retentissant du congrès de la Soummam, le 20 août 1956, ont suscité une réaction violente de l’armée coloniale qui, jusqu’en 1958, y a répondu avec fureur en adoptant une politique répressive et vengeresse implacable, ont souligné des moudjahidine et des chercheurs en histoire.
Raids, bombardements, incendie de villages, exécutions sommaires et regroupements forcés de populations dans des zones militarisées, ont été les méthodes employées par l'armée coloniale au quotidien dans toute la
vallée de la Soummam, ont-ils relevé, à la veille du 69e anniversaire du congrès de la Soummam.
L'armée française a mené une escalade punitive enragée visant essentiellement à terroriser et à dissuader les villageois accusés de porter assistance aux moudjahidine, notamment en matière de ravitaillement, d'hébergement, de soins et de renseignements.
"Les méthodes utilisées étaient brutales et sauvages", a expliqué Chaallal Zaidi, un moudjahid de la Wilaya III historique qui note, à ce propos, que "sur la base d’un simple soupçon d’accointance avec les combattants de
l'Armée de libération nationale (ALN), des Algériens ont été immolés au feu".
"Ils voulaient choquer les esprits et en faire des exemples", a-t-il ajouté, l’esprit encore tourmenté par les horreurs qu'il a vécues.
Pour beaucoup, ces représailles n'avaient pas changé de mode opératoire depuis le 1er novembre 1954. Néanmoins, elles se sont ostensiblement radicalisées au lendemain du congrès de la Soummam, soit quelques semaines plus tard, lorsque l’administration coloniale a découvert son existence, selon l’historiographe de la Révolution, Ali Battache.
"L’information sur la tenue du congrès n’est parvenue aux oreilles de l’ennemi que près de 30 jours plus tard, tant le secret avait été jalousement gardé", a-t-il souligné à l’APS, expliquant le désarroi et la consternation de toute l’armée coloniale, qui a perçu la tenue de cette réunion comme un pied de nez et un défi à sa puissance, en plus du sentiment d’humiliation ressenti.
Le professeur Ouatmani Settar, doyen du département d’histoire de l’université de Béjaia, abonde dans le même sens. Il relève que l’administration coloniale n’a pris connaissance du contenu de la plateforme de la Soummam issue du congrès dans ses moindres détails qu’une fois les actes de cette dernière publiés dans les colonnes du journal El-Moudjahid, ce qui a été un véritable affront pour l'armée coloniale.
Outre les renforts envoyés sur place, qui sont ainsi passés d'un effectif de 60.000 à 300.000 hommes en quelques semaines, une stratégie de terre brûlée a été mise en œuvre et appliquée avec férocité. Quatorze villages
ont été bombardés, dont Tiliouine qui avait accueilli, avec Ifri, une partie du congrès et qui a été entièrement incendié, a noté le professeur Settar.
L'universitaire a souligné que cet épisode "a pris fin avec une bataille éponyme et épique (Tiliouine), survenue en janvier 1958, et qui a vu la soldatesque coloniale payer un lourd tribut".