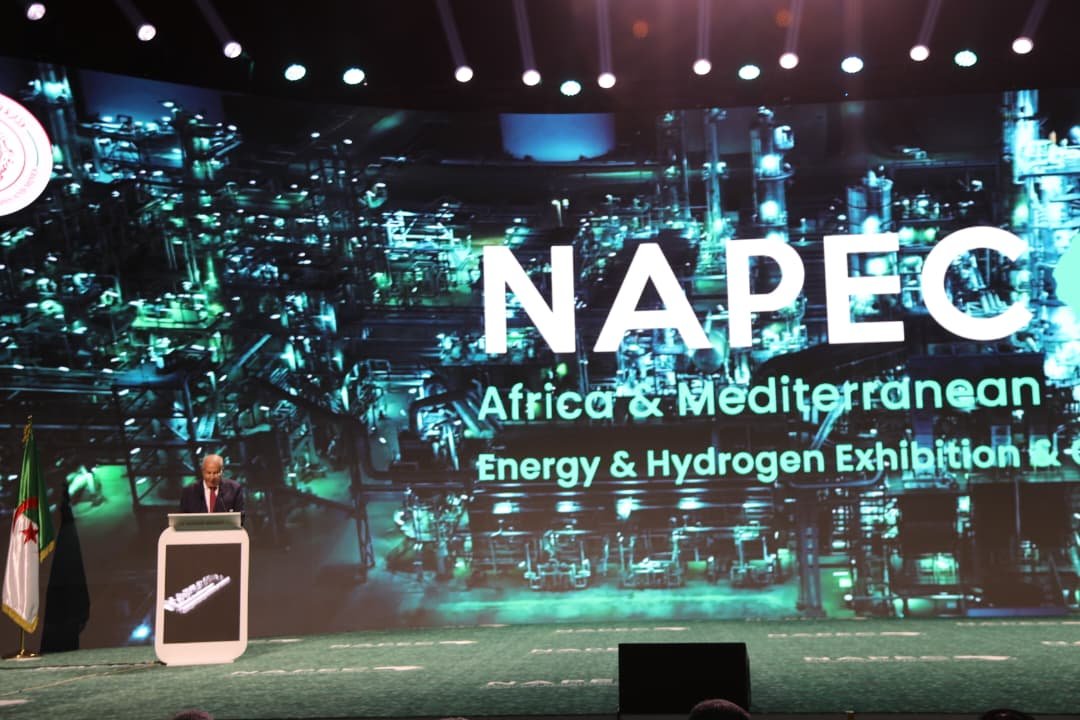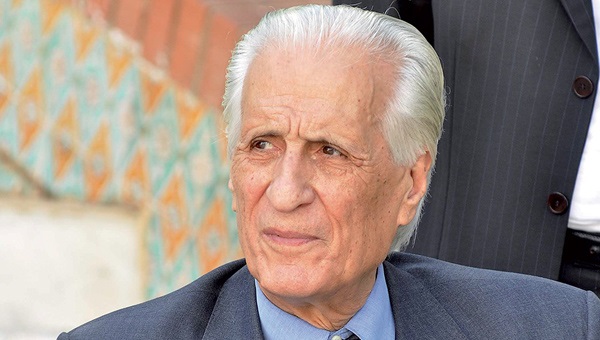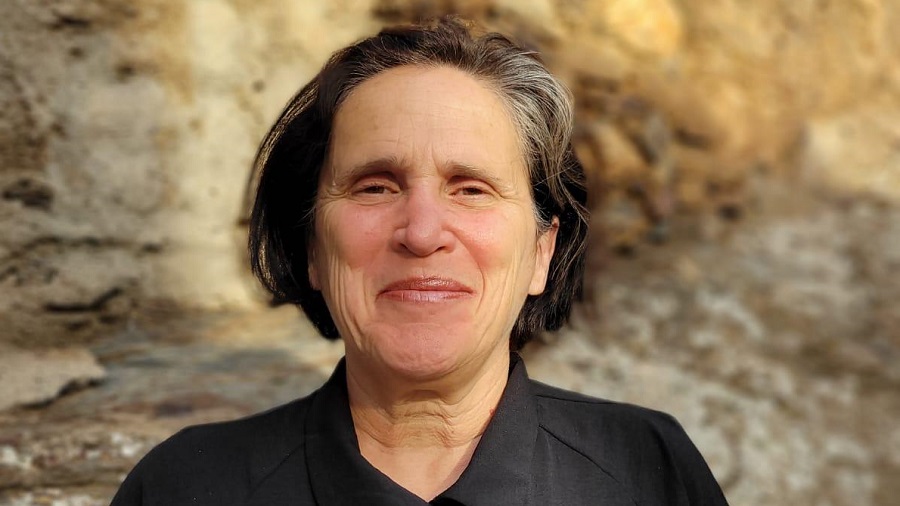L’émancipation stratégique face aux dés pipés de l’ordre international
Une contribution de Saâd Hamidi – Ce triptyque est né d’un constat : la démocratie contemporaine, telle qu’elle est pratiquée et brandie par l’Occident, s’est vidée de sa substance. Derrière les discours d’universalité se cache un dispositif de domination qui marginalise les peuples et les réduit à n’être que spectateurs d’un ... Lire la suite

Une contribution de Saâd Hamidi – Ce triptyque est né d’un constat : la démocratie contemporaine, telle qu’elle est pratiquée et brandie par l’Occident, s’est vidée de sa substance. Derrière les discours d’universalité se cache un dispositif de domination qui marginalise les peuples et les réduit à n’être que spectateurs d’un ordre mondial imposé.
La première contribution, «Palestine : le miroir brisé de la démocratie occidentale», mettait en lumière la manière dont la question palestinienne révèle la nudité des principes démocratiques lorsqu’ils sont confrontés à la réalité du rapport de force.
La deuxième, «La démocratie dévitalisée ou quand le deal devient contrainte», a montré comment la saturation cognitive et la dictature de l’immédiateté ont transformé la démocratie en une mécanique vide, où l’opinion se manipule plus qu’elle ne se construit.
La troisième, «L’émancipation stratégique face aux dés pipés de l’ordre international», propose enfin une perspective : comment les peuples du Sud Global peuvent se soustraire à cette société du spectacle et engager un rapport de force lucide, créatif et solidaire pour reconquérir leur dignité et leur souveraineté.
Ce parcours n’a pas l’ambition d’épuiser la question. Il se veut un appel à penser autrement, à refuser les évidences imposées et à rouvrir le champ des possibles. Disons-le tout haut, le progrès technique, qui engendre la pensée technicienne, et son support le capital financier mondial ne constituent en aucun cas l’horizon indépassable de toute civilisation humaine. La vie ne se résume pas uniquement et exclusivement au confort, elle puise aussi ses racines dans une intériorité riche et féconde vers une totale harmonie avec le réel ! Notons avec force, selon nous, que si la spiritualité dans son acception la plus large est un besoin naturel, la religion, quant à elle, est souvent une réponse culturelle.
Le monde contemporain vit une fracture profonde. Sous les apparences policées de la démocratie et du multilatéralisme se cache une architecture de domination qui place les pays du Sud Global dans une position périphérique et dépendante. La démocratie occidentale, érigée en modèle universel, n’est trop souvent qu’une vitrine : elle se veut séduisante mais dissimule derrière ses paravents un dispositif de contrôle sophistiqué, appuyé par des outils économiques, militaires, technologiques et symboliques.
Le premier pilier de cette domination est monétaire. Le dollar américain, adossé à un système bancaire mondial articulé autour de Swift, fonctionne comme une arme stratégique. Celui qui contrôle la monnaie contrôle le commerce, l’accès au crédit, la possibilité même pour un pays de respirer économiquement. L’exemple des sanctions imposées à l’Iran, à la Russie ou au Venezuela illustre bien cette capacité d’asphyxie. A chaque fois, il s’agit d’un message clair envoyé au reste du monde : l’économie globale est un terrain de jeu dont les règles sont écrites unilatéralement par l’Occident. Le jeu de dés est pipé, mais l’on exige des autres qu’ils s’y prêtent sous peine d’exclusion. Le dollar est notre monnaie mais c’est votre problème, aimait à dire un haut responsable politique américain aux politiciens du Sud Global qui l’invitaient à réfléchir sur le déséquilibre financier mondial et ses répercussions négatives sur leurs économies.
Le deuxième pilier est militaire et sécuritaire. L’OTAN, censée être une alliance défensive, est devenue le bras armé de cette hégémonie. Qu’il s’agisse de la Yougoslavie, de l’Irak, de la Libye ou de l’Afghanistan, les interventions se succèdent au nom de valeurs universelles toujours invoquées mais jamais appliquées de façon équitable. Le message est clair : la sécurité mondiale n’est pas pensée comme un bien commun, mais comme une prérogative d’un bloc qui s’arroge le droit de décider de qui doit vivre en paix et qui doit sombrer dans le chaos.
Le troisième pilier est technologique et informationnel. Internet, qui devait être un espace libre et ouvert, est désormais sous haute surveillance, concentré entre les mains de quelques multinationales qui orientent les flux, contrôlent les données et filtrent les voix discordantes. A cela s’ajoute l’essor de l’intelligence artificielle, dominée par quelques pôles occidentaux, qui risque d’élargir encore davantage l’écart entre ceux qui possèdent les outils de calcul et ceux qui en dépendent. La société du spectacle, décrite par Guy Debord, prend ici une tournure planétaire : un monde où l’image, l’instantanéité et la saturation cognitive étouffent toute pensée critique et empêchent l’élaboration d’une véritable autonomie intellectuelle et politique.
A ces dimensions s’ajoute le contrôle de la santé et de l’alimentation. L’Organisation mondiale de la santé, la FAO et d’autres institutions censées incarner la neutralité scientifique sont régulièrement accusées d’être sous influence, au service des géants pharmaceutiques ou agroalimentaires. Monsanto, pour ne citer que cet exemple, a pu pendant des décennies imposer ses semences transgéniques et ses pesticides, réduisant des pays entiers à la dépendance alimentaire. La crise du Covid-19 a montré combien la maîtrise des brevets, des chaînes de production et des flux logistiques pouvait devenir un instrument de pouvoir planétaire.
Face à cette réalité, la question n’est plus de dénoncer mais de construire une stratégie d’émancipation. Les pays du Sud Global doivent cesser d’accepter de jouer avec des cartes truquées. Ils ont commencé à le faire à travers des initiatives comme les BRICS élargis, les accords de troc énergétique ou les systèmes de paiement alternatifs au Swift. Mais ces efforts restent fragmentés et peinent à constituer une véritable contre-offensive structurée. Or, l’histoire nous enseigne que les dominés ne s’affranchissent jamais par la seule plainte : il leur faut bâtir des institutions nouvelles, tisser des alliances inédites, inventer un langage et une pensée qui ne soient pas calqués sur ceux de l’oppresseur. Digression : j’entends encore résonner dans ma tête la formule choc, ponctuée d’anecdotes dont il a le secret, de feu M’hamed Yazid, leader révolutionnaire algérien, au cours d’une rencontre en insistant sur le fait qu’il fallait retourner contre le colonisateur sa pensée, ses concepts et même sa vision du monde.
La Révolution algérienne, la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, ou encore les résistances latino-américaines face aux dictatures soutenues par Washington rappellent une vérité essentielle : il n’y a pas de dignité sans rapport de force. Les grandes puissances n’ont jamais concédé volontairement aux peuples ce qui pouvait mettre en péril leur suprématie. C’est par une combinaison d’endurance, d’unité et de créativité que les peuples colonisés ou marginalisés ont arraché leur place sur la scène du monde.
Aujourd’hui, le défi est encore plus vaste car il ne s’agit plus seulement d’émancipation politique mais de survie civilisationnelle. Comment réinventer la démocratie pour qu’elle ne soit plus un instrument de domination mais une respiration partagée ? Comment transformer l’économie mondiale afin qu’elle serve la vie et non la spéculation ? Comment utiliser la technologie sans être dévorés par elle ? Ces questions ne concernent pas uniquement le Sud Global : elles concernent l’humanité entière. Mais c’est bien du Sud que peut surgir la réponse, car lui seul vit au quotidien l’expérience du déni et de l’humiliation, et lui seul a encore la force d’imaginer un autre horizon.
Loin d’un fatalisme résigné, cet essai plaide pour une réappropriation. Les peuples du Sud Global ne doivent plus quémander leur dignité : ils doivent l’imposer. Cela suppose de bâtir des alternatives économiques régionales, de renforcer la coopération Sud-Sud, de développer des médias indépendants capables de briser le monopole du récit occidental, et de créer des institutions nouvelles, capables d’équilibrer un système international dévoyé. C’est là le sens d’un véritable réenchantement du monde : non pas un retour naïf à un passé idéalisé, mais l’invention d’un avenir où la liberté, la dignité et la justice cessent d’être des slogans creux pour redevenir des réalités tangibles.
S. H.
(Montréal)