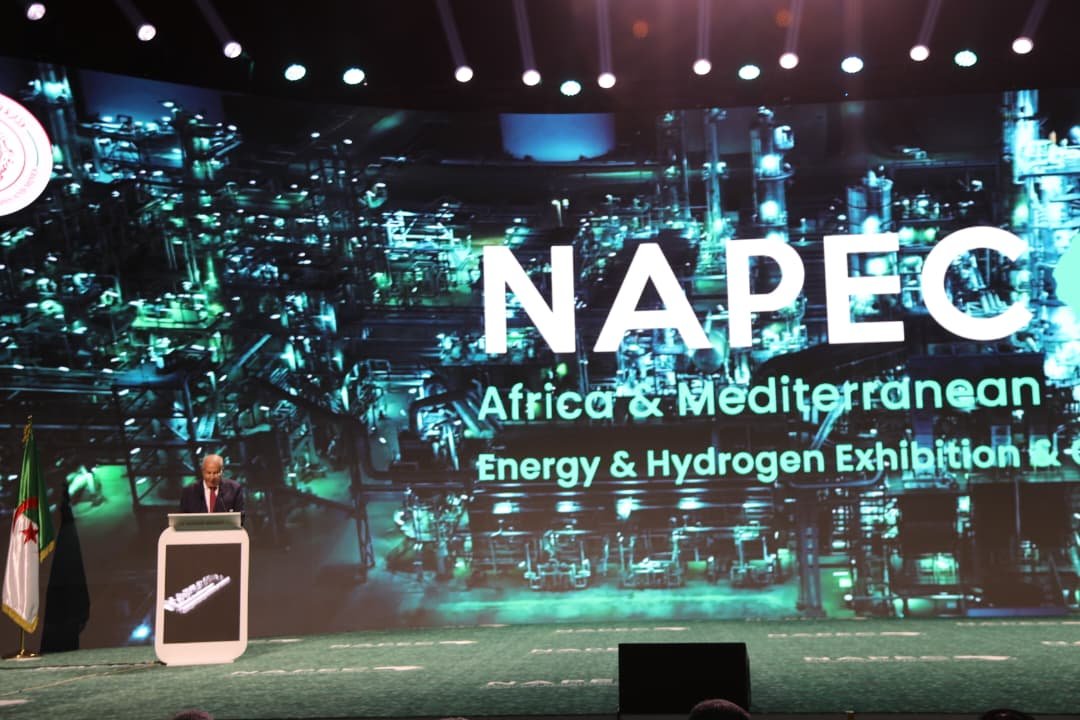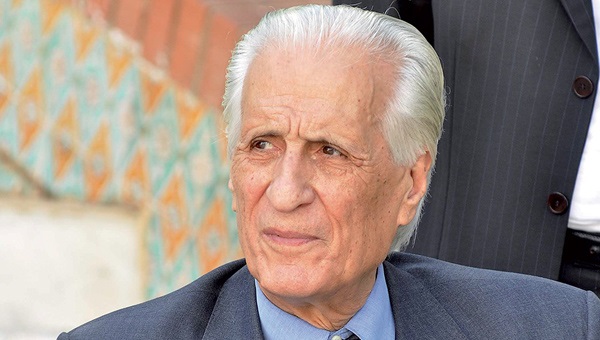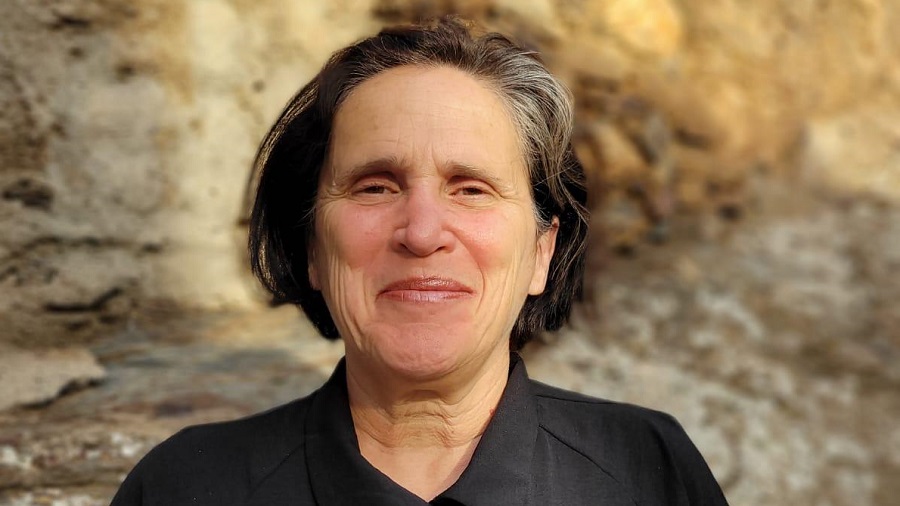Accord Union européenne-Etats-Unis : une capitulation de l’Europe ?
Une chronique de David Cayla(*) – Le 27 juillet dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Donald Trump, se sont entendus autour des grands principes d’un accord permettant de mettre un terme au conflit commercial déclenché par la Maison-Blanche. Le texte officiel de ... Lire la suite

Une chronique de David Cayla(*) – Le 27 juillet dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Donald Trump, se sont entendus autour des grands principes d’un accord permettant de mettre un terme au conflit commercial déclenché par la Maison-Blanche.
Le texte officiel de cet accord a été divulgué le 21 août par la partie européenne. Il est complété par des communiqués publiés sur les sites de la Maison-Blanche et de la Commission européenne qui s’adressent à leurs populations respectives. Le texte de la Commission indique que l’accord «n’est pas juridiquement contraignant», laissant supposer qu’un accord final pourrait être conclu et ratifié par la suite. Pourtant, la procédure permettant de le mettre en œuvre a déjà été engagée par la Commission qui a proposé de supprimer tout droit de douane sur les biens américains importés. Du côté américain, la mise en œuvre de l’accord est également bien avancée, même si la légalité des décrets de la Maison-Blanche fait débat. La Cour suprême est saisie. Elle devrait rendre son jugement en novembre.
L’accord pose de nombreuses questions qui relèvent moins de ses conséquences économiques que de sa portée politique et symbolique. Beaucoup d’observateurs, notamment l’ancien commissaire et ministre de l’Economie Thierry Breton, ont dénoncé les concessions faites par l’UE à la partie américaine. Une proposition de résolution opposée à l’accord a même été déposée par le député Emmanuel Maurel à l’Assemblée nationale.
Le fait est que la stratégie européenne consistant à unir les marchés des différents pays pour peser davantage dans les négociations commerciales semble être prise en défaut. En effet, l’UE va devoir subir des droits de douane de 15% sur ses exportations vers les Etats-Unis alors que le Royaume-Uni, isolé depuis le Brexit, est parvenu à négocier un taux plus favorable de 10%. Ce résultat questionne la légitimité du processus d’intégration européen.
Un narratif américain biaisé
L’argument avancé pour expliquer la différence de traitement entre les économies britanniques et européennes est que les Etats-Unis dégagent un excédent commercial avec le Royaume-Uni alors qu’ils subissent un déficit vis-à-vis de l’UE. Pourtant, à bien y regarder, les chiffres du commerce transatlantique ne sont pas si avantageux pour l’Europe. Certes, en 2024, la balance des biens a affiché un excédent de près de 160 milliards d’euros au profit de l’UE. Mais dans le commerce des services, ce sont les Etats-Unis qui sont excédentaires pour près de 110 milliards. Ainsi, l’excédent commercial total dont bénéficie l’UE vis-à-vis des Etats-Unis n’est que de 50 milliards d’euros. Cet excédent disparaît presque totalement si on tient compte de la balance des revenus primaires qui est déficitaire de près de 45 milliards d’euros. En fin de compte, la balance des transactions courantes sur le commerce UE-Etats-Unis affiche globalement un équilibre, ce qui contredit le discours de Trump sur le caractère déséquilibré de la relation commerciale. Pourtant, à aucun moment, la partie européenne n’a contesté le narratif américain. Elle a, au contraire, semblé accepter l’idée qu’un «rééquilibrage» du commerce impliquait une hausse tarifaire sur ses exportations aux Etats-Unis.
Une grande partie du déséquilibre sur les balances des services et des revenus primaires est liée au secteur numérique et au retard de l’UE dans ce domaine. En septembre 2024, le rapport Draghi avait souligné l’importance de mener une politique de souveraineté en la manière ; faute de quoi, les pays européens risquent de devoir payer aux géants du numérique américains un montant toujours plus important, dégradant par la même les balances des services et des revenus. Afin de développer une stratégie de souveraineté numérique, Bruxelles a engagé une politique de réglementation combinée à des exigences en matière de concurrence et d’accès aux marchés pour les petites entreprises. Le problème est que l’accord ne reconnaît pas le droit des Européens à réguler le secteur numérique. Cela a conduit Trump à menacer l’UE de nouvelles sanctions à la suite de l’amende de près de 3 milliards d’euros infligée à Google le 5 septembre dernier. Le fait que l’accord ne permette pas de sécuriser la stratégie européenne en matière numérique constitue un important problème.
Des orientations stratégiques sacrifiées
L’absence d’un volet numérique n’est pourtant pas l’aspect le plus inquiétant de l’accord. Le problème le plus grave concerne les concessions non commerciales qui constituent autant de renoncements stratégiques de la part de l’UE.
Lors du discours prononcé à l’occasion de sa campagne de réélection à la tête de l’exécutif européen en juillet 2024, Von der Leyen avait déploré que «300 milliards d’euros provenant de l’épargne des familles européennes quittent l’Europe pour les marchés étrangers». Elle s’était engagée à faire en sorte que l’argent européen finance prioritairement des investissements en Europe ; une stratégie qui constituait l’un des axes centraux du rapport Draghi. Pourtant, à rebours de cet engagement, l’accord promet que les Européens financeront un volume de 600 milliards de dollars d’investissements aux Etats-Unis d’ici 2028. Dans ce même discours, la présidente de la Commission affirmait son engagement à réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040. Or, l’accord propose d’acheter 750 milliards de dollars de produits pétroliers et gaziers aux Etats-Unis. Enfin, Von der Leyen s’était engagée à développer une industrie de la défense autonome ; mais dans l’accord, elle propose que l’UE augmente «considérablement» (sans plus de précision) ses achats d’équipements militaires américains.
La lecture de l’accord soulève une question fondamentale. Pourquoi, alors que lors du premier mandat Trump l’UE avec répondu aux mesures protectionnistes de l’administration Trump par des rétorsions commerciales, il n’en a pas été de même cette fois-ci ? La réponse est que l’UE se trouve aujourd’hui dans une position de grande faiblesse économique. L’industrie allemande est en crise depuis 2019 ; une crise qui ne s’est pas arrangée avec la pandémie de Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Pour éviter une quatrième année consécutive de récession, elle a absolument besoin d’exporter. Or, son excédent commercial, qui représentait 6-7% de son PIB dans les années 2014-2019, et tombé à 2-4% ces dernières années. Ce marasme pèse sur les économies d’Europe centrale et explique en grande partie les contestations populistes qui se développent dans ces pays. Ainsi, en acceptant l’accord proposé par Trump, Von der Leyen a surtout cherché à éviter le pire, c’est-à-dire une hausse de 25% des tarifs douaniers américains. Le problème est que, pour sauver le court terme, elle a abandonné le long terme en démontrant au monde entier que les grandes orientations stratégiques qu’elle défendait pour son second mandat peuvent être sacrifiées sur l’autel de la préservation de l’industrie allemande.
Aussi, le danger pour l’UE est que sa raison d’être et sa crédibilité sortent affaiblies de cet épisode. Si l’exécutif européen ne parvient pas à démontrer que «l’union fait la force», et surtout s’il ne parvient pas à élaborer une véritable stratégie industrielle et commerciale qui tienne compte des nouvelles réalités du monde, s’il continue de s’enfermer dans une posture libre-échangiste à courte vue, il est probable que ce qui reste de légitimité au projet européen finisse par disparaître pour de bon.
D. C.
(*) Economiste, université d’Angers (France) Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel avec la revue Recherches internationales