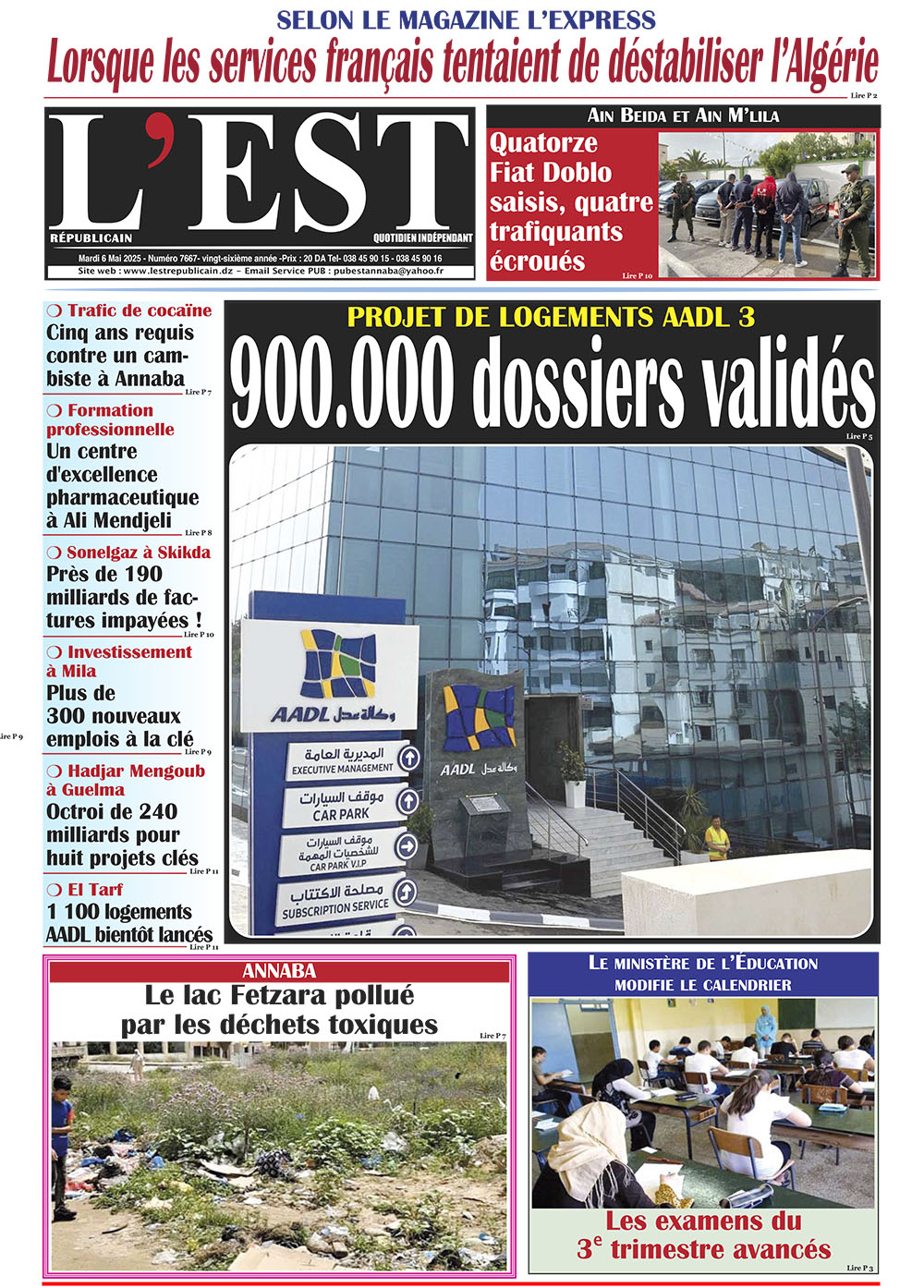Nationalisation des mines: de l'exploitation coloniale à la souveraineté minière et la redirection du sort des ressources souterraines
ALGER - Entre les chapitres de l'exploitation coloniale et la décision de nationalisation, prise après l'indépendance, l'histoire des richesses minières en Algérie se dessine comme le reflet d'un long combat pour la libération, la souveraineté et le développement, qui a permis au pays de passer d'une terre pillée à un Etat maître de son destin, avec la reprise du contrôle de ses richesses et la redéfinition de sa trajectoire économique, à travers des décisions et choix audacieux et courageux. La colonisation française de l'Algérie n'était pas limitée à une occupation militaire, mais représentait principalement un projet économique axé sur le pillage et l'exploitation systématique des ressources du pays, en particulier de ses richesses minérales, notamment le phosphate, le fer, le zinc et le plomb. Depuis les mines de fer de Boukhadra et Ouenza (Tébessa), de Breira (Chlef) et de Beni Saf (Ain Temouchent), aux mines de plomb et de zinc d'Oued El Keberit (Souk Ahras) et d'Ain Zergua (Tébessa), des milliers de tonnes de atières premières étaient expédiées chaque année vers les ports français, comme l'indiquent des historiens. La mine de phosphate d'El Kouif (Tébessa), exploitée jusqu'à son épuisement entre 1929 et 1963, témoigne de l'acharnement colonial dans l'exploitation des ressources souterraines algériennes. Des études indiquent que la production de diverses matières premières minières s'élevait à plus de 1,3 million de tonnes en 1913, tandis que le nombre de mines en exploitation atteignait 40 en 1954, notamment des mines de fer (13 mines), de plomb, de zinc et de cuivre (6), de sel (5) et de phosphate (2), en sus des mines de marbre, de barytine, de pyrite, de charbon, de kaolin, de bentonite et autres richesses souterraines. L'exploitation minière en Algérie, amorcée avec la découverte des mines de fer et de phosphate à Tébessa, a été un pilier de la stratégie industrielle française. Exploitée depuis l'Antiquité, la région a connu une extraction ntensive au profit de la France, notamment durant les deux guerres mondiales, sans bénéfice pour le développement local. Dans les années 1950, l'Algérie fournissait plus de 60 % du fer et près de la moitié du phosphate nécessaires aux industries françaises. Pendant ce temps, les régions minières algériennes souffraient d'exclusion et de marginalisation, et ce sont transformées en bastions de mécontentement populaire et un réservoir de combattants qui n'ont pas hésité à rejoindre massivement les rangs de la glorieuse Révolution lors de son déclenchement le 1er novembre 1954. 6 mai 1966- 6 mai 2025 : près de 60 ans de réalisations et de défis relevés Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie en 1962, le secteur minier était resté sous le contrôle des entreprises étrangères, avec 98% de la production destinée à l'exportation, tandis que la main-d'œuvre algérienne ne représentait qu'un faible pourcentage de cadres et de techniciens. Les sociétés étrangères avaient abandonné les mines qu'elles avaient exploitées au maximum et demeuraient actives uniquement dans les sites encore productifs, tels que les mines de phosphate, de zinc, de fer, de barytine, de charbon et les usines de raffinage du sel. En outre, le secteur a également souffert d'un manque de réserves minérales en raison d'une insuffisance de recherche et de l'utilisation d'équipements vétustes. C'est alors que feu président Houari Boumediene décida et annonça la nationalisation des mines, le 6 mai 1966, déclarant que "l'Algérie s'est réappropriée ses ressources naturelles et sera en mesure de garantir une totale liberté de disposition et d'exploitation de ses richesses". La décision de nationalisation des mines concernait 11 grandes sociétés principalement engagées dans l'exploitation des mines de fer d'El Ouenza et de Boukhadra (Tébessa), celles de zinc et de plomb d'Aïn-Barbar (Annaba) et de Sidi Kamber (Constantine), en plus des carrières de calcaire dans plusieurs régions. Cette décision ne se limitait pas à une simple réappropriation d'un bien, mais s'était accompagnée d'une stratégie globale de gestion et de développement des mines, avec la création du Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières (BAREM), sous la tutelle duquel ont été placées les sociétés minières nationalisées. Par la suite, le 11 mai 1967, la Société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) a été fondée. Au cours de cette période, l'Algérie a dû relever des défis importants notamment le retrait des cadres étrangers qui assuraient la gestion des mines. Malgré ces difficultés, d'énormes efforts ont été déployés pour garantir la continuité des opérations dans le secteur, alors que des milliers de cadres, d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers qualifiés ont été formés, avec le lancement de projets de renouvèlement et de modernisation des équipements et l'ouverture de nouvelles mines telles que Beni Saf (Ain Temouchent), Boukaid (Tissemsilt), Kenadsa (Béch


ALGER - Entre les chapitres de l'exploitation coloniale et la décision de nationalisation, prise après l'indépendance, l'histoire des richesses minières en Algérie se dessine comme le reflet d'un long combat pour la libération, la souveraineté et le développement, qui a permis au pays de passer d'une terre pillée à un Etat maître de son destin, avec la reprise du contrôle de ses richesses et la redéfinition de sa trajectoire économique, à travers des décisions et choix audacieux et courageux.
La colonisation française de l'Algérie n'était pas limitée à une occupation militaire, mais représentait principalement un projet économique axé sur le pillage et l'exploitation systématique des ressources du pays, en particulier de ses richesses minérales, notamment le phosphate, le fer, le zinc et le plomb.
Depuis les mines de fer de Boukhadra et Ouenza (Tébessa), de Breira (Chlef) et de Beni Saf (Ain Temouchent), aux mines de plomb et de zinc d'Oued El Keberit (Souk Ahras) et d'Ain Zergua (Tébessa), des milliers de tonnes de atières premières étaient expédiées chaque année vers les ports français, comme l'indiquent des historiens.
La mine de phosphate d'El Kouif (Tébessa), exploitée jusqu'à son épuisement entre 1929 et 1963, témoigne de l'acharnement colonial dans l'exploitation des ressources souterraines algériennes.
Des études indiquent que la production de diverses matières premières minières s'élevait à plus de 1,3 million de tonnes en 1913, tandis que le nombre de mines en exploitation atteignait 40 en 1954, notamment des mines de fer (13 mines), de plomb, de zinc et de cuivre (6), de sel (5) et de phosphate (2), en sus des mines de marbre, de barytine, de pyrite, de charbon, de kaolin, de bentonite et autres richesses souterraines.
L'exploitation minière en Algérie, amorcée avec la découverte des mines de fer et de phosphate à Tébessa, a été un pilier de la stratégie industrielle française. Exploitée depuis l'Antiquité, la région a connu une extraction ntensive au profit de la France, notamment durant les deux guerres mondiales, sans bénéfice pour le développement local. Dans les années 1950, l'Algérie fournissait plus de 60 % du fer et près de la moitié du phosphate nécessaires aux industries françaises.
Pendant ce temps, les régions minières algériennes souffraient d'exclusion et de marginalisation, et ce sont transformées en bastions de mécontentement populaire et un réservoir de combattants qui n'ont pas hésité à rejoindre massivement les rangs de la glorieuse Révolution lors de son déclenchement le 1er novembre 1954.
6 mai 1966- 6 mai 2025 : près de 60 ans de réalisations et de défis relevés
Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie en 1962, le secteur minier était resté sous le contrôle des entreprises étrangères, avec 98% de la production destinée à l'exportation, tandis que la main-d'œuvre algérienne ne représentait qu'un faible pourcentage de cadres et de techniciens.
Les sociétés étrangères avaient abandonné les mines qu'elles avaient exploitées au maximum et demeuraient actives uniquement dans les sites encore productifs, tels que les mines de phosphate, de zinc, de fer, de barytine, de charbon et les usines de raffinage du sel.
En outre, le secteur a également souffert d'un manque de réserves minérales en raison d'une insuffisance de recherche et de l'utilisation d'équipements vétustes.
C'est alors que feu président Houari Boumediene décida et annonça la nationalisation des mines, le 6 mai 1966, déclarant que "l'Algérie s'est réappropriée ses ressources naturelles et sera en mesure de garantir une totale liberté de disposition et d'exploitation de ses richesses".
La décision de nationalisation des mines concernait 11 grandes sociétés principalement engagées dans l'exploitation des mines de fer d'El Ouenza et de Boukhadra (Tébessa), celles de zinc et de plomb d'Aïn-Barbar (Annaba) et de Sidi Kamber (Constantine), en plus des carrières de calcaire dans plusieurs régions.
Cette décision ne se limitait pas à une simple réappropriation d'un bien, mais s'était accompagnée d'une stratégie globale de gestion et de développement des mines, avec la création du Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières (BAREM), sous la tutelle duquel ont été placées les sociétés minières nationalisées.
Par la suite, le 11 mai 1967, la Société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) a été fondée.
Au cours de cette période, l'Algérie a dû relever des défis importants notamment le retrait des cadres étrangers qui assuraient la gestion des mines.
Malgré ces difficultés, d'énormes efforts ont été déployés pour garantir la continuité des opérations dans le secteur, alors que des milliers de cadres, d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers qualifiés ont été formés, avec le lancement de projets de renouvèlement et de modernisation des équipements et l'ouverture de nouvelles mines telles que Beni Saf (Ain Temouchent), Boukaid (Tissemsilt), Kenadsa (Béchar) et Tamzerit (Bejaia).
Cette année, la célébration de la date historique de la nationalisation des mines se déroule dans un contexte de nouveaux défis et enjeux.
En effet, des projets miniers structurants sont en cours de concrétisation, avec des stratégies ambitieuses visant à réaliser un saut qualitatif dans l'exploitation des ressources naturelles et renforcer la position de l'Algérie sur les marchés mondiaux tout en assurant un développement durable pour les générations futures.
A cette fin, un projet d'une nouvelle loi minière a été élaboré.
Actuellement au niveau du Parlement, ce texte vise à améliorer le climat de l'investissement minier en simplifiant les procédures d'accès aux activités e recherche et d'exploitation, en rendant les démarches plus transparentes et en offrant des conditions plus incitatives aux investisseurs publics, privés, nationaux et étrangers.
Ainsi, le dossier des richesses minières en Algérie est passé du statut de symbole d'exploitation coloniale à celui de pilier de souveraineté nationale, transformant une source de saignée des ressources du pays en base de croissance et d'industrialisation.
Entre la décision de nationalisation et les défis de valorisation, l'Algérie poursuit avec détermination son chemin vers une exploitation rationnelle et durable de ses richesses.
Dans cette optique, le Gouvernement, sous les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a lancé plusieurs projets miniers majeurs, dont la mine de fer de Gara Djebilet à Bechar, en exploitation depuis juillet 2022, le projet de zinc et de plomb à Oued Amizour à Bejaia (34 millions de tonnes de réserves), et le Projet du phosphate intégré à Tébessa, visant à faire de l'Algérie un exportateur clé d'engrais.