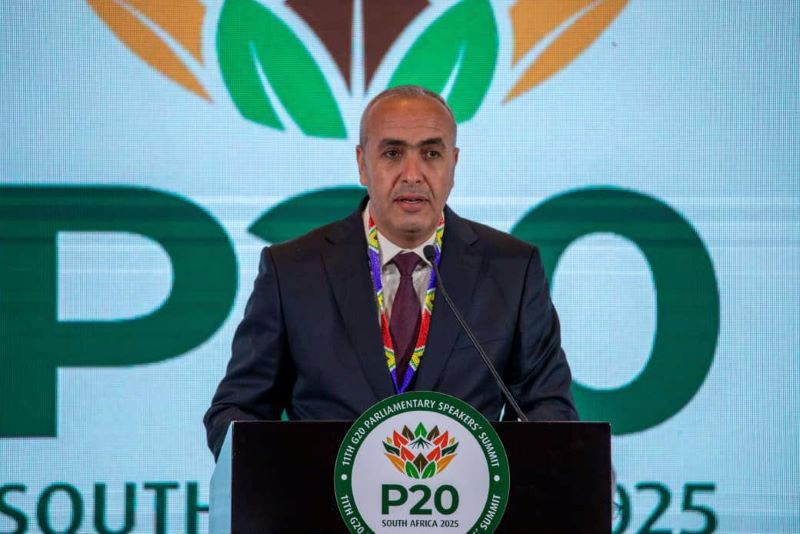« Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna »: Genèse d’une éternelle chanson
Offrande inédite à l’Algérie en fête, la chanson appartient à l’Histoire. C’est un épisode marquant que personne n’a vu venir. Aucun agenda ne l’avait prévu, aucun signe avant-coureur ne laissait présager ce qui deviendra, chemin faisant, une page marquante du récit national. D’aucuns – et ils sont nombreux – évoquent un hymne qui n’ose pas […] The post « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna »: Genèse d’une éternelle chanson appeared first on Le Jeune Indépendant.
Offrande inédite à l’Algérie en fête, la chanson appartient à l’Histoire. C’est un épisode marquant que personne n’a vu venir. Aucun agenda ne l’avait prévu, aucun signe avant-coureur ne laissait présager ce qui deviendra, chemin faisant, une page marquante du récit national. D’aucuns – et ils sont nombreux – évoquent un hymne qui n’ose pas dire son nom : l’hymne à l’indépendance. Mardi 3 juillet 1962.
Il est un peu moins de 20h lorsque, contre toute attente, El Hadj M’hamed El Anka fait son apparition au croisement des rues Marengo, Bencheneb et Darfour à la ligne médiane entre la haute et la basse Casbah. Mandole en main, le maître du chaâbi est accompagné pour la circonstance de quatre musiciens : le banjoniste Mohamed Kabour dit ‘’Moh Tailleur’’, le violoniste Abdelghani Belkaïd, le d’rabki (percussionniste) Ali Debbah dit ‘’Alilou’’ et le t’rarji (tambourineur) Ahmed Chemini.
La signification de la présence du maître en ces lieux est à la mesure de l’importance de cette journée pas comme les autres. Une fois n’est pas coutume, l’artiste, 55 ans depuis le 20 mai 1962, n’est pas venu pour les besoins d’une ‘’sahra’’, sept longues heures de convivialité pour célébrer une circoncision ou un mariage au quartier cher à son cœur. Inhabituellement, l’entrée en matière change. Ça ne sera pas ‘’el farh fi dar lah’bab’’ sous le toit d’une des familles de la Casbah. Ce soir, c’est un moment festif en l’honneur de l’Algérie tout entière.
Dans une petite une heure, le novateur du Melhun va signer une qaâda inédite qui fera date. Ni touchia en guise de prélude instrumental pour installer les convives dans l’ambiance, ni ‘’nasraf’’ suivi d’une première refda avant le moment ‘’henné’’ au rythme de ‘’nedjm ed-doudja’’. Ce soir, c’est une fête pas comme les autres. El Anka et son orchestre ont rendez-vous avec le Jour J, youm listiqlal tant attendu pour lequel le peuple algérien s’est sacrifié sans compter.
Pour la première fois depuis le 14 juin 1830 et le début d’une colonisation sanglante, la Casbah s’apprête à passer sa première nuit dans une Algérie libre et indépendante. Elle le vaut bien, elle qui, à l’instar de tous les lieux du pays, a affronté la plus sanglante des colonisations. A journée historique, qâada tarikhiya ! Depuis l’avant-veille, les éphémérides algériennes se précipitent et s’écrivent à l’encre du bonheur. Le 1er juillet 1962, Mohammed-Idir Halo – son identité sur le registre de l’état civil — avait rendez-vous avec l’urne : le vote au référendum d’autodétermination du 1er juillet. Le disciple du cheikh Mustapha Nador était l’un des 5.975.581 votants qui avaient choisi le bulletin du « oui » pour que ‘’l’Algérie devienne un Etat indépendant’’.
Au matin du 3 juillet, de l’autre côté de la Méditerranée, le général de Gaulle réunit le Conseil des ministres à l’Elysée. Prenant acte des résultats des référendums du 8 avril 1962 (en métropole) et du 1er juillet 1962 (en Algérie), la France — par la voix du chef de l’Etat — ‘’reconnait solennellement l’indépendance de l’Algérie’’. Dès lors, l’actualité s’active à grande vitesse. Vingt minutes plus tard, à Rocher-Noir (Boumerdes), le président de l’Exécutif provisoire, Abderrahmane Farès, reçoit le Haut-commissaire de la France en Algérie. Christian Fouchet lui remet une lettre de de Gaulle prenant acte officiellement de l’indépendance de l’Algérie et transfère à l’Exécutif provisoire les compétences de la France. L’Algérie est officiellement indépendante.
Aux environs de midi, Abderrahmane Farès préside en compagnie d’un jeune scout et d’un djoundi une ‘’cérémonie simple et émouvante’’ de levée officielle du drapeau algérien sur la Cité administrative de Rocher-Noir. Un cliché signé Keystone – une agence photo internationale – a immortalisé l’instant pour la postérité. A 16h26, une Caravelle bariolée aux couleurs de Tunis-Air atterrit à ‘’Maison Blanche’’.
La haut à la Casbah
Le président du GPRA – accompagnés de quelques ministres – pose ses pieds sur le territoire national. Première déclaration sur le tarmac et premiers mots tout en bonheur sur la fin de la longue nuit coloniale : ‘’ (…) Cent trente-deux d’occupation coloniale prennent fin, déclare Benyoucef Benkhedda. Cent trente-deux ans de lutte héroïque, de sacrifices incalculables et de souffrances, sept ans et demi de guerre atroce nous ont été imposés pour arracher le droit le plus sacré pour un peuple, celui de vivre libre et indépendant’’.

Vers 21h, là-haut à la Casbah, ça sera au tour d’El Hadj M’hammed El Anka de ‘’prononcer’’ un discours à sa manière, une ‘’allocution’’ chantée celle-là. « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna », Dieu soit loué, il n’y a plus de colonisation dans notre pays ! Le maître, croit savoir son fils Abdelhadi El Anka (six ans à l’indépendance), s’est mis à l’œuvre trois mois plus tôt.
C’est au moment du dénouement des pourparlers d’Evian le 18 mars et de l’annonce de la conclusion du cessez-le-feu pour le lendemain que l’artiste – auteur, compositeur et interprète – s’est lancé dans l’écriture de cette ode à l’indépendance. Le texte terminé, le concepteur du mandole de chez Bellido l’a aussitôt mis en musique. Quelque deux-cent-cinquante mots, refrains à répétition compris. Comparativement aux autres textes écrits par le cheikh, c’est un q’cid concis que les bibliographes – toutes ressources confondues – l’ont référencé dans le registre ‘’récit de la guerre d’indépendance’’.
Quand il s’est emparé de son ‘’q’lam’’ (plume) pour traduire son ressenti et son état d’esprit en ‘’kilamat’’, l’ami de cheikh Hamada était, sans doute, loin de penser qu’il allait rendre une copie avec une teneur juste glorieuse. ‘’Kalimat’’ pas comme les autres mots, pour reprendre la formule du poète syrien Nizar Qabbani. Inspiré, El Anka l’est incroyablement à l’aube du printemps 1962 et au moment où il choisit de résumer, dans une somme de vers, une résistance nationale de 132 ans dont sept ans à l’épreuve héroïque d’une Révolution à la résonance internationale.
Qu’en en juge : ‘’t’kassar seif al-dholm fel h’roub halkouh ech-chojaâne’’, l’épée de l’injustice a été brisée par les courageux sur le front du combat salvateur. Aspirer à l’indépendance, vouloir la liberté, impose au peuple de briser l’injustice et de pulvériser les chaînes. Du voisin tunisien Abou Kassem Al-Shabi à El Hadj M’hamed El Anka en passant par Moufdi Zakaria qui a connu la Casbah le temps d’un séjour à Souk El Djemaâ, l’ode à la liberté adopte assurément des accents similaires. Lorsque, mettant fin au temps des palabres, le peuple épris de liberté entre en guerre pour son indépendance, l’épée de l’injustice se brise et la chaîne de la domination vole en éclats.

Le 3 juillet 1962, le décor est planté pour être raccord avec l’évènement. La veille, un jeune de la Casbah – artiste de son état – n’a pas oublié la tradition festive : enjoliver le lieu de la cérémonie. Pour la circonstance, il n’a ramené ni guirlandes lumineuses, ni feuilles de palmiers, ni colliers de jasmin. A évènement historique, touche singulière. Ça sera une fresque murale mettant à l’honneur l’emblème national, ‘’abyadh wa akhdar maârouf aâlam’na’’, comme le peint El Anka : une bannière manifestement connue à force d’avoir été portée en mai 1945 à Alger, Sétif et dans le Nord-Constantinois, en décembre 1960 à Alger, à l’occasion des matchs de l’équipe de foot du FLN dans les pays arabes, en Europe de l’Est, en Chine, au Vietnam, etc.
Aux intimes – peu nombreux — qui étaient mis au parfum dès la veille afin de mettre discrètement la main à l’organisation, El Anka leur avait parlé d’une fête pour célébrer l’indépendance. Cependant, il s’est gardé de lever le voile sur la nature du cadeau poétique qu’il s’apprête à dédier à l’Algérie le jour officiel de son indépendance. En fait, il était le seul à savoir qu’il allait célébrer l’indépendance au moyen d’un « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna ».
« Deuxième leqdim »
Le 3 juillet 1962, le cheikh est à la Casbah non pas en tant que résident, mais en dhay’f, un hôte de marque venu du quartier voisin de Bab-el-Oued. Depuis trois ans, le maître de la musique populaire habite à la cité « Taine » à la lisière de Climat de France (le bas de Oued Koriche) et face au cimetière El Kettar. Il y avait déménagé fin 1959 après plus d’un demi-siècle partagé entre le 4, rue Tombouctou (Bir-Djebbah) et le 25, rue Marengo où il comptait, entre autres voisins de proximité Rabah Zaaf dit ‘’Rabah deuxième’’ et Roger Hanin. Au rang des convives qui se sont manifestés spontanément, des habitants de la Casbah, des Algériens venus des quartiers environnants, des moudjahdines et des intimes au rang desquels Hadj Zoubir Mouloudji, la mémoire vivante de la Casbah, décédé en 2023. Autre témoin, Lounis Aït Aoudia, qui préside, aujourd’hui, l’Association des Amis Louni Arezki. Natif – à trois années près – de la même période que Sid Ali, l’un des fils El Anka, Lounis était au rang des présents à la qaâda du 3 juillet.
Dans la mémoire collective des gens de la Casbah, le lieu qui a servi de théâtre à ciel ouvert pour la fête du 3 juillet répond au nom de ‘’deuxième leqdim’’ ou ‘‘l’ancien 2e’’, allusion au commissariat du deuxième arrondissement qui donnait sur la rue Marengo et la rue du Darfour. C’est le principal poste de police de la Casbah intra-muros. Au plus fort de la ‘’Bataille d’Alger’’ – appellation à laquelle l’historien Gilbert Meynier préfère le qualificatif de ‘’grande répression d’Alger’’ –, la Zone autonome d’Alger avait fait de cette adresse sécuritaire une cible à frapper. Les policiers qui y étaient affectés – européens et musulmans – étaient connus pour leurs agissements contre la population et les proches des militants recherchés. Ali la Pointe et Omar Hammadi ont mené une opération audacieuse contre le commissariat.

D’où la décision de la direction de la police générale d’Alger de le transférer plus haut, rue Barberousse, dans un îlot face à la prison Serkadji-Barberousse, au siège de la gendarmerie et à la caserne des ‘’Gardes mobiles’’. Le 3 juillet 1962, si ‘’deuxième leqdim’’ n’est plus opérationnel à son adresse initiale, l’artère principale de la Casbah porte toujours le nom de Marengo, l’un des noms évocateurs du temps colonial. La rue ne tardera pas à porter le nom du chahid Abderrahmane Arbadji, un courageux chef de groupe mort au combat, rue du Diable, à quatre cents mètres du théâtre du récital du 3 juillet 1962.
La qaâda du 3 juillet a failli tomber dans l’oubli, victime du succès de l’enregistrement musical produit par la Télévision algérienne à l’aube de l’indépendance. De surcroit, elle n’a jamais été documentée avec force détails dans les causeries des mélomanes et dans les articles de presse. Auteur de « Le chaâbi d’El Hadh M’hamed El-Anka » — la première biographie dédiée au Maitre (La Maison du Livre, 1981à, Rabah Saâdallah qui a connu le cheikh et l’a interviewé n’en parle pas. Silence également dans l’entretien entre l’artiste et Kateb Yacine.
Daté du début des années soixante-dix, l’échange long de 48 minutes 53 secondes ne fait aucune allusion à la fête du 3 juillet et à l’enregistrement télé. Cinq longues décennies durant, les Algériens revisitaient cet hymne de l’indépendance uniquement via l’enregistrement télé. Rien sur la ‘’première’’ ou l’acte 1 d’ « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna » au bas de la rue de la Casbah. A force de rediffusions à l’occasion des évènements commémoratifs, la chanson n’en finissait pas de s’inviter dans les foyers d’Algérie et ceux de la diaspora algérienne aux quatre coins du monde.

Il aura fallu attendre 2022, année du cinquantième anniversaire de l’indépendance, pour assister au retour du récital dans le débat public. Fondée et portée par des jeunes du quartier, l’association culturelle Ben Mezghenna est la première à l’avoir ramené au-devant de la scène en choisissant d’en faire un évènement digne d’être célébré et commémoré le 3 juillet de chaque année.
Il y a deux ans, outre Hadi El Anka, elle y a convié Omar Hachi, conservateur en chef, chercheur en archivistique et ancien directeur des Archives d’Alger. Né à la rue de l’Intendance (basse Casbah) à l’aube des années quarante, Omar Hachi a enseigné au collège La Victoire à Bab-Djedid avant de former des étudiants à l’archivistique à l’Université d’Alger. Publié à l’automne dernier chez l’ENAG, « El Hadj M’hamed El Anka au panthéon patrimonial de la chanson chaâbie » d’Abdelkader Bendameche n’en dit pas plus sur les tenants de l’acte I.
L’auteur d’une multitude de livres sur des figures du patrimoine musical et poétique algérien parle d’une fête organisée dans une petite salle du quartier. Or, la seule salle dans le coin est le cinéma Nedjma, implantée plus bas que le carrefour Marengo-Bencheneb-Darfour. C’est dire que l’histoire de la qaâda du 3 juillet reste à écrire, une tâche qui relève de l’exercice hypothétique en raison, entre autres, de la disparition de la plupart des témoins qui étaient de la partie au premier rang desquels les quatre musiciens et les intimes du cheikh.
L’OAS n’a pas vaincu
Le lendemain de l’acte 1 d’ « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna », El Anka était en appel au bas de Scala – entre Fontaine Fraîche, El Biar et les Tagarins – pour sa première cérémonie familiale sous les cieux de l’Algérie indépendante. Le 4 juillet, veille de la méga-fête populaire du 5 juillet aux quatre coins du pays, un des amis intimes d’El Anka – le bijoutier Hadj Hamidou — célèbre une fête familiale chez lui. Le maître ne résiste pas à l’envi et au devoir d’aller mettre en mélodie ‘’El farh fi dar’’ Hadj Hamidou. Conforme au rituel en vogue depuis des années, la soirée est plus longue et plus variée : une touchia pour commencer, un insiraf, une première refda, l’instant ‘’henné’’, un bayt wa s’yah et ainsi de suite jusqu’au sacro-saint épilogue : ‘’b’kaw aâla khir wal farh dayam’’ ! Au revoir, la fête continue ou, pour être plus précis, la fête reprend. Et de plus belle. L’indépendance est là, « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna » !
Du jour au lendemain, le moratoire sur les fêtes que les Algériens se sont imposés au sortir d’une guerre sanglante prend fin. A Alger comme dans toutes les villes et villages, les fêtes familiales ne se comptent plus. Un mariage par-ci, une circoncision par-là et une ‘’sbouû’’ entre les deux (cérémonial du septième jour de naissance d’un bébé). Ça festoie un peu partout. C’est un épisode parmi tant d’autres de cette « Histoire populaire », de cette « Algérie de l’été 1962 » étudiée par l’historienne Malika Rahal. Dans le cycle de reprise des fêtes familiales, tout se passe comme si les Algériens veulent répondre à l’unisson — et dans une joie débordante — au terrorisme qui, voilà quelques semaines seulement, promettait de faire de l’Algérie une ‘’terre brûlée’’.
En mariant ses majeurs, en fêtant la circoncision des enfants à commencer – symbole fort – par les orphelins de chouhadas et en célébrant les naissances de l’indépendance, l’Algérie du second semestre de 1962 envoie un message fort aux dirigeants de l’OAS fuyards indignes ou sous les verrous : Non, l’OAS n’a pas vaincu, les ultras ont été défaits. Oui, l’Algérie révolutionnaire a vaincu !
Entre ‘’sahrat’’ (soirées de 21h à l’aube), ‘’dhelat’’ (après-midi festifs) et h’nani, l’agenda d’El Hadj M’hamed ne désemplit pas. Le maître célèbre les fêtes des ‘’h’bab’’ en puisant dans son diwan habituel. « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna » se fait désirer, l’artiste ne l’ayant plus interprété depuis la qaâda du 3 juillet 1962. Avec la crise de l’été 1962 et le conflit entre les compagnons d’armes, le contexte ne s’y prête pas.
Le mercredi 31 octobre 1962, l’Algérie en fête célèbre le huitième anniversaire du déclenchement de la Révolution et fait jouer les prolongations à l’élan de joie du 5 juillet 1962. Comme pour le 3 juillet 1962, l’actualité est multiforme. La veille, mardi, Ahmed Ben Bella, président du Conseil a inauguré la « Place des martyrs » en débaptisant la « Place du gouvernement » au nom des chouhadas. En attendant le 1er novembre – jour de défilé entre le bd Amirouche et la place des Martyrs et l’émission du 1er timbre-poste de l’Algérie indépendante –, Ben Bella et le gouvernement – formé un mois plus tôt – assistent, au cinéma Le Majestic — qui n’est pas encore l’Atlas –, à une soirée artistique sous le thème de ‘’Cent trente-deux années de colonialisme’’. Au programme, lecture de poèmes patriotiques, une courte projection cinématographique, une chorale féminine avant la montée sur scène d’orchestres de musique.
A tout seigneur, tout honneur, le clou de la soirée est assuré par celui qui fait déjà office de doyen de la musique algérienne. El Hadj M’hamed El Anka réédite le coup du 3 juillet 1962. « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna ». C’est l’acte II, cette fois-ci en présence d’hôtes étrangers et de plus de 3.500 personnes.
Léger amendement au texte écrit au pied levé au printemps 1962, le maître du chaâbi introduit l’hymne de l’indépendance par un istikhbar qui sied parfaitement aux circonstances. ‘’Nah’mad rebbi wa nach’kar aâla had es-saâa s’iîda’’, je remercie Dieu pour cet moment heureux, le moment bonheur de la célébration d’un double évènement : le déclenchement de la lutte de libération nationale et, couronnement glorieux, l’indépendance. Cette fois-ci, les musiciens sont plus nombreux et la ‘’kh’massa’’ – refrain – rehaussée des you you qui résonnent dans la salle.
Le 28 octobre 1962
Jamais deux sans trois. Après l’acte I du 3 juillet, l’acte II du 31 octobre, voici venue l’heure de l’acte III : une production TV signée « RTA ». Temps fort dans le processus de recouvrement de la souveraineté nationale, le 28 octobre 1962, des Algériens employés à la RTF (Radiodiffusion-télévision française) hissent le drapeau algérien sur la façade du bâtiment central du 21, bd Bru (qui n’est pas encore débaptisé au nom ‘’des martyrs’’). Ces employés à la compétence reconnue – techniciens, caméramans, journalistes – prennent les choses en main, motivés en cela par un défi doublé d’un challenge : asseoir la souveraineté nationale au 21, bd Bru et doter l’Algérie indépendante d’une TV nationale.
Engagés dans une course contre la montre, les compétences à l’origine de la rupture du 28 octobre 1962 rivalisent de talent et de persévérance pour jeter les bases d’une grille algérienne à l’heure de « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna ». Forts du soutien de leurs collègues cameramen, ingénieurs et techniciens, les « 3 Mustapha » sont au premier rang d’un beau et salutaire challenge dont l’histoire exhaustive reste à écrire.
Les « 3 Mustapha » — la formule est du regretté Mustapha Guenifi — répondent aux noms de Gribi, Badie et Tizraoui. Réalisateurs aux compétences avérées, ils s’illustrent dans la mise en boite des premières productions de la RTA. Gribi, auquel Mohamed Boudia doit son entrée dans le monde du théâtre, est aux manettes dans le registre des comédies, des pièces de théâtre et des émissions enfantines.
Badie (Arezki Berkouk de son vrai nom) s’attaque à ses premiers projets de téléfilms : « Le Serment » et, surtout, « Nos mères », une adaptation à la télé des « Enfants de la Casbah », la pièce de théâtre de Abdelhalim Raïs. En charge de la variété, Mustapha Tizraoui est désigné, lui, pour réaliser « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna ». Nous sommes en décembre 1962, cinq petites semaines après le recouvrement de la souveraineté nationale sur le 21, bd Bru. ‘’Nous avons tourné pendant un mois’’, rappelle au Jeune Indépendant Abdelghani Mehdaoui.
Au début, on a enregistré le son avec l’objectif d’obtenir la meilleure qualité possible. Nous sommes passés ensuite à la prise de vue. El Anka et la chorale ont chanté en playback. C’est le premier exercice du genre dans la carrière d’El Anka’’. Avant d’être promu réalisateur en 1963, Mehdaoui était dès 1959 script avec Mustapha Gribi puis assistant réalisateur.
C’est à ce titre qu’il a œuvré aux cotés de Mustapha Tizraoui à la réalisation de l’enregistrement musical. Le tournage ne s’est pas limité au seul hymne de l’indépendance. Outre « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna », Tizraoui et son équipe ont également enregistré « Welfi Mériem » du poète algérien Cheikh Kaddour Ben Achour Zerhouni. ‘’Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés en priorité sur « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna ». Il y avait urgence à le mettre à l’écran le plus tôt possible. Puis, nous nous sommes attaqués à « Welfi Meriem »’’.
Abdelghani Mehdaoui ne tarit pas d’éloges sur Mustapha Tizraoui et la qualité de son travail. ‘’Professionnel dans l’âme, imaginatif à l’envi, c’est lui qui a mis en scène l’interprétation. Jamais depuis son entrée à la RTF, El Hadj M’hamed El Anka n’a chanté en mouvement, déambulant entre les membres de l’orchestre. L’idée d’un choral accompagnant le maître –El Ankis, Ahcene Saïd, Guerouabi, Tahar Benahmed et Rachid Souki – est également signée Mustapha Tizraoui’’, fait valoir Abdelghani Mehdaoui.
Et le réalisateur – venu du mouvement des scouts musulmans algériens et du théâtre label Mahieddine Bachtarzi et Touri – de souligner la profondeur du texte. ‘’L’écrivain, poète et producteur Mohamed El Habib Hachelaf, qui sait de quoi il parle, dit avoir beaucoup apprécié le texte et sa rime’’. La RTA a mobilisé le meilleur de sa ressource humaine au crédit de l’hymne de l’indépendance et de « Welfi Mériem ».
Autour de Mustapha Tizraoui et de Abdelghani Mehdaoui à la réalisation, il y avait Youcef Sahraoui, et Rachid Merabtine à la prise de vue – direction de la photo et éclairage –, Boualem Akkouche au son, Hacène Chafaï au décor (il était déjà à pied d’œuvre avec la troupe du FLN tout). Ils se sont dépensés sans compter pour être au rendez-vous du challenge. ‘’Mon père passait ses journées au 21, bd des Martyrs et il lui arrivait de faire dans la prolongation de service la nuit’’, témoigne Amine, le fils de Youcef Sahraoui en se faisant l’écho des confessions de son père.
Preuve de l’aptitude professionnelle de la direction de la photo et signe de la confiance qui anime Tizraoui et Mehdaoui, le tournage s’est fait en 16 mm. Ça s’est passé au studio numéro 1, le plus grand des deux studios qui existaient à l’époque. Aidé par Mehdaoui, Mustapha Tizraoui s’est employé à tirer le meilleur profit des volumes du studio numéro 1 : quelque 400 m2 qui permettent de multiplier à profusion les plans à la dolly et le travelling. Youcef Sahraoui et Rachid Merabtine ne se sont pas fait prier pour immortaliser les grands sourires des musiciens et de la chorale.
Professionnellement, l’équipe a été à la hauteur de l’évènement historique et à la hauteur des attentes d’une RTA soucieuse de réussir son départ. ‘’La qualité d’enregistrement est parfaite, les images incroyablement belles, appuie Boualem Gueritli, réalisateur, reporter et auteur. On y relève de très beaux mouvements. Les rediffusions en attestent : soixante-trois ans après le tournage, la copie est très bien conservée. Le kinescope a été un choix pertinent et réfléchi’’.
The post « Al hamdoulilah mab’kach istiîmar fi b’ladna »: Genèse d’une éternelle chanson appeared first on Le Jeune Indépendant.