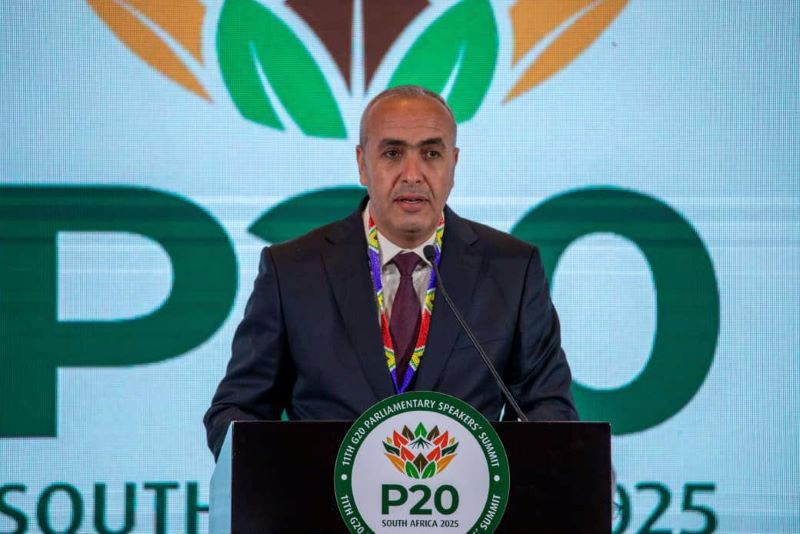Lettres: Keltoum Deffous, la voix insoumise de la poésie algérienne
Il est des voix qui ne se contentent pas de chanter la beauté du monde mais qui, dans leur souffle, portent l’écho des blessures, des résistances et des espérances. Celle de Keltoum Deffous, poétesse algérienne d’expression française née en 1959 à Mila, au cœur de la colline de Lemhasnia qui surplombe aujourd’hui le barrage de […]

Il est des voix qui ne se contentent pas de chanter la beauté du monde mais qui, dans leur souffle, portent l’écho des blessures, des résistances et des espérances. Celle de Keltoum Deffous, poétesse algérienne d’expression française née en 1959 à Mila, au cœur de la colline de Lemhasnia qui surplombe aujourd’hui le barrage de Béni Haroun, appartient à cette lignée.
Par Hafit Zaouche
Fille d’une famille paysanne, petite-fille et nièce de martyrs – vingt-six hommes de sa tribu fusillés le 2 juillet 1956 –, elle a grandi dans une mémoire endeuillée mais fertile, entourée de femmes veuves et dignes qui lui ont transmis la force, la culture et l’amour de la liberté.
Elle aime rappeler que ses racines plongent à Souk El Tenine, dans la wilaya de Béjaïa. Ses aïeux avaient quitté les monts de cette région lors de la révolte de Mokrani pour s’installer, à la fin du XIXe siècle, dans la wilaya de Mila, sur les collines qui font face au barrage de Beni Haroun.
«Je suis née d’une blessure profonde en pleine guerre d’Algérie, je suis une balle perdue sur un champ de tir», confie-t-elle. Et pourtant, de cette douleur, Keltoum a fait jaillir une parole de paix, de réconciliation et d’amour.
Licenciée en littérature française, professeur de français à Constantine, aujourd’hui cheffe d’entreprise et mère de quatre enfants, Keltoum Deffous a choisi la poésie comme arme de combat. Sa plume, tranchante et tendre à la fois, dénonce les hypocrisies sociales, les violences faites aux femmes, les guerres absurdes, tout en rendant hommage à la mémoire des martyrs et au courage silencieux des mères analphabètes de la colonisation.
Ses recueils traduisent ce double engagement : La Colline des rois berbères (mémoire des martyrs), Pauvre petit frère (appel à la paix et hommage à l’enfant syrien Aylan), Grain de sable (primé par le Prix Blaise-Cendrars à Pau en 2017), Rêves de toute femme (droit à la liberté et à l’égalité), ou encore Le foulard rouge de ma colère, Journal d’une fille de trop, et plus récemment Le temps d’aimer son enfer. Autant de cris poétiques pour dire la dignité, l’autonomie et la place de la femme algérienne dans la société.
«Je suis féministe et je ne suis pas sexiste. Je suis insoumise !», répète-t-elle sans détour, refusant d’opposer féminité et combat, foulard et liberté.
Si ses manuscrits déposés en Algérie peinent à trouver éditeur, ses écrits rencontrent en France une reconnaissance
éclatante : Prix Méditerranéen des Jeux Floraux à Narbonne (2017), Genêt d’or à Perpignan (2018), Prix Amavica de poésie d’amour (2018), Premier Prix Poésie à la Journée mondiale du manuscrit francophone à Paris (2018)… autant de distinctions qui consacrent une voix profondément algérienne, mais universelle dans sa portée. Elle est également membre du jury de la Journée du Manuscrit Francophone, et directrice d’un Prix Poésie Africain à son nom, au Bénin, présenté par les Éditions Printemps comme le Prix du roman, au nom de Yasmina Khadra. Une manière pour elle de rendre hommage à notre africanité, sujet phare de nos jours, et de rappeler que la littérature algérienne s’inscrit pleinement dans le souffle d’un continent en quête de reconnaissance et d’unité.
«Etre féministe n’est pas un choix pour moi, mais une obligation vitale», affirme-t-elle, rappelant que la poésie est sa manière de prolonger l’héritage de ses aînées, de la Kahina à Lalla Fatma N’Soumer, en passant par Djamila Bouhired.
Dans son dernier recueil, Le temps d’aimer son enfer, elle convoque ses racines mais aussi des figures inspirantes comme Isabelle Eberhardt, qu’elle appelle «la belle bédouine», exploratrice de l’humain. Ses poèmes chantent aussi Constantine, sa ville d’adoption, «suspendue entre ciel et terre», où elle a grandi en liberté et en savoir.
Poète mais aussi peintre, Keltoum exprime par ses toiles ce que ses vers murmurent : portraits de femmes rurales, gardiennes de la mémoire, sculptrices d’un patrimoine fait de signes, de tatouages, de tapis et de gestes quotidiens.
Son projet ? Etre enfin publiée et diffusée largement en Algérie, afin que les jeunes femmes de son pays puissent lire, dans leurs propres librairies, les mots qui célèbrent leur dignité.
Dans un monde où la brutalité étouffe parfois la beauté, Keltoum Deffous croit encore que les poètes ont un rôle : «Porter l’espérance, semer la paix et rappeler que la beauté sauvera encore une fois le monde».
Et lorsqu’elle confie :
«Mon amour, je suis soldat, je pars en guerre avec toi… Devant tes lumières, toi parfum de la vie, Je m’incline devant ta grandeur, mon Algérie», on comprend que ses poèmes ne sont pas seulement littérature, mais une respiration nécessaire, un acte de foi envers la vie, la liberté et la dignité des femmes.
H. Z.