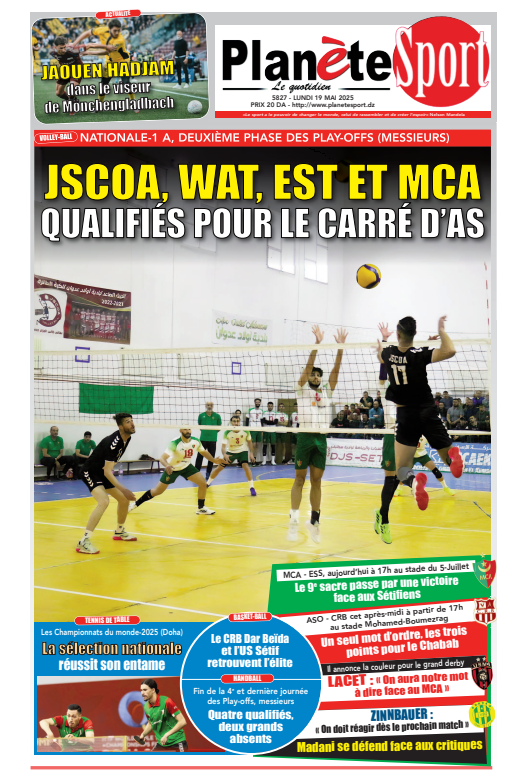Grève des étudiants le 19 mai 1956 : Le jour où l’université rejoignit le maquis
Le 19 mai 1956, l’Histoire s’est écrite dans les couloirs silencieux des facultés désertées. Ce jour-là, des centaines d’étudiants algériens firent le choix radical de tourner le dos à leurs études, à leurs carrières, à leur avenir personnel, pour rejoindre le combat de libération nationale. De ce basculement courageux est né un nouveau souffle révolutionnaire, […] The post Grève des étudiants le 19 mai 1956 : Le jour où l’université rejoignit le maquis appeared first on Le Jeune Indépendant.

Le 19 mai 1956, l’Histoire s’est écrite dans les couloirs silencieux des facultés désertées. Ce jour-là, des centaines d’étudiants algériens firent le choix radical de tourner le dos à leurs études, à leurs carrières, à leur avenir personnel, pour rejoindre le combat de libération nationale. De ce basculement courageux est né un nouveau souffle révolutionnaire, qui a offert à la cause nationale une force stratégique, intellectuelle et diplomatique déterminante. 69 ans plus tard, cette date demeure une source d’inspiration inépuisable pour toutes les générations d’étudiants.
Au lendemain du déclenchement de la Révolution, le 1er novembre 1954, une frange de plus en plus importante de la jeunesse algérienne prend conscience que le savoir seul ne suffit plus à affronter l’oppression coloniale. Le climat est tendu. La guerre d’indépendance s’étend à travers tout le pays. La répression coloniale frappe aveuglément. Dans ce contexte, la jeunesse universitaire, tant en Algérie que dans les universités françaises, commence à s’organiser. En juillet 1955, dans une initiative historique, un groupe d’étudiants fonde l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA). Parmi eux, des noms appelés à marquer l’Histoire : Mohamed Seddik Benyahia, Ahmed Taleb Ibrahimi, Aïssa Messaoudi, Abdelhamid Mehri et bien d’autres encore.
L’Union des étudiants visait à fonder un mouvement national capable, à la fois, de défendre les intérêts des étudiants, d’associer les intellectuels aux problèmes de leur nation et de contrecarrer la propagande coloniale qui avançait que la Révolution algérienne n’était que l’activité d’une bande de brigands.
A l’aube de 1956, le FLN cherche à renforcer son appareil diplomatique, médiatique et sanitaire. Les maquis manquent de médecins, de juristes, d’enseignants, de cadres aptes à structurer un futur Etat indépendant. Les responsables révolutionnaires comme Abane Ramdane, Larbi Ben M’hidi et Amara Rachid savent qu’il est temps d’ouvrir un nouveau front, celui des élites en formation. Des discussions ont lieu dans la plus grande discrétion entre les dirigeants de l’UGEMA et les émissaires du FLN. Très vite, la conviction s’impose, la jeunesse instruite doit passer de la solidarité théorique à l’engagement total.
L’indépendance sans aucune condition
En mars 1956, l’UGEMA a commencé son activité politique en organisant son deuxième congrès à Paris. Ce dernier fut couronné par l’adoption de deux résolutions : l’indépendance de l’Algérie sans aucune condition et l’ouverture des pourparlers entre le Front de libération nationale et les autorités coloniales. Devant le refus des autorités coloniales de ces deux résolutions, une grève générale des étudiants a été déclenchée le 19 juin 1956. Après des mois de préparation, l’UGEMA lance un mot d’ordre historique. Dans un manifeste solennel, l’organisation déclare que « l’Union générale des étudiants musulmans algériens, fidèle à la ligne de la lutte pour la libération, appelle l’ensemble des étudiants et lycéens à cesser leurs activités scolaires pour se joindre au combat. L’heure est grave. Il n’y a plus de place pour la neutralité. Le peuple algérien a besoin de tous ses enfants ». Elle affirme que « l’étudiant algérien n’a pas de devoir plus sacré que de se mettre au service de son peuple et de sa patrie ».
Le Dr Mahmoud Aït Meddour, enseignant-chercheur en histoire contemporaine, a expliqué que la grève de mai 1956 a été précédée de nombreux débats internes, de consultations et d’une volonté claire d’unifier les positions. « Ce n’était pas un geste impulsif. Il s’agissait d’une décision mûrement réfléchie, portée par un idéal collectif. Les étudiants savaient qu’ils renonçaient à leurs études, à une carrière, parfois à la vie, mais ils estimaient que l’honneur de l’Algérie passait avant tout ».
Cette adhésion sans condition à la cause nationale n’était pas seulement symbolique. Elle a eu des conséquences concrètes. Les universités se sont vidées, les facultés ont perdu leurs meilleurs éléments, et la Révolution a gagné une force vive capable d’organiser, de penser, de diffuser. De jeunes médecins, juristes, journalistes, enseignants en devenir ont rejoint les rangs du FLN et de l’ALN, apportant avec eux une expertise précieuse.
Le Dr Noureddine Zerkaoui, enseignant-chercheur en histoire, a souligné, pour sa part, que « la Révolution avait besoin de tous les profils. Les étudiants ont joué un rôle dans les hôpitaux de campagne, les services de communication, la diplomatie parallèle. Ils ont permis au FLN de parler un langage moderne, d’accéder à des cercles jusque-là fermés et de construire une stratégie de légitimation à l’échelle mondiale ».
Le jour où l’université rejoignit le maquis
Le 19 mai, les amphithéâtres se vident à Alger, Constantine, Oran, Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Toulouse. Des centaines d’étudiants rendent leur carte d’inscription, refusent les examens et partent rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), ou travailler pour le FLN à l’étranger. Ce n’est pas une simple grève, c’est un véritable engagement révolutionnaire. Un point de non-retour.
Ce geste, d’une portée inédite, modifie en profondeur l’architecture du mouvement national. Il démontre que la Révolution n’est pas uniquement rurale ou populaire, mais aussi intellectuelle, réfléchie, résolue. Il prouve que la jeunesse algérienne n’est pas passive, bien au contraire elle est actrice, consciente, prête à renoncer à sa trajectoire individuelle pour faire triompher la justice et la liberté.
Parmi ces jeunes, certains vont tomber dans l’oubli, d’autres marqueront durablement l’Algérie indépendante. Mohamed Seddik Benyahia deviendra plus tard ministre et négociateur lors des Accords d’Alger sur l’Iran. Ahmed Taleb Ibrahimi, ancien président de l’UGEMA et étudiant gréviste, deviendra ministre de l’Education puis ministre des Affaires étrangères.
D’autres, comme Hassiba Ben Bouali, rejoignent la clandestinité urbaine. Agée à peine de 19 ans, elle participe activement à la résistance à Alger et meurt dans l’explosion de la cache d’Ali la Pointe, devenant l’icône de la jeune militante sacrifiée. Sa condisciple Malika Gaïd, infirmière formée, meurt en 1957 dans une embuscade alors qu’elle prodiguait des soins aux blessés. Le jeune martyr Taleb Abderrahmane, réputé pour être le chimiste de la glorieuse Révolution, exécuté à la guillotine à l’aube du 24 avril 1958, avait terrorisé la France coloniale par son génie et son engagement sans faille pour l’indépendance de l’Algérie.
Le choix du 19 mai 1956 n’est pas sans coût. Les autorités coloniales excluent massivement les étudiants grévistes des facultés françaises. Beaucoup sont arrêtés, traqués, torturés, ou forcés à vivre dans la clandestinité. Le sacrifice est total. Nombreux sont ceux qui, partis comme étudiants, deviennent des combattants, des martyrs ou des bâtisseurs de l’Etat postcolonial. Tous ont incarné cette jeunesse instruite, patriote, profondément engagée dans la Révolution nationale.
L’arme du savoir, la stratégie de la plume
Tous les étudiants ne prennent pas le chemin du maquis. Certains sont affectés à des missions diplomatiques ou médiatiques. A Tunis, au Caire, à Rabat, à Damas, l’UGEMA devient une sorte de « diplomatie parallèle » du FLN. Les étudiants rédigent des brochures, donnent des conférences, alertent les syndicats et associations étudiantes du monde sur la répression coloniale.
Ils organisent des tournées dans les universités arabes et africaines, tissent des alliances précieuses et forcent le regard du monde à se poser sur la guerre d’Algérie. Grâce à eux, la cause algérienne pénètre les sphères diplomatiques internationales. Le savoir devient une arme d’influence. La parole devient une munition. Conscients que l’enjeu de l’indépendance se joue aussi sur le terrain de l’opinion publique internationale, les étudiants algériens mènent un combat parallèle à celui du maquis, celui de l’image, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de la dénonciation du colonialisme.
Dans les universités européennes, ils organisent conférences, publications, pétitions et rencontres avec des intellectuels, des parlementaires, des journalistes. Cette guerre de mots, de concepts et de récits participe à retourner une partie de l’opinion mondiale en faveur de la cause algérienne.
A Genève, Bruxelles, Rome ou Le Caire, des cellules d’étudiants assurent la liaison avec les ambassades amies, tissent des réseaux de soutien, collectent des fonds, et alimentent les médias étrangers en informations. Pour le FLN, cette branche intellectuelle et engagée est précieuse. Elle apporte un visage moderne, éduqué et structuré à une révolution que la propagande coloniale s’acharne à présenter comme archaïque ou tribale.
En proclamant la Journée nationale de l’étudiant, l’Algérie indépendante a inscrit ce sacrifice dans la mémoire collective. Chaque année, les universités rendent hommage à cette jeunesse exceptionnelle qui a mêlé savoir et combat, plume et fusil, raison et bravoure. Le Pr Zerkaoui résume cet héritage en ces mots « Le 19 mai 1956 n’est pas un souvenir. C’est un cap. Il rappelle que l’étudiant algérien ne se contente pas de diplômes. Il veut participer à l’Histoire, peser dans les choix, défendre les valeurs qui fondent la nation ». Il ajoute que « la mémoire du 19 mai est une boussole. Elle enseigne que l’engagement étudiant est noble, qu’il peut être porteur de transformations profondes, pour peu qu’il soit guidé par des valeurs ».
Aujourd’hui, comme hier, les défis sont nombreux : souveraineté scientifique, sécurité alimentaire, transition énergétique, numérisation, éthique publique.
La jeunesse d’aujourd’hui est appelée à conquérir des espaces d’excellence, à faire rayonner le pays à travers la recherche, l’innovation, l’intégrité et l’engagement citoyen. Aujourd’hui encore, le 19 mai ne doit pas être réduit à une commémoration figée. C’est un appel vibrant à la jeunesse algérienne. Un rappel que l’intellect, l’engagement et la conscience citoyenne peuvent influer sur l’Histoire. Un rappel constant que le 19 mai 1956, les étudiants algériens ont fait le choix de l’Histoire. Un choix lourd, absolu, irréversible. Ils ont abandonné leurs stylos pour porter haut le drapeau de la dignité. Ce geste fondateur devrait continuer à inspirer. Chaque amphithéâtre d’Algérie est un héritier de leur courage. Chaque étudiant est porteur de leurs serments, celui de ne jamais trahir ses valeurs, et de toujours œuvrer pour une Algérie libre, juste, forte et savante.
The post Grève des étudiants le 19 mai 1956 : Le jour où l’université rejoignit le maquis appeared first on Le Jeune Indépendant.