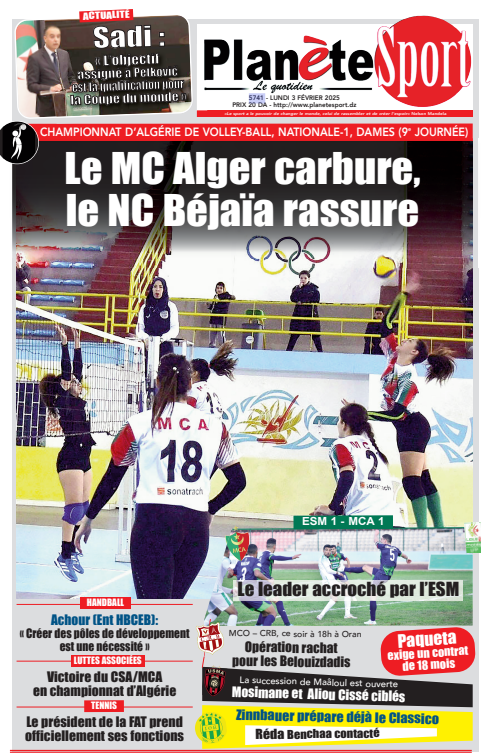Grève des huit jours de 1957 : L’étincelle de l’indépendance algérienne
Dans une démonstration de solidarité et de détermination sans précédent, le peuple algérien a défié la répression coloniale lors de la grève générale de janvier 1957. Huit jours de résistance active ont suffi pour prouver au monde entier la force de l’unité nationale et le refus de la soumission. Face à l’oppression, l’Algérie a tenu […] The post Grève des huit jours de 1957 : L’étincelle de l’indépendance algérienne appeared first on Le Jeune Indépendant.

Dans une démonstration de solidarité et de détermination sans précédent, le peuple algérien a défié la répression coloniale lors de la grève générale de janvier 1957. Huit jours de résistance active ont suffi pour prouver au monde entier la force de l’unité nationale et le refus de la soumission. Face à l’oppression, l’Algérie a tenu bon, inscrivant un nouveau chapitre dans sa lutte pour l’indépendance.
Du 28 janvier au 4 février 1957, le peuple algérien a répondu massivement à l’appel du Front de libération nationale (FLN) pour une grève générale. Menée avec une organisation remarquable, cette action a mis en lumière la détermination inébranlable des Algériens face à l’oppression coloniale. Malgré une répression féroce, elle a également secoué l’opinion mondiale, notamment les médias, qui ont salué la combativité des Algériens, tandis que l’ONU a reconnu, sans ambages, leur droit à l’autodétermination.
Le chercheur en histoire et auteur de plusieurs ouvrages, Amar Belkhodja, a détaillé au Jeune Indépendant les étapes et le déroulement de cette grève, marquée par une répression brutale. « Cette mobilisation répondait à l’appel du FLN, dont la direction collégiale était confiée au C.C.E. (Comité de coordination et d’exécution), issu du Congrès de la Soummam et composé de Abane Ramdane, Mohamed-Larbi Ben M’hidi, Krim Belkacem, Benyoucef Benkhedda et Saad Dahlab », a-t-il affirmé.
Il a souligné que cet organe opérait au cœur même de la ville d’Alger, malgré la féroce répression menée impitoyablement contre les enfants de La Casbah par Massu et Bigeard. L’historien a expliqué : « Le 1er janvier 1957, la lutte armée en est à son 793e jour. L’ALN se bat héroïquement dans les djebels, tandis que dans les villes, les réseaux urbains multiplient leurs actions. L’armée française appelle chaque jour des renforts pour mater la rébellion. Les politiciens français vocifèrent à qui veut les écouter que la victoire est imminente, parlant d’un dernier quart d’heure. Une véritable dérision, car ce fameux quart d’heure se prolonge jour après jour. La résistance durera encore sept ans et demi. »
Selon l’historien, « la France coloniale jouera toutes ses cartes. Elle mise largement sur une solution militaire et déploie un gigantesque arsenal, rappelant la politique de la terre brûlée mise en œuvre lors des premières années de l’invasion par le général Bugeaud ». Concernant la diplomatie, il a précisé que « la question algérienne est considérée comme une affaire interne à la France, une position que la France tentera d’opposer aux instances onusiennes. Cependant, depuis le 20 août 1955, l’ONU ne prête plus attention à la piètre diplomatie française ».
Selon M. Belkhodja, Paris n’était pas prêt à lâcher prise et s’acharnait à faire croire que le FLN ne bénéficiait pas d’un soutien massif, tout en niant la représentation du peuple algérien, qui était en insurrection depuis le 1er novembre 1954. La grève de huit jours, déclenchée le 28 janvier 1957 sur l’ensemble du territoire national, apporte un cinglant démenti aux partisans irréductibles de « l’Algérie française » et place Paris dans une position délicate. Pour ce faire, un communiqué a été rédigé par le FLN pour l’adresser au peuple, qui a répondu, partout et massivement, à cet appel.
Lutte pour la reconquête de la dignité
L’historien a mis en lumière le travail titanesque d’organisation qui a été entrepris. « Un mois avant le déclenchement de la grève, la population fut invitée à prévoir son ravitaillement pour huit jours (mise en stock avant le signal). Les responsables des comités de grève ont été autorisés à effectuer des prélèvements sur les caisses du FLN pour assister les familles nécessiteuses qui n’étaient pas en mesure de couvrir financièrement un ravitaillement de huit jours », a-t-il indiqué.
Il a rappelé que sur le plan psychologique et politique, la population algérienne a vécu, pendant presque un mois, un climat propice à la grève, n’attendant que le mot d’ordre annonçant la date d’arrêt de travail. Puis vient le jour J. Le mot d’ordre de « grève générale » fut suivi partout en Algérie et par toutes les corporations, du 28 janvier au 4 février 1957. Le peuple algérien savait aussi qu’il allait subir « les pires répressions ».
L’historien a indiqué que pour briser la grève, « les forces de l’ordre se sont mises en mouvement dès le premier jour de grève pour punir le peuple algérien d’avoir répondu massivement à l’appel du FLN ». Vingt-deux journalistes ont été dépêchés en Algérie pour couvrir les événements, et tous, ou presque, reconnurent au peuple algérien sa volonté de poursuivre la lutte pour la reconquête de la liberté et de la dignité.
En outre, le chercheur en histoire a indiqué que « le général Massu a d’abord menacé les commerçants en diffusant un communiqué qui stipulait que, « en cas de grève, tous les magasins seront ouverts. S’il le faut, les portes et les rideaux seront forcés pour permettre la libre entrée du public. Les commerçants sont prévenus que, s’ils sont absents une fois leurs magasins ouverts, la sécurité de leur marchandise ne sera pas garantie ». Voilà comment un « Etat républicain » se livre au chantage en « promettant » la mise à sac et le pillage des magasins des grévistes ».
Dès les premières heures de la grève, partout en Algérie, un ordre a été donné pour défoncer les magasins et « réquisitionner » les travailleurs, a-t-il noté. Le déroulement de la grève a été vécu péniblement par les commerçants, comme l’a fait savoir l’auteur : « Les militaires, appuyés par des policiers et les ‘’pieds noirs’’ des unités territoriales, se ruent sur les boutiques et fonds de commerce des Algériens. Haches, poinçons et maillets sont utilisés pour la sale besogne. Un journaliste de télévision américaine fut séquestré pendant toute l’opération de saccage et ses films détruits. Alger se trouve sous haute surveillance, des chars sont postés à tous les carrefours, et la ville est paralysée. »
Malgré cette honteuse démarche visant à ruiner et à affamer le peuple algérien, la grève s’est poursuivie jusqu’au dernier jour, a-t-il noté. Face à cet acharnement du colonisateur durant la grève, l’auteur a rappelé que l’Union générale des commerçants algériens s’est comportée dignement et a dénoncé les abus de l’ultimatum lancé par Massu : « La plus haute autorité française ne se contente pas de contester notre droit à la grève, mais elle nous menace également dans nos biens. Pire, elle lance un appel aux pillards de toutes sortes en leur promettant implicitement l’impunité », souligne alors un communiqué de l’UGCA. présidé par M. Abbas Turqui.
Sanctions impitoyables
Le même sort a été réservé aux ouvriers et fonctionnaires grévistes, lesquels ont été soumis aux interventions musclées des bérets verts venus les « réquisitionner » pour les embarquer dans des camions militaires et les « répartir » ensuite vers leurs lieux de travail. Peine perdue. « Il aurait fallu des moyens titanesques pour conduire chacun vers son poste de travail. Partout en Algérie, les fonctionnaires, ouvriers et instituteurs ont été arrêtés et ramenés par la force des armes vers leurs lieux de travail », a déclaré l’auteur. « Des sanctions impitoyables sont tombées : mutations d’office, suspensions, licenciements et peines de prison. A Alger, presque tous les traminots furent licenciés. Les mêmes sanctions frappèrent une soixantaine d’hospitaliers. Malgré cette honteuse démarche de vouloir ruiner et affamer le peuple algérien, la grève s’est poursuivie jusqu’au dernier jour », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, la grève a eu un écho retentissant à l’échelle internationale, suscitant des réactions tant dans la presse mondiale que dans les instances diplomatiques, notamment l’ONU. D’abord, la presse internationale (arabe et occidentale) est unanime sur le succès de la grève des huit jours. « Le peuple algérien, aguerri par deux ans de lutte, ne montre aucun signe de faiblesse. La grève générale qu’il a déclenchée pour huit jours suscite admiration et respect. La lutte de ce peuple fait partie d’un mouvement global et marque la fin de l’impérialisme, dont la chute ne saurait tarder » (Ech-Chaâb, 28 janvier 1957).
Ensuite, le Monde des 3 et 4 février 1957, sous la plume de David Rousset, souligne également : « Que voulons-nous démontrer ? Que nous disposons de plus de moyens militaires que nos adversaires ? Ce fait est acquis. Mais si nous croyons ainsi mettre en évidence leur faiblesse politique et montrer l’influence marginale qu’ils exercent sur la population, c’est que nous vivons dans un univers d’illusions obstinées. »
Côté ONU, le problème algérien est désormais internationalisé. Le 15 février 1957, l’Assemblée générale des Nations unies adopte, à l’unanimité des 77 votants, la résolution suivante : « L’Assemblée générale, ayant entendu les déclarations des diverses délégations et discuté la question algérienne, considérant la situation en Algérie, qui cause beaucoup de souffrances et de pertes de vies humaines, exprime l’espoir qu’une solution pacifique, démocratique et juste sera trouvée dans un esprit de coopération, par des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations unies. » Cela signifie tout simplement que le droit du peuple algérien à l’autodétermination a été reconnu, a indiqué le chercheur en histoire Amar Belkhodja.
« Toutefois, les Français persisteront dans la conduite de la guerre d’oppression, généralisant le crime collectif partout sur le territoire et institutionnalisant la torture, en affectant des « tortionnaires professionnels », munis d’un attirail approprié destiné à humilier et à faire souffrir les hommes », a-t-il tenu à préciser. « Mais le peuple algérien qui, en 1957, avait totalisé 200 000 morts, n’était pas prêt à abandonner la lutte ni à marchander son sacrifice. Sous la conduite de son avant-garde patriotique, incarnée par le FLN, il poursuivra son combat armé et sous d’autres formes pour conquérir ses libertés », a-t-il ajouté.
La grève des huit jours ne fut pas un simple test. Elle a prouvé le niveau de conscience politique du peuple algérien, ses capacités de résistance, son esprit de sacrifice face aux souffrances, et sa volonté de poursuivre le combat libérateur, a conclu Amar Belkhodja.
The post Grève des huit jours de 1957 : L’étincelle de l’indépendance algérienne appeared first on Le Jeune Indépendant.










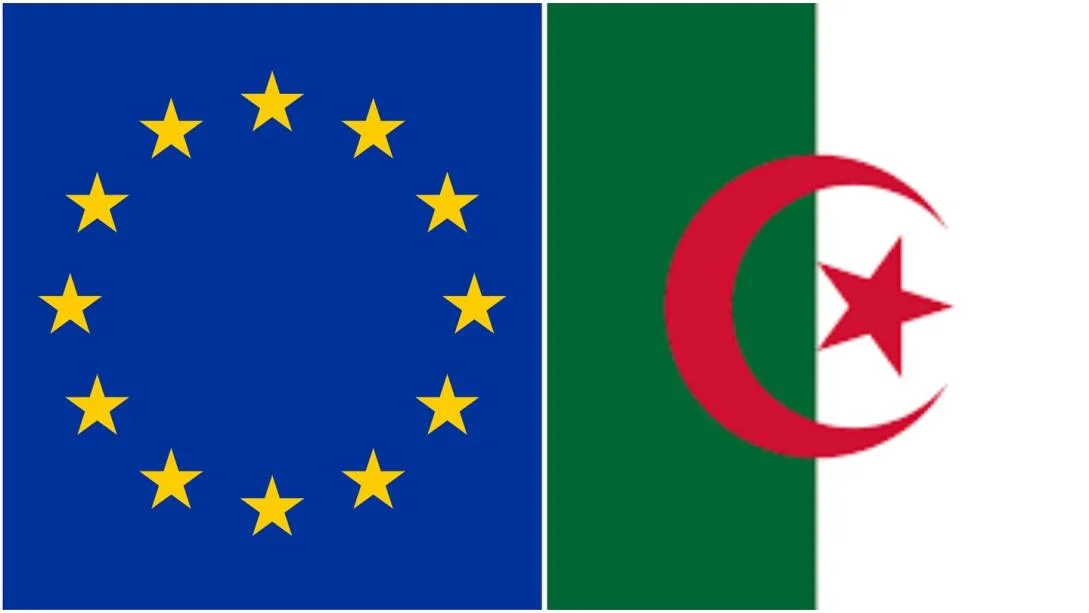



































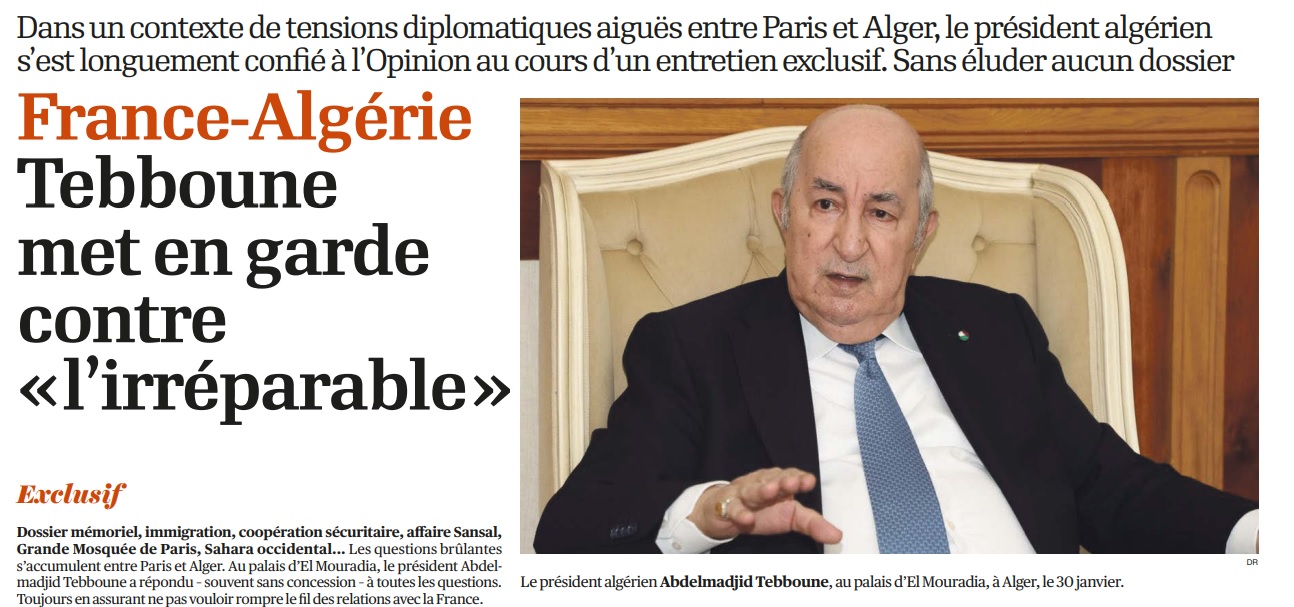


















![[ Vidéo] Ali Aoun « ont été fixés à 18 mois »](https://djaz.news/uploads/images/202412/image_430x256_6759abcdf1951.jpg)
![[Reportage photos] Merck et LDM ,transfert de technologie.](https://djaz.news/uploads/images/202412/image_430x256_6759abcd329f4.jpg)