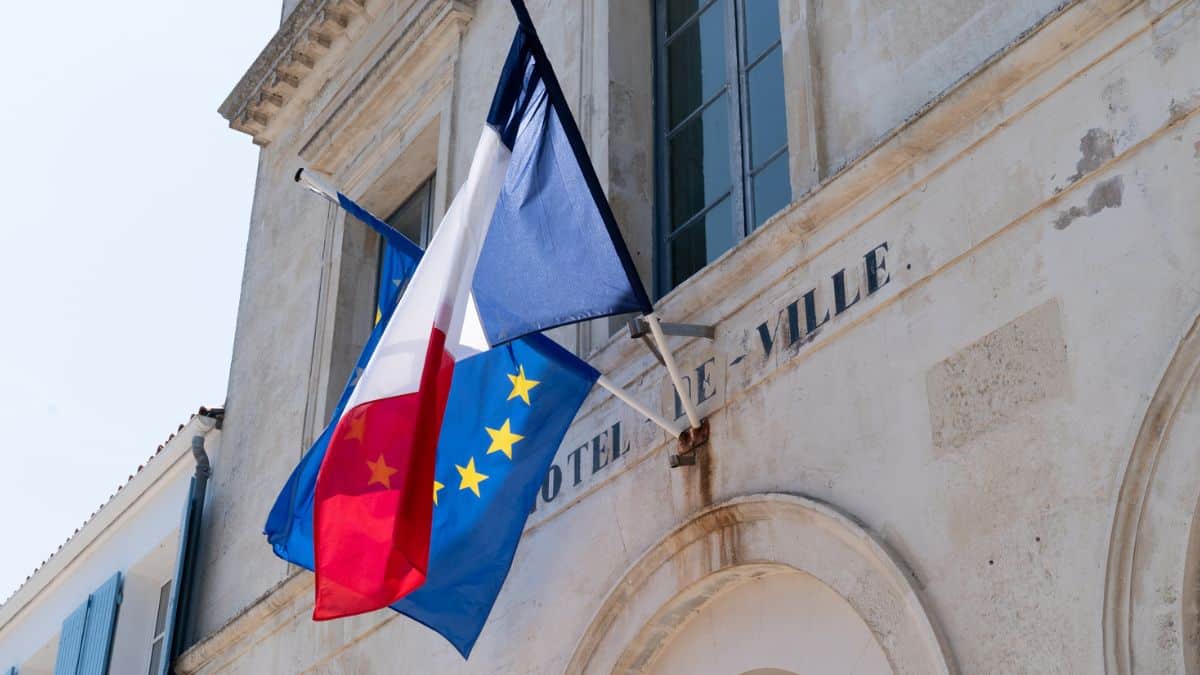L’auteur Aïmen Laïhem au JI: «Je voulais créer un rythme haletant, à l’image des taxis d’Alger»
Avec Taxis, son tout premier roman publié aux éditions Barzakh, Aïmen Laïhem signe un texte singulier et sensible, à la croisée de la littérature, de l’observation sociale et de la dérive urbaine. Architecte de formation, formé à l’EPAU à Alger puis en urbanisme à Paris, il fait d’Alger une scène mouvante, floue et fascinante, à […] The post L’auteur Aïmen Laïhem au JI: «Je voulais créer un rythme haletant, à l’image des taxis d’Alger» appeared first on Le Jeune Indépendant.

Avec Taxis, son tout premier roman publié aux éditions Barzakh, Aïmen Laïhem signe un texte singulier et sensible, à la croisée de la littérature, de l’observation sociale et de la dérive urbaine. Architecte de formation, formé à l’EPAU à Alger puis en urbanisme à Paris, il fait d’Alger une scène mouvante, floue et fascinante, à travers les pérégrinations d’un narrateur en retrait, passager silencieux d’un monde en tension. Lauréat du Prix Mohammed-Dib 2025, il revient ici sur son parcours, ses influences et l’acte d’écrire comme une tentative de compréhension du réel, dans ce pays où le taxi devient tour à tour confessionnal, observatoire et lieu d’errance existentielle.
Le Jeune Indépendant : Avant de plonger dans l’univers de Taxis, j’aimerais revenir un instant sur votre parcours. Comprendre d’où vous venez, quelles expériences vous ont façonné… C’est, en quelque sorte, saisir ce qui alimente votre voix d’auteur. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Aïmen Laïhem : Je suis né, j’ai grandi et ai étudié à Alger. J’ai suivi tout mon parcours dans l’école publique, jusqu’à l’université algérienne, où j’ai été formé en architecture. C’est dans cette ville, à travers ses ruelles, ses contrastes et ses paysages, que j’ai appris à regarder, à m’émerveiller et à questionner. J’ai découvert mon environnement par ses richesses, parfois visibles, parfois enfouies et surtout par une curiosité constante qui m’a toujours poussé à vouloir comprendre davantage.
Je suis de nature créative, peut-être parce que j’ai toujours ressenti le besoin de dépasser les limites que le monde nous impose. J’ai commencé par les livres, les atlas, les encyclopédies, puis la littérature est arrivée, naturellement. L’écriture, la poésie, le dessin aussi, m’ont permis d’explorer cette créativité. Plus tard, les études en architecture, puis en urbanisme, m’ont donné une autre échelle d’analyse : comprendre les espaces, les villes, et les logiques qui les façonnent.
Bien au-delà d’une simple toile de fond, Alger occupe dans Taxis une place centrale, presque organique. En quoi votre lien avec la ville influence-t-il votre manière de la représenter ?
Je crois que la ville dans laquelle on vit nous façonne autant que nous la façonnons. Dans Taxis, le narrateur est conçu comme quelqu’un qui pense ne pas bien connaître sa ville. Il la redécouvre avec des yeux d’enfant, empreints de candeur et de douceur, sans imaginer un instant que cette ville, en retour, raconte énormément de choses sur lui.
Dans le récit, les pérégrinations en taxi donnent lieu à une fresque sociale fine et nuancée. Cette approche, à la fois littéraire et sociologique, intrigue. Comment est née l’idée de faire du taxi un observatoire mobile de la société algéroise ?
Cette idée est née d’une observation attentive des taxis, des chauffeurs et de leurs clients, justement ! Ce cadre me fascinait parce qu’il offrait un espace restreint, presque intime, à l’intérieur duquel pouvaient surgir mille digressions : des banalités du quotidien, des rêveries fugaces, mais aussi des discussions plus graves, plus conflictuelles, sur des sujets qui comptent vraiment. Le taxi devient alors un théâtre en mouvement, un lieu de confidences éphémères où se dessinent les contours d’une société.

Le schéma narratif de votre roman s’éloigne des structures traditionnelles. Comment avez-vous pensé l’organisation du récit, en particulier ce choix de forme donnant une place importante au dialogue ?
J’ai voulu construire un rythme saccadé, haletant, qui reflète l’ambiance des taxis d’Alger. On n’y trouve aucun répit, même dans les embouteillages ! Les dialogues sont venus naturellement, comme une façon de briser la narration à la première personne du singulier portée par le protagoniste. Ils permettent d’introduire d’autres voix, d’autres regards, et d’ouvrir le récit à une forme de polyphonie qui sert de points d’appui et de respiration dans le tumulte du texte.
Le recours au daridja dans un texte rédigé en français confère au récit une impression d’authenticité. Ce choix linguistique répond-il à une volonté de réalisme, en restituant fidèlement la langue du quotidien des Algérois, ou relève-t-il avant tout d’un parti pris stylistique ?
Il y avait plusieurs éléments qui se sont imposés d’eux-mêmes. D’abord, écrire en français implique déjà un certain écart avec le réalisme : une part de nous est forcément portée autrement par la structure de cette langue. Ensuite, les nombreux dialogues qui rythment le texte me venaient spontanément dans différentes langues et expressions. Cela reflète tout simplement le processus linguistique que vit au quotidien quelqu’un qui jongle naturellement avec plusieurs langues. Et, en tant qu’Algériens, nous avons cette chance-là.
Le protagoniste-narrateur de Taxis reste peu défini, en retrait, presque spectateur de sa propre vie. Son étrangeté, son détachement rappellent parfois des accents camusiens, par-dessus le marché. Que cherchez-vous à exprimer à travers ce flou identitaire et cette dimension de l’absurde ?
Il y avait une volonté de négation dans la description. Comme si le fait d’entretenir le flou tout en proclamant constamment le « je » de la narration créait une forme de revendication. Cela est peut-être né d’une volonté de raconter les histoires de celles et ceux qui se sont trop tus jusqu’à s’effacer eux-mêmes. Par ailleurs, il s’agit surtout d’interroger le degré de soutenabilité auquel on est soumis face à des situations sordides et absurdes qui nous poussent à baisser les bras. On développe alors une forme d’indifférence teintée de beauté dans le laisser-aller.
Serait-il possible d’en apprendre davantage sur cette part qui concerne ses liens affectifs et intimes ?
Les relations et les interactions sociales du personnage-narrateur sont pour le moins chaotique tant sur le plan amical, amoureux que maternel. Ça a été voulu comme le pendant d’un mal-être profond, qui pousse au rejet des autres, en commençant par le rejet de soi-même.
Aussi surprenant soit-il, ce personnage quitte Alger pour Montréal, mais revient sur ses pas. Le truc, c’est qu’au Canada, on monte à l’arrière quand on prend un taxi, pas devant, du coup il rate la vue sur la ville, quoi. Comment interprétez-vous ce va-et-vient ?
Par le fait que sa perception des choses change radicalement. Il prend conscience des privilèges qu’il a perdus en changeant d’environnement – des privilèges dont il ne se rendait même pas compte lorsqu’il vivait à Alger. Parfois, ce que l’on déteste finit par se transformer en une réelle affection.
De ce point de vue, le taxi serait-il aussi, en filigrane, une grande allégorie faisant écho à la drogue qui porte le même nom et qui gangrène la société algérienne ?
Oui, mais pas que : les taxis sont autant de choses que l’on peut se permettre, prendre, explorer et découvrir pour s’extirper d’une situation qui nous est pesante.
En lisant Taxis, on sent que vous avez une belle plume, à la fois sobre et évocatrice. Comment avez-vous travaillé ce style ?
Cela m’est venu principalement par la lecture, mais aussi en développant une oreille musicale grâce aux chansons et à leurs paroles. Le rythme propre à la poésie, tout comme la lecture à voix haute, ont également joué un rôle important dans l’affinement de mon écriture.

Être récompensé si tôt par un prix aussi prestigieux que le Mohammed-Dib 2025 pour Taxis est une belle consécration ! Qu’avez-vous ressenti en apprenant cette nouvelle ?
C’est un honneur immense, d’autant plus qu’il s’agit de mon tout premier livre ! Le fait qu’il soit d’ailleurs associé à l’œuvre monumentale de Mohammed Dib est une source de fierté inégalable ! Cela me motive à poursuivre cette aventure littéraire avec enthousiasme, attention et rigueur.
Trois mots pour dire ce qu’est la littérature, d’après vous ?
Un outil de compréhension enchanté, révolté et intime.
Et pour finir, que diriez-vous aux jeunes écrivains algériens en herbe qui aimeraient se faire repérer par une maison d’édition ?
De toujours entretenir leur sens de la curiosité et de la créativité ; ce n’est qu’en trouvant une voix à la fois singulière et multiple que nos mots peuvent réellement résonner dans les oreilles d’autrui.
The post L’auteur Aïmen Laïhem au JI: «Je voulais créer un rythme haletant, à l’image des taxis d’Alger» appeared first on Le Jeune Indépendant.