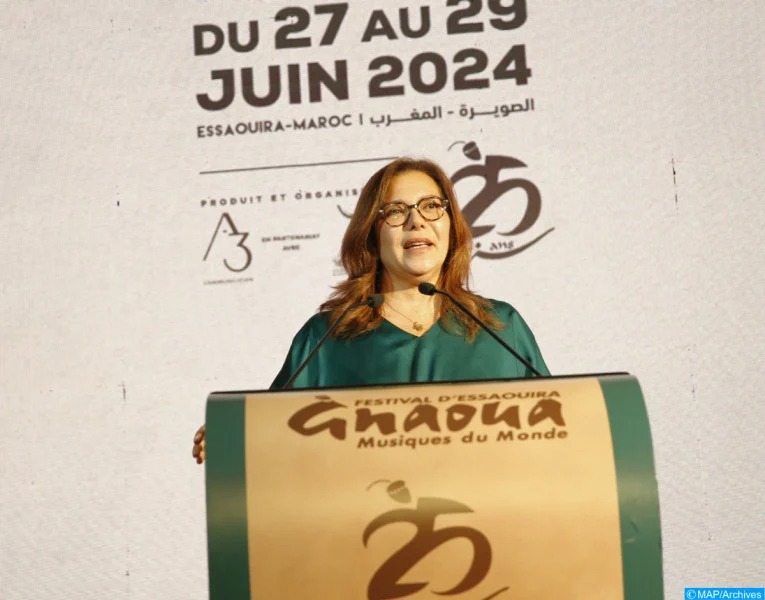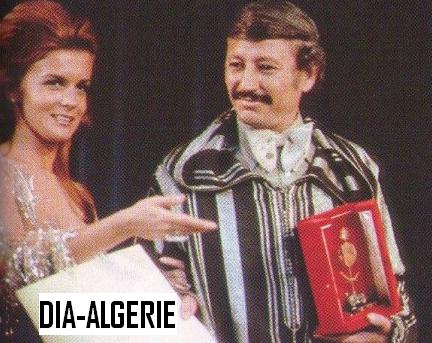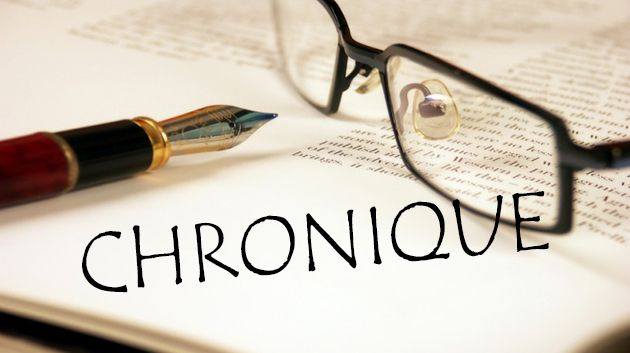Massacres du 8 mai 1945 : La face cachée du génocide
Le 8 mai 1945, l’Europe célèbre dans l’euphorie la victoire alliée sur l’Allemagne nazie. Une victoire qui avait mis fin à un conflit planétaire qui dura 6 ans (1939-1945), faisant plus de 60 millions de victimes dont, selon des sources historiques, quelque 60.000 Algériens, conscrits de force dans l’armée française. Le 7 mai 1945 au […] The post Massacres du 8 mai 1945 : La face cachée du génocide first appeared on L'Est Républicain.

Le 8 mai 1945, l’Europe célèbre dans l’euphorie la victoire alliée sur l’Allemagne nazie. Une victoire qui avait mis fin à un conflit planétaire qui dura 6 ans (1939-1945), faisant plus de 60 millions de victimes dont, selon des sources historiques, quelque 60.000 Algériens, conscrits de force dans l’armée française. Le 7 mai 1945 au soir dans l’Algérie occupée, à Sétif-ville, tandis que les colons organisent des bals, chantent et dansent, “les Amis du Manifeste Algérien” (AML), sourds aux flonflons, s’attèlent aux préparatifs d’un défilé pacifique qui devait déboucher, le lendemain, sur le Monuments-aux-Morts, sur le parvis de l’église Sainte-Monique (aujourd’hui mosquée Abdelhamid-Benbadis) où une gerbe de fleurs devait être déposée en hommage à tous les soldats tombés durant la seconde guerre mondiale. Ce fut, du moins, la raison invoquée par les militants nationalistes pour obtenir des autorités d’occupation l’autorisation d’organiser le défilé. La procession devait s’ébranler devant la mosquée de la gare (aujourd’hui Abu Dhar El Ghafari) avant de parcourir l’avenue Georges-Clémenceau (devenue avenue du 8-Mai 1945) pour ensuite bifurquer, face à l’ex-café de France, vers le Monument-aux-Morts pour y déposer une couronne fleurie. En réalité, les nationalistes algériens, sur l’instigation de Ferhat Abbas et des militants des AML, avaient, la veille, parcouru Sétif et ses environs pour appeler à une forte mobilisation et expliquer le véritable objectif de la marche : appeler à l’indépendance de l’Algérie. Le mardi 8 mai 1945 est jour de marché. “Il faisait beau et assez chaud”, s’était souvenu le regretté Moudjahid Mohamed-El Hadi Cherif, dit Djennadi, que l’APS avait approché il y a une dizaine d’années, à l’aube du 70ème anniversaire des massacres perpétrés au printemps 1945 à Sétif, mais aussi à Guelma, à Kherrata et leurs environs. M. Cherif, qui fut l’un des principaux encadreurs de la marche historique du 8 mai 1945, transformée en bain de sang par le colonisateur français, avait raconté que le 8 mai 1945, la foule était “de plus en plus dense dès 6 heures du matin”. Vers 7 heures, ils étaient déjà entre 9.000 et 10.000 personnes à se presser devant la mosquée Abou Dhar El Ghafari et dans les quartiers voisins (cimetière chrétien, Ain El M’zabi, rue du 3ème RTA, Place de la garde mobile), munis de banderoles et de drapeaux de l’Algérie confectionnés à la hâte, sans compter les centaines de personnes venues d’Amoucha, d’El Ouricia, de Guedjel, d’Ain Roua, de Bougaâ et d’autres villages environnants, et qui s’apprêtaient à rallier la marche pacifique depuis la “Porte de Biskra”, la cité des Remparts et les sorties Nord et Est de la ville de Sétif. Selon Mohamed-El Hadi Cherif, 250 louveteaux des Scouts musulmans algériens (SMA), en tenue, sont placés en tête du cortège, alignés en rangées de huit, foulard vert et blanc autour du cou. Avançant lentement et à pas cadencés, précédant une foule immense, ils entonnent “Min Djibalina” (De nos montagnes), que des centaines, puis des milliers de personnes, dès le début du défilé à 8 heures 30 précises, reprennent à l’unisson et, au cœur de la procession, le drapeau de l’Algérie est déployé pour la première fois.
Une détonation, un you-you, la débandade, puis le massacre
La vue du drapeau vert et blanc frappé d’un croissant et d’une étoile rouges suscite l’indignation des colons français, installés sur les terrasses des cafés, et la colère des policiers qui restent, cependant, calmes au début. Le défilé grossit à vue d’œil, surtout lorsque deux groupes de plusieurs centaines de manifestants le rejoignent depuis le sud de la ville (Porte de Biskra, boulevard du général Leclerc). Une fois arrivée devant le mess des officiers, au début de l’avenue Georges-Clémenceau (face au collège Eugène-Albertini qui allait devenir le lycée Mohamed-Kerouani), la foule est impressionnante. Aux “Vive la Victoire, à bas le nazisme” scandés par la foule, succèdent brusquement des “Vive l’Algérie indépendante”, “L’Algérie est à nous”, “Libérez Messali Hadj”, “Istiklal !”. Tous les témoignages recueillis par l’APS, confortés par des documents d’archives conservées au musée du Moudjahid, s’accordent à affirmer que devant l’ex-café de France, juste en face de la stèle commémorant ces événements, le commissaire Lucien Olivieri, ne supportant pas la vue de l’emblème national, ordonne de retirer pancartes, banderoles et drapeaux. Bouzid Saâl, un jeune militant anticolonialiste de 22 ans, refuse, le menton haut, de baisser le drapeau algérien, le policier tire et le jeune homme s’écroule (il succombera quelques minutes après son arrivée à l’hôpital). Mohamed-El Hadi qui se trouvait parmi les groupes de tête du cortège, avait affirmé, dans son témoignage, qu’un silence de quelques secondes, “lourd et pesant”, avait succédé à la détonation. Un silence, avait-il poursuivi, que “déchira” un you-you “strident” provenant du balcon d’un immeuble. La foule est aussitôt prise de panique. Les colons, jusque-là attablés en spectateurs, fuient dans tous les sens. C’est le début des émeutes… L’après-midi, la manifestation gagne la campagne sétifienne puis s’étend à d’autres villes, notamment à El Eulma, à Kherrata et à Guelma où une marche avait également été organisée. Le gouvernement provisoire du général De Gaulle répond par une répression impitoyable, sauvage, sanglante dont le général Duval sera le “maître d’œuvre”. La loi martiale est décrétée de Sétif jusqu’à la côte béjaouie. La circulation automobile est interdite et un couvre-feu est décrété. Les chefs nationalistes sont arrêtés, des jeunes scouts et des civils sont sommairement exécutés sur simple suspicion. Des douars soupçonnés d’abriter des indépendantistes sont pilonnés par l’aviation coloniale et incendiés. Des femmes, enfants et vieillards sont tués sans pitié. Ce génocide en règle qui dura des mois a fait 45.000 morts tombés en martyrs.
Un génocide qui a fait tomber le dernier masque du colonialisme français
L’Algérie célèbre, aujourd’hui, la Journée nationale de la Mémoire commémorant le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, qui ont fait tomber le dernier masque du colonialiste français après avoir commis un crime de droit international, un génocide prémédité dont la responsabilité pénale internationale incombe à ses auteurs. Ces massacres atroces ont fait tomber le dernier masque de la “mission civilisatrice du colonialisme” que la France voulait promouvoir, les rapports ayant révélé, à l’époque, que les actes de violence et de répression contre des dizaines de milliers d’Algériens, descendus dans les rues de Sétif, Guelma, Kherrata et d’autres villes, pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale et rappeler à la France ses promesses envers ceux qui avaient contribué à sa protection, avaient été déclenchés par l’expression de la revendication de l’indépendance et le ralliement autour de l’emblème national, qui a fait une apparition historique ce jour-là. Le premier manifestant tombé en martyr en étreignant le drapeau national, le jeune Saâl Bouzid, a mis à nu le visage brutal du colonialiste qui avait encerclé les Algériens dans une zone restreinte durant plusieurs semaines, en utilisant tous les moyens militaires (navires, avions, artillerie lourde et troupes spéciales), le but étant d’exterminer tout Algérien aspirant à la liberté et à la dignité. Quelques mois plus tard, le même procédé d’humiliation a été consacré dans la Constitution de la Quatrième République française qui considérait l’Algérien comme un “citoyen français de seconde zone”, ce que les différents gouvernements successifs de la Cinquième République n’avaient de cesse de rappeler à chaque fois que le drapeau algérien était hissé haut. C’est pourquoi la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d’instituer le 8 mai Journée nationale de la Mémoire revêt une symbolique et des significations d’une importance capitale. Il s’agit d’une occasion d’évoquer la mémoire des “martyrs de la dignité et de la liberté”, comme il les avait décrits lors d’une précédente occasion, et d’une opportunité pour “s’enorgueillir des chapitres d’un parcours national riche en luttes, de génération en génération”. La noblesse du message transmis à travers les générations et l’immensité des sacrifices consentis pour recouvrer la terre et la liberté, ont fait de la Mémoire nationale “un dossier imprescriptible qui ne tombe pas dans l’oubli et ne tolère ni concession ni compromis”, comme l’a réaffirmé le président de la République qui s’est engagé à traiter ce dossier, placé “au centre des préoccupations de l’Etat”, de manière “objective, audacieuse et équitable envers la vérité historique”, une vérité que les autorités françaises tentent de taire, voire de falsifier, à ce jour tant le bilan de leur histoire coloniale est accablant. Le bilan de la répression subie par les Algériens dans le Nord-Constintinois il y a 80 ans, est lourd et macabre: plus de 45.000 morts, des tribus et des villages entiers anéantis, des scènes de destruction horribles ayant provoqué l’indignation de plusieurs pays dans le monde, selon un rapport du consul général britannique de l’époque, John Eric Maclean, soumis aux autorités de son pays pour les alerter sur l’horreur des génocides commis contre des citoyens désarmés. Il s’agit d’un crime d’Etat, d’une guerre génocidaire, un acte criminalisé par le Droit international. Le blackout exercé par les autorités françaises à l’égard de ces massacres est en lui-même un crime, car de l’avis de certains historiens, le nombre réel de martyrs dépasserait de loin celui déclaré, dont la vérification n’était pas chose aisée au lendemain de l’indépendance d’autant que l’Etat français a détourné les archives algériennes, y compris les registres de l’Etat civil de l’année 1948. Pis encore, il a recouru à la promulgation de lois protégeant les auteurs de crimes coloniaux et interdisant la consultation des documents d’archives. Ce qui est certain, c’est que 80 ans après ces massacres, le drapeau pour lequel le chahid Saâl a sacrifié sa vie, continue de flotter très haut, portant les luttes du peuple algérien et restera le symbole de la Révolution du 1e novembre 1954. Il est conservé aujourd’hui dans le Musée du Moudjahid dans la wilaya de Sétif, témoin de la fidélité de générations successives au serment des chouhada.
Chronologie d’un pogrom planifié…
Afin de garder l’Algérie dans le giron français, les pouvoirs publics de l’époque ont pris de terribles mesures. En quittant Alger le 14 août 1944, le général de Gaulle demeure fermement attaché au principe d’« Algérie, ensemble de départements français ». Il ne conçoit pas le règlement de l’épineuse question algérienne en dehors du discours prononcé à Constantine le 12 décembre 1943 et des dispositions de l’ordonnance du 7 mars 1944. Contestée par les grands colons, cette ordonnance est promulguée par le président du Comité Français de Libération Nationale (CFLN) afin de contrer le groupement des Amis du Manifeste et de la Liberté (AML), fondé le 14 mars 1944 à Sétif par Ferhat Abbas. Les dispositions assimilationnistes de l’ordonnance suscitent une opposition unanime des Français d’Algérie. Son article 3, qui fait de plus de 65.285 indigènes des citoyens désormais inscrits sur les mêmes listes électorales que les citoyens non musulmans, en est l’illustration. La montée du mouvement national, représenté par les Amis du Manifeste et de la Liberté, composés de l’association des oulémas, des partisans de Ferhat Abbas et de militants du Parti du Peuple Algérien (PPA), inquiète les autorités coloniales. L’adhésion massive au mouvement, avec plus de 500.000 militants et sympathisants en quelques semaines, est perçue comme une menace par les colons les plus nantis, soucieux de défendre leurs privilèges. L’Écho d’Alger, organe qui défend les intérêts de la grande colonisation, en appelle alors au recours à la force pour assurer le « maintien de l’ordre ». Avant de prendre l’avion, le chef de la Résistance, Charles de Gaulle donc, met en garde le général Henry Martin, commandant du 19ᵉ corps d’armée chargé de la coordination des forces terrestres en Afrique du Nord : « Évitez que l’Afrique du Nord ne glisse entre nos doigts pendant que nous libérons la France. » Pour de Gaulle, la souveraineté française sur l’Algérie ne doit pas être remise en cause. L’instruction du président du Gouvernement provisoire de la République française est appliquée avec rigueur. Bien que le rétablissement de l’ordre ne soit pas son rôle premier, l’armée intervient sans hésitation pour maintenir la domination de la France sur l’Algérie. Une note de service « très secrète », en date du 18 janvier 1945 et signée de la main du général Henri Martin, définit les grandes lignes d’un plan de défense en cas de troubles à l’ordre public ou de mouvements séditieux. Cette note est suivie d’un exercice stratégique sur carte, réalisé les 12 et 13 février 1945 en présence des représentants des états-majors de Rabat, de Tunis et d’Alger. De là, l’organisation de manœuvres sur le terrain : d’abord à Chenoua (Cherchell), puis à Biskra les 24 et 25 avril, et enfin en Kabylie les 4 et 5 mai 1945, où certaines exactions sont signalées. Le 1er mai 1945, sous l’impulsion du PPA et sous couvert de l’AML, une grande manifestation est organisée à Alger et sur l’ensemble du territoire national. La direction du PPA, dissoute en septembre 1939, saisit l’occasion pour démontrer sa capacité de mobilisation et son influence auprès de la population indigène. Cette démonstration vire au drame. À Alger, la manifestation est réprimée dans le sang : quatre hommes – Ghazali El Haffaf, Ahmed Boughlamallah, Abdelkader Ziar et Abdelkader Kadi – tombent sous les balles de la police. De nombreux blessés sont signalés à Oran et Blida. En revanche, aucune violence n’est rapportée lors des marches de Sétif et Guelma. L’effusion de sang du 1er mai n’offusque ni Yves Chataigneau, gouverneur général, ni l’état-major de l’armée coloniale. Couvrant tout le territoire, la montée du nationalisme fait peur aux colons les plus nantis, qui voient leurs privilèges menacés. Le 24 avril 1945, six conseillers réunis à Constantine, dont Eugène Vallet (auteur de « Drame algérien : la vérité sur les émeutes de mai 1945 »), suivent cette même voie. Dans une longue lettre, ils interpellent le préfet de Constantine, Lestrade Carbonnel, pour prendre les « mesures » nécessaires. Au final, les autorités civiles et militaires de la colonie n’ont pas choisi fortuitement Sétif pour « crever l’abcès ». Le 8 mai 1945, la planète entière est en liesse. La joie du monde libre est indescriptible, en raison de la capitulation de l’armée nazie. La fin d’un cauchemar qui a duré plus de cinq longues années se propage comme une traînée de poudre. En ce jour de libération, l’Algérie, qui a payé un lourd tribut lors des deux guerres mondiales, avec 29.300 et 7.500 mobilisés morts pour la France, célèbre cependant un deuil. Portés par l’euphorie de la victoire, des milliers d’Algériens défilent à Sétif, réclamant à leur tour plus de droits et la reconnaissance de leur identité. Ils exigent l’égalité des droits, tout comme il y a eu égalité des devoirs pendant la guerre. Mais cette marche pacifique est réprimée dans le sang. Alors que le monde entier fête la victoire sur le totalitarisme, l’ordre colonial tue ces revendications dans l’œuf. L’apparition du drapeau algérien aux côtés de ceux des Alliés met le feu aux poudres et l’intervention de la police déclenche alors une émeute. En fuyant sous les tirs des policiers, des Algériens se retournent contre les Européens croisés en chemin. Le crépitement des armes précipite une rupture profonde entre les Algériens, appelés « indigènes », et une partie des colons. Longtemps associé uniquement à Sétif, Guelma et Kherrata, ce drame a endeuillé tout le Nord-Constantinois et une grande partie du territoire, où chaque empan est chargé d’histoire. Pendant des semaines, l’armée française et les colons, regroupés en milices, ont humilié et tué sans distinction d’âge ni de sexe dans plusieurs localités : Ain El Kebira, Beni Bezez, Serdj El Ghoul, Aokas, Amoucha, Melbou, Beni Fouda, Tizi n’Bechar, Oued El Berd, Aïn Abassa, Bouhira, Maouane, El Kharba, El Eulma, Bordj Bou Arréridj, Beni Aziz, Boudriaa Beni Yadjis, Aïn Roua, El Ouricia, Ziama Mansouriah, Aïn Sebt, Bougaa, Aït Tizi, Bouandas et bien d’autres encore. La colère et la vindicte des populations indigènes, particulièrement dans les zones reculées de Sétif et de Guelma, ont fait 103 victimes européennes (70 à Sétif et 34 à Guelma, selon Annie Rey-Goldzeiguer). Cette révolte, qui emporta également de nombreux innocents, fut réprimée dans un bain de sang par une répression d’une ampleur inouïe, dépassant toutes les limites de l’entendement. Si le nombre de victimes européennes est précisément établi, le bilan des opérations de « rétablissement de l’ordre » – ayant mobilisé un véritable arsenal de guerre – reste encore méconnu et sujet à une polémique persistante. Aujourd’hui, près de 80 ans après les violences inouïes de mai 1945, amnésie et déni persistent du côté de la rive nord de la méditerranée, alors que des conseils municipaux de plusieurs villes françaises, des associations d’anciens appelés du contingent, des collectifs citoyens, des élus et des intellectuels se mobilisent pour rétablir la vérité. J’ai poursuivi mon enquête – cherchant à mettre en lumière l’imposture de la notion de « rétablissement de l’ordre public », devant dissuader les Algériens de revendiquer un minimum de dignité. Le mystère qui entoure le pogrom perpétré à huis clos reste épais. À midi, les forces de l’ordre, par le fer et le feu, reprennent le contrôle de la situation et rétablissent l’ordre à Sétif. Aucune maison n’est incendiée, aucune porte n’est défoncée. Les renseignements généraux, à la fois juges et parties, font état de 21 morts et 35 blessés du côté européen, avec une liste nominative des victimes et des causes de leur décès. En revanche, les « manifestants », frappés par la répression, restent dans l’ombre, leur sort étant couvert par la censure. Une chape de plomb s’abat sur les indigènes blessés ou tués. L’occultation délibérée du nombre de victimes indigènes, tombées ce jour-là ainsi que dans les jours et les semaines qui suivirent, est soigneusement entretenue, provoquant une polémique qui persiste jusqu’à nos jours. Cette controverse porte sur le bilan des victimes d’une répression féroce et disproportionnée. Le supplice des Algériens, dont le seul crime fut de scander des slogans de paix et de liberté, ne s’arrête pas là. L’état de siège, en vigueur sur tout le territoire français jusqu’au 12 décembre 1945, a fait peser le silence sur les tortures, exécutions sommaires, assassinats, disparitions, internements en résidence surveillée, interdictions de séjour, crimes de la milice et les biais de la justice coloniale. Ce régime a passé sous silence l’appel de Lestrade Carbonnel, préfet de Constantine, qui, le 10 mai 1945, incitait les colons à rejoindre la milice. Il a également dissimulé la hâte du préfet à transférer discrètement les pouvoirs de la police à l’autorité militaire, le 8 mai 1945 à 15 h 20. Les tonnes de bombes larguées par les bombardiers B26 et les chasseurs-bombardiers A24, effaçant des centaines de douars et de mechtas de la carte, sont également restées dans l’ombre. Protégés par l’état de siège, qui accordait une impunité totale aux abus, les architectes de cette tragédie ne manquaient pas d’« idées » : ils sont même allés jusqu’à solliciter des bombes antipersonnel, auprès des Américains et des Anglais. Véritable pièce à conviction, le rapport du consul général britannique à Alger, John Eric Maclean Carvell, expose cette préméditation : « Les Français ont géré cette révolte de façon impitoyable… » Dans une note adressée au Foreign Office, le 12 juin 1945, le diplomate lance une mise en garde prophétique : « La destruction impitoyable de villages et le massacre sans discernement de femmes et d’enfants ne seront jamais oubliés. Le mouvement passera forcément dans la clandestinité pendant un certain temps, mais resurgira ensuite sous une autre forme. »
La face cachée du génocide
Port de pêche de premier ordre et escale de prédilection des chalutiers à la poursuite des crevettes, Jijel, destination de choix des estivants à la recherche d’un point bleu et de paysages naturels d’une beauté sublime, est réputée comme l’un des points névralgiques du nationalisme. « Le 8 mai, l’autorité organise une cérémonie officielle. Le cortège doit se rendre de la mairie au monument aux morts en empruntant l’avenue Vivonne (actuelle avenue Émir Abdelkader, NDLR), soit un parcours d’environ 500 mètres, accompagnés par les enfants des écoles et toute la population. » Un cortège d’environ 2.000 musulmans se dirige séparément vers le monument aux morts par la rue Gadaigne (actuelle avenue du 1er Novembre), avec des banderoles portant les inscriptions « Libérez Messali » et « Vive l’indépendance ». En tête, les SMA entonnent l’hymne « Min Jibalina ». « Arrivé au monument aux morts, le drapeau national, conçu par Mme veuve Garmia Moussaoui, est brandi. » L’apparition des pancartes et de l’emblème « provocateur » n’est pas du goût du commissaire Rouquet, chef de la police d’État et responsable du service d’ordre composé de policiers et de deux détachements de tirailleurs sénégalais. Rouquet intime l’ordre de lui remettre les banderoles « séditieuses », mais les manifestants refusent. Le commissaire réitère sa demande, en s’adressant personnellement à Benkhalef, conseiller général indigène, qui lui répond : « Ils refusent. » « Je vais employer la force », prévient le commissaire. « Employez-la ! » rétorque Benkhalef, qui sera par la suite emprisonné. Aidé par les soldats sénégalais prêts à dégainer, Rouquet met à exécution ses menaces, obligeant ainsi la foule à se disperser dans un désordre indescriptible. Malgré l’anarchie et le sauve-qui-peut, la manifestation n’a cependant pas été émaillée d’incidents graves, le 8 mai, on ne déplore aucune victime à Jijel. Le 10 mai, les Européens de la ville sont armés de fusils et munis de cartouches. Le 11, une milice entre en fonction et monte la garde avec les Sénégalais. La mort tragique de cinq Européens tués dans différents endroits de la région envenime la situation et donne le quitus à une répression effroyable. Prévenus du danger, Mme et M. Piras, gérants du petit hôtel Les Falaises, refusent d’y croire et restent chez eux. Dans la nuit du 10 au 11 mai, un groupe armé les attaque. M. Piras est atteint de plusieurs coups de feu et meurt. Sa femme, blessée, réussit à se cacher. Elle est secourue le lendemain. Rapide et brutale, la riposte de l’armée ensanglante la paisible presqu’île de Ziama Mansouriah, bel espace de villégiature où douze indigènes − Ajad Slimane, Brahimi Essaïd, Bousbaa Mohamed, Bouzroua Amar, Chouib Amar, Hamimeche Smail, Hanniche Ahmed, Louari Laïd, Adjad Saïd, Lourari Mustapha, Kaced Khelifa et Berahia Smail − sont liquidés sur-le-champ. L’effroyable ignition consume Melbou, à 13 km à l’ouest de Ziama et la petite station balnéaire se retrouve contrainte de compter ses morts. Les causes exactes de l’élimination de Hihi Amine, Maroua Aïssa, Mrabti Ali, Mrabti Essaïd, Maouche Dris, Sadou Mohand, Dadj Mohand, Boulanouar Mohand, Hebbache Hocine, Ouzen Ahmed, Ourfi Abdallah, Bouchiben Hocine, Medjdoub Akli, Aroune Smail, Maazouz Mohand, Messaoui Mohand, Amir Aïssa et Mouloud Mohand ne seront jamais connues. La folie embrase la région. Ainsi, la maison forestière de Beni-Siar (commune mixte de Taher) est incendiée. Absents, les deux gardes et leur famille sont sains et saufs. Les présumés incendiaires seront condamnés à de lourdes peines de prison. Responsable de pillages et de représailles démesurées, le bataillon de Sidi Bel Abbès, aidé par des colons, n’a été ni inquiété ni poursuivi pour sévices et bavures. L’attaque qui a coûté la vie aux gardes forestiers Dupont et Devez de Aïn Settah, au prisonnier italien Magri Giuseppe et à Mme Devez ne restera pas impunie. Situés à 10 km de Beni Aziz (Chevreul) et à quelques encablures de nombreuses localités du sud de Jijel, le hameau d’Aïn Settah, Beni Medjelad, El Guebala, Ouled El Hadj, Tamentout, Ouled Messaoud, Djimla, Dar Benallou et d’autres baigneront dans le sang. Enclavée et difficile d’accès, la petite bourgade de Laachèche (Boudria Beni Yadjis), nichée au pied d’une zone montagneuse et boisée, vivra des moments d’horreur. Éludée parce qu’elle a été perpétrée à huis clos, la descente punitive fait sur-le-champ plus de 25 morts.
Boudria Beni Yadjis, la tragédie méconnue
La tempête qui a frappé Beni Yadjis ne figure dans aucun document ni ouvrage. Des rescapés, qui n’ont jamais été sollicités, vont pour la première fois parler et dévoiler une infime partie de la tragédie. Installée à deux kilomètres, au lieu-dit Gouf Dar Bougana, la stèle portant fièrement les noms des disparus fait office de témoin. Intrigué par la présence de personnes étrangères à la localité, Saber Saadi, un octogénaire préférant passer une partie de sa journée en ces lieux, n’en croit pas ses oreilles : « Vous venez de Sétif spécialement pour connaître la vérité sur ce qui s’est passé à Boudria en mai 1945 ? Vous avez fait plus de 120 km et parcouru des chemins difficiles, sinueux et vallonnés pour connaître le martyre de vos proches, non ? Vous avez de la famille dans le village ? » Notre réplique interloque le vieillard, un des derniers survivants des événements : « Nous n’avons aucune attache familiale dans la région. Nous ne sommes pas non plus des descendants de victimes de la tragédie d’ici ou d’ailleurs. Nous sillonnons les zones oubliées et difficiles d’accès à la recherche de la vérité historique. C’est notre seule motivation ! » Convaincu, Cheikh Saadi, pour lequel les heures terribles sont à jamais gravées dans sa mémoire, nous confie les principales causes de la tragédie : « La mort des gardes forestiers de Tamentout, tués du côté d’Ouled Beni Medjaled, un hameau de Beni Aziz (ex-Chevreul, NDLR), a allumé la mèche et mis les soldats de la Légion étrangère dans une colère bleue. Aidés par des colons armés, à leur tête le fermier Lochard, qui avait survécu à l’attaque de sa ferme, les légionnaires déchaînés n’ont pas hésité à descendre de sang-froid de nombreux innocents. En commettant de tels homicides, ils sont devenus criminels. Perpétré dans une région boisée, enclavée et difficile d’accès, l’abominable carnage est méconnu. Il est absent des manuels scolaires de nos enfants, qui ne connaissent rien de ces jours sombres… » Il ne nous laisse pas partir sans nous révéler les noms d’autres témoins, dont Ali Rezig : « En mai 1945, les gens de Boudria Beni Yadjis n’ont participé à aucune manifestation. Ils n’ont pourtant pas échappé au massacre. Éprouvées par l’esclavagisme des colons, des familles entières ont été exterminées. Les sanguinaires ont bien profité de la situation pour boucler la tuerie par la razzia. N’ayant rien à voir avec la mort des gardiens forestiers, les familles Zaghlit, Saber, Yadoui et Boulaadjoul ont payé le prix fort. Le traumatisme des indigènes du coin a été volontairement dissimulé par l’ordre colonial. » Cheikh Saadi n’aurait jamais pensé que le cyclone ayant ravagé son bled puisse être rendu public un jour ! Poignant, le récit de Zaghlit Abderrahmane (86 ans) donne froid dans le dos. Fils de Zaghlit Ahmed, l’une des 45 victimes enregistrées à l’état civil, Abderrahmane, qui avait à l’époque 11 ans, n’a rien oublié, 80 ans plus tard. Il évoque le malheur des siens, cite sans la moindre difficulté les noms des oncles et cousins fauchés par les « mesures énergiques » : « Après les incidents d’Aïn Settah, Djimla, Tamentout, où ont été tués des Européens, Boudria a fait les frais de la folie meurtrière de l’armée qui a traqué, tué et rasé des tribus entières. Aucune famille n’a échappé à la chasse. La plus touchée est la famille Zaghlit. Mon père ainsi que Zaghlit Ferhat, Zaghlit Naamoune, Zaghlit Achour Amar, Zaghlit Salah, Zaghlit Mohamed Rabah, Zaghlit Rabah, Zaghlit Nour, Zaghlit Hamlaoui Salah, Zaghlit Mokhtar, Zaghlit Saïd, Zaghlit Sebti, Zaghlit Amar, Zaghlit Tahar, Zaghlit Mohamed n’auront droit à aucun procès. Mon oncle Zaghlit Lakhdar et sa belle-fille Triak Gamra, ainsi que ma tante Zaghlit El Ouahma, n’ont pas échappé à la sauvagerie de leurs bourreaux. Il en est de même pour Saber Mouloud Ben Chaouch, son fils Mouloud et sa femme. Laissez-moi vous dire que le nom de Triak Gamra et Zghilat Siad n’est pas enregistré. Depuis plus de 76 ans, et jusqu’au dernier souffle de ma vie, je resterai un orphelin. On m’a injustement privé de l’amour d’un père éliminé dans la fleur de l’âge. Les tueurs ainsi que l’administration coloniale ne se sont jamais inquiétés du sort réservé aux orphelins indigènes, blessés à vie. Des dizaines de veuves éplorées ont été obligées de résister aux vicissitudes d’une existence intenable et de l’impitoyable joug du colonialisme. Il n’est pas possible d’effacer de mon esprit les sacrifices de ma mère et des autres veuves du village. Les familles des victimes n’ont bénéficié d’aucune indemnité ou réparation. On n’a pas eu droit au ″capital décès″, car mon père était considéré comme un sujet, une chose… » « Mais le temps n’exonère pas les criminels. Je n’ai jamais pensé qu’on ressusciterait un jour nos cicatrices », précise le vieillard, retenant difficilement ses larmes. « Avant de commettre l’irréparable, l’armée coloniale rassemble les habitants. Apeurée, la population est accusée de soulèvement, d’attroupement et de meurtres. Pour marquer les esprits, les légionnaires, ne reculant devant rien, incendient nos taudis, confisquent nos maigres biens et troupeaux. L’expédition punitive se termine par un véritable bain de sang. Les pleurs des enfants, des femmes, les implorations des personnes âgées n’ont pas infléchi nos bourreaux », précise cheikh Abderrahmane, pour qui la liste des fusillés n’est pas exhaustive. Celle-ci lève le voile sur un fait occulté par l’historiographie des vainqueurs, lesquels trouvent dans la « légitime défense » et le « rétablissement de l’ordre public » des alibis qui ne tiennent plus la route. Gardé secret pendant des décennies, le martyre de Boudria Beni Yadjis montre clairement que l’ouragan de mai 1945 n’a pas encore révélé tous ses secrets. L’examen de la liste que nous reproduisons éclaire sur l’étendue des exécutions sommaires. Il révèle les intentions des auteurs, qui n’ont ciblé que des jeunes. La plus âgée des victimes avait 57 ans. Transmise à travers le temps, cette liste n’est pas descendue du ciel. Révélation inédite, l’information que nous livrons est tout sauf une légende ou un récit mille fois raconté. Elle pointe du doigt les excès et les outrances de l’armée coloniale, qui a écumé les montagnes et les forêts de Jijel, Mila, Béjaïa et Sétif, où les traces des sévices demeurent indélébiles. Érigée à Gouf Dar Bougana, la stèle en témoigne : Zaghlit Ferhat, né le 4 octobre 1891 ; Zaghlit Naamoune, né le 10 mars 1897 ; Zaghlit Achour-Amar, né le 2 août 1896 ; Zaghlit Amar-Ahmed, né le 6 novembre 1919 ; Zaghlit Salah-Mohamed Ben Rabah, né le 10 décembre 1927 ; Zaghlit Lakhdar-Ali, né le 16 novembre 1918 ; Zaghlit Ahmed-Lakhdar Mohamed-Ali, né présumé en 1909 ; Zaghlit Mohamed-Rabah, né le 19 janvier 1897 ; Zaghlit Salah-Rabah Ben Achour, né présumé en 1904 ; Zaghlit Nacer-Ramdane, né le 22 janvier 1898 ; Zaghlit Hamlaoui-Salah, né le 17 décembre 1896 ; Zaghlit Mokhtar-Nacer, né le 27 août 1893 ; Zaghlit Saïd-Ali, né le 8 mars 1895 ; Zaghlit Sebti-Ferhat, né le 28 avril 1907 ; Zaghlit Amar-Tahar, né le 6 juillet 1903 ; Zaghlit Tahar, né le 2 mai 1899 ; Zaghlit Mohamed, né le 2 août 1891 ; Zaghlit El-Ouahma, née présumée en 1891 ; Saber Ahmed-Mohamed, né le 15 décembre 1893 ; Saber Mouloud-Ahmed, né le 5 décembre 1891 ; Saber Saïd, né le 20 août 1904 ; Douir Belkacem, né le 6 septembre 1904 ; Douir Ahmed-Amar, né le 15 août 1917 ; Douir Mohamed-Tahar, né le 6 juin 1891 ; Boulaâdjoul Mohamed-Mebarek, né le 19 juillet 1897 ; et Boucheham Ali-El-Hadj, né présumé en 1888. Exécutés sur la voie publique, les Zaghlit, Saber, Douir n’ont-ils pas été victimes d’une purge raciale ? En procédant de la sorte, des bourreaux n’ayant pas pris la peine de faire la lumière sur les faits ni d’enquêter ont opté pour la solution de facilité : la « corvée de bois », afin d’éviter de s’encombrer de prisonniers et de procédures judiciaires. Couverte par une chape de plomb, la barbarie qui a frappé Laachèche, hameau situé à environ 2 km de Beni Yadjis (qui, des années après l’indépendance, a pris le nom de Boudria Ben Yadjis), est exhumée. Le châtiment infligé à la population résume ce que le pays profond a subi et enduré pendant des semaines. Fructueux à plus d’un titre, le déplacement à Boudria Beni Yadjis m’a permis de lever le voile sur des stigmates cachés, de faire la lumière sur une portion de la plaie des sans voix, de rencontrer des gens fabuleux, de découvrir aussi et surtout la beauté d’une région unique. Aïn Kebira (ex-Périgotville), chef-lieu communal situé à 27 km au nord-est de Sétif, a connu des moments pénibles et douloureux. Le malheur a dévasté les deux communautés, qui ont mis du temps à faire leur deuil. Un fait marquant montre comment des hommes peuvent s’élever au-dessus de la mêlée pour venir au secours de l’autre. Traqués par les légionnaires ayant incendié leurs taudis, les indigènes d’Ouled Adouane, Ouled Layadi, Ezkarma, Ouled Ali, Ouled Toumi, Ouled Souici, Lamnassra et Enouaoura ont été sauvés grâce à la sagesse du fermier Vianet. Celui-ci a évité un drame de justesse et fait preuve d’un sang-froid exceptionnel. En voyant arriver un important contingent militaire, le colon qui entretenait d’excellents rapports avec ses voisins indigènes demande à un détenu italien de brandir le drapeau français. Le déploiement de la bannière tricolore rassure les légionnaires et les oblige à rebrousser chemin. La meute a mordu à l’hameçon tendu par Vianet, qui a ainsi sauvé de nombreuses familles musulmanes d’une mort certaine. À cet instant, la scène est à couper le souffle. Reconnaissant, Nouar Belkhiri d’Ouled Adouane a tenu à mettre en lumière l’extraordinaire geste du fermier.
Le martyr d’El Eulma, l’autre bastion rebelle…
En dépit de sa proximité avec l’épicentre du volcan, El Eulma (ex-Saint-Arnaud) n’a pas connu de troubles le 8 mai. Située à 27 km à l’est de Sétif, la ville adoptive du docteur Mohamed Lamine Debaghine a célébré la fin de la guerre sans le moindre incident. Répondant à l’appel du PPA, plus de 2.000 indigènes ont marché dans le calme et la discipline. Après avoir sillonné les principales artères de la cité, les manifestants sont arrivés devant le monument aux morts, où ils ont déposé des gerbes de fleurs. À l’issue de la cérémonie de recueillement, Bachir Guessab (martyr de la guerre de libération) a pris la parole pour saluer la fin de la guerre et affirmer avec force le droit du peuple algérien à l’indépendance. Il a ensuite félicité les marcheurs et les a invités à se disperser dans le calme. Comme à Bordj Bou Arreridj, où le maire Gaston Lleu n’a pas voulu attiser les tensions, le premier magistrat d’El Eulma, Filippi, a laissé faire. Contrairement à certaines assertions, la ville où aucun colon n’a été violenté ou agressé le 8 mai et les jours suivants n’a pas échappé à la persécution, aux rafales, et à la loi de la milice. Le vendredi 11 mai, cent hommes reçoivent des armes. Le jour même, la chasse à l’Arabe commence. « Le vendredi 11 mai 1945 est une date ancrée dans ma mémoire. Comme à l’accoutumée, mon père (Maane Ahmed) sort de la maison vers 11 h 30. Il ne savait pas qu’il allait manquer la prière du vendredi, qu’il effectuait habituellement dans une mosquée d’El Eulma. Il n’avait jamais imaginé qu’il y serait la cible ou la proie d’un voisin colon. Plus de 77 ans après, je n’arrive toujours pas à effacer de ma mémoire un tel cauchemar. Je ne peux oublier la fin tragique de mon père, un petit fellah victime d’un traquenard. La douleur est restée intacte. Serein, il quitte la maison de Smara (un bourg situé à 4 km à l’ouest d’El Eulma, NDLR) sans la moindre appréhension, puisqu’il n’avait pas pris part à la manifestation du 8 mai. Quelques instants après, notre vie bascule. Le fils du colon Ernst lui tire dessus. Il l’abat de sang-froid. La détonation transperce les murs de notre demeure, fracasse notre existence. L’instinct me pousse vers l’extérieur, où je trouve mon père gisant dans une mare de sang, à une centaine de mètres de la maison. En arrivant sur le lieu du crime, je découvre l’horreur. L’image de mon papa agonisant me hante encore. Inerte, le corps est ramené à la maison, où il succombera trois jours plus tard. Le sort d’une veuve et de trois orphelins en bas âge n’a ému ni l’autorité ni la justice, qui n’ont pas jugé utile d’ouvrir une enquête ni d’interpeller l’assassin. Ce dernier n’a jamais été inquiété. Sentant le danger venir, il a quitté la région et s’est installé en France quelque temps après. Le meurtrier a profité de la situation pour régler à sa manière un problème d’assiette foncière. Avant et après les massacres de mai, rien n’était interdit aux colons. Je ne pardonnerai jamais. L’assassin m’a privé de mon adolescence et de l’amour d’un père. Il a, ce jour-là, détruit une famille. Le temps ne peut panser nos blessures ni ressusciter mon père, froidement liquidé », nous confie Ali Maane, qui avait alors 13 ans. Sous des airs d’homme blindé, ses yeux et ses mains le trahissent, révélant à quel point la blessure est profonde. Pour lui, la plaie de mai 1945 a accéléré la gangrène de l’Algérie française : « L’assassinat de mon père a été un déclic. L’horreur m’a ouvert les yeux et m’a permis de comprendre la véritable nature de la colonisation. Pour panser mes blessures, me venger, me faire justice, je n’ai pas hésité un seul instant à répondre à l’appel de la patrie violée, à rejoindre les rangs de l’ALN, à activer au sein des cellules de fidaïyine de la ville, aux côtés de Bachir Guessab, Saroub Khatir et Abderrahmane Sellami, tombés au champ d’honneur. Avant d’écoper des travaux forcés à perpétuité, j’ai été arrêté une première fois et condamné à trois mois de prison en compagnie de Brahim Zoughar et des frères Dardar Saïd, Salah et Rabie, eux aussi tombés au champ d’honneur. Le 15 novembre 1956, nous devions, Safsaf Ali et moi, abattre le garde champêtre de Bazer Sakhra (localité située à quelques encablures d’El Eulma, NDLR). Notre cible échappe miraculeusement à l’attentat. L’enrayement de l’arme lui a sauvé la vie. Après une courte cavale, nous sommes arrêtés et torturés dans les geôles de la gendarmerie, puis dans les sinistres locaux des docks, où nous avons subi les pires sévices. Nous avons tenu bon, puisque nos tortionnaires n’ont pu nous arracher le moindre aveu. Taxés de hors-la-loi, le tribunal militaire de Constantine nous condamne, en mars 1957, aux travaux forcés à perpétuité. Les juges, tous militaires, n’ont pas voulu voir nos ecchymoses, entendre nos plaintes, ni enquêter sur les tortures subies. Dans son édition du mardi 12 mars 1957, la Dépêche de Constantine (il nous remet une copie du journal), qui a passé sous silence l’assassinat de mon père, consacre un large espace en une à notre procès : “Travaux forcés à perpétuité pour deux hors-la-loi”. Les auxiliaires de la justice coloniale n’ont pas oublié de publier ma photo. La copie du journal que je garde jalousement me rappelle des souvenirs douloureux que je ne pourrai pas oublier aussi facilement », ajoute Ali, terrassé par une forte émotion. Avant sa dissolution, le 20 mai, la milice de Saint-Arnaud ne se limitant pas à des patrouilles dans les rues, tue 11 nomades et Maiza Mohamed, jeune berger de 15 ans. Raflé à l’instar de ses coreligionnaires, Zaaboub Khelifa ne résiste pas à la torture des bourreaux de la caserne de Sétif. N’ayant commis aucun geste irréfléchi, des centaines d’indigènes de la ville et des localités environnantes ont subi les pires sévices.
Cicatrices impérissables d’Amoucha…
Important centre rural, Amoucha occupe une position stratégique sur la RN9 reliant Sétif à Béjaïa. Situé entre Kherrata et El Ouricia, le bourg fait partie de la commune mixte de Takitount et Périgotville (actuelle Aïn El Kebira) et n’a pas connu de drame le 8 mai 1945. Hormis l’attaque du bureau de poste et de la maison d’un colon, la population européenne du village n’enregistre aucune perte humaine ce jour-là. L’arrivée d’un half-track du 9e escadron de la garde desserre l’étau sur le receveur de la poste et d’autres Européens barricadés chez eux. Le lendemain, les militaires reviennent à la charge, procèdent à l’évacuation des Européens, conduits à Sétif, où ils retrouvent des parents partis la veille à la première heure. Situé à 25 kilomètres de Sétif, le bourg paiera un lourd tribut et le passage de la Légion étrangère continue de hanter les esprits. Si Laïd Saïd, Magrem Embarek, Kharbèche Layadi, Moghreb Bouzid et Mehabil Slimane sont condamnés à mort le 8 octobre par le tribunal militaire de Constantine pour pillage, les frères Akkouche Ahmed et Kaci, Kharfallah Fatima, Abdelkader Benallègue, son frère Rabie, Saouala Amar, Khantout Abdallah, Sayah Saïd, Mefoued Ahmed, Chetibi Abdallah, Gherib Saïd, Khalfa El Hachemi, Amar Kerouani, Kabbour Embarek, Abacha Saïd, Bouyoucef Embarek, Youcef Kerouani, Laouacher Saïd, Kerouani Khoutir, Belkacem Kerouani et son frère Lakhdar, Issouan Ali, Bouamama Amar sont fusillés dans différents coins de la localité, où ils ont été l’objet de liquidations extrajudiciaires. Le malheur des « sujets » n’ayant tué personne ne figure pas dans le rapport du commissaire Raybaud, chef de la police mobile du département de Constantine, transmis au directeur de la sécurité générale de l’Algérie le 7 juillet 1945, qui met l’accent sur les émeutes de Périgotville, théâtre d’atrocités gravissimes. On n’a pas non plus mentionné le supplice des habitants de Serfada, Ouled Fayet et Ouled Djaber, où les pilonneurs ont soufflé respectivement 8, 30 et 10 taudis. Partie le 8 mai de Sidi Bel Abbès, la Légion étrangère arrive à Sétif le lendemain au petit matin. Sans tarder, elle prend les choses en main : « L’aspirant qui commandait à l’époque un escadron précise : “Sur le plan opérationnel, nous formions un groupement d’intervention n° 2 (dit GI2), sous les ordres du lieutenant-colonel Puvis de Chavannes (neveu du peintre), groupement composé d’un bataillon d’infanterie et d’un escadron de reconnaissance (dont je faisais partie). Le bataillon sera aéroporté tandis que l’escadron arrivera par voie ferrée. Il y avait également un GI1 formé d’un autre bataillon de légionnaires, dont j’ignore la composition.” “Le 9, à 5 heures du matin, nous sommes à Sétif… Vers 11 h, nous partons en direction de Périgotville.” »
Les preuves d’une répression programmée
L’engagement des légionnaires sera brutal. Sans préparation, il était impossible de mobiliser et de transférer un bataillon et un escadron armés aussi rapidement, ce qui démontre clairement que le système colonial avait bel et bien pris les devants. Même s’ils ne sont pas responsables de la disparition tragique du curé Navarro (l’aumônier militaire tué à El Ouricia) et de l’administrateur principal de la commune mixte de Takitount, Rousseau, et de son adjoint Bancel, assassinés au lieu-dit Maghramane, les suppliciés d’Amoucha font les frais du déchaînement de la Légion, portant des coups durs à la population musulmane, meurtrie par la famine, le typhus, les sauterelles et la sécheresse. Pour de nombreux rescapés, la blessure demeure béante. Meurtrie par des épreuves douloureuses, Aldjia Yakoub, une centenaire, n’a rien oublié. Elle n’est pas disposée, dit-elle, à tourner la page. Lucide, la vieille dame n’éprouve aucune haine ni rancune envers les anciens tortionnaires et a bien voulu nous décrire une portion du tsunami de mai 1945. Gardant en mémoire les noms, les lieux, les faits, le malheur de ses coreligionnaires, la vieille dame a préféré commencer son récit par les châtiments infligés à ses parents et proches. Calcinés par le feu, la mort de sa fille Rbiha et des deux nourrissons (jumeaux) bouleverse profondément N’nâ Aldjia, un être jovial et affectueux. Pour la doyenne d’Amoucha, la transmission de la mémoire est l’ultime exercice d’une vie pléthorique en événements. Malgré le poids des ans, la mémoire de N’nâ Aldjia n’a pris aucune ride. Victime d’une fracture et de blessures, elle n’a pas oublié les tragiques disparitions de sa fille Rbiha (3 ans), de son premier mari Kernani Aïssa (mort à la prison de Constantine), de ses voisins, de ses proches et singulièrement de ses jumeaux Tichi et Chetibi : « L’effusion de sang de Sétif est rapportée par Mabrouk Diafet (un chauffeur de taxi). La terrible nouvelle ébranle le calme d’Amoucha, qu’on appelait Adouane. La mort de l’administrateur tué à Maghramane a été impitoyablement réprimée. La population de la commune mixte de Takitount, qui comprenait Aïn El Kebira, Amoucha, Tizi N’Bechar, Oued El Berd et Kherrata, paiera le prix fort », se souvient la centenaire.
Le martyre des nourrissons
Alertée, l’armée coloniale, appuyée par le tabor marocain et la Légion étrangère composée essentiellement de Sénégalais, investit les lieux, où elle ne fait pas dans la dentelle. Couverte par la hiérarchie politico-militaire du gouvernement d’Alger, la boucherie reste méconnue, aussi bien en Algérie qu’en France. « Aidés par la milice dirigée par le colon Darli, les militaires appréhendent, torturent, tuent, pillent et brûlent. Pour ne pas connaître le sort des fusillés, on abandonne tout. Sans réfléchir, je m’enfuis avec mes enfants Saadi et Ahmed. La terreur oblige ma belle-sœur à laisser derrière elle ma petite fille Rbiha, carbonisée à l’intérieur de notre gourbi. Après l’exécution de Larbi Tichi, affreusement mutilé puis fusillé au centre du village, son épouse, Messaouda, qui venait de donner naissance à des jumeaux, est elle aussi arrêtée. Le sort des nouveau-nés n’émeut pas les bourreaux. Des jours après, des parents découvrent l’horreur et deux innocentes créatures sans vie », soupire l’une des dernières « boîtes noires » de la tragédie. « Déshumanisés, les sanguinaires n’ont pas épargné les femmes enceintes. Attachée à une corde, traînée par une moto sillonnant le village, Zouina Makhlouche, la veuve d’Abdallah Chetibi, donne naissance à un mort-né. Inculpé à tort, son fils, Chetibi Tayeb, est condamné à 10 ans de travaux forcés. Il ne sera libéré qu’après trois années de détention. La peur de nouvelles représailles contraint ma belle-mère à enterrer ma fille, les jumeaux Tichi et le petit Chetibi en catimini, dans une fosse commune », révèle encore N’nâ Aldjia, qui éprouve toutes les peines du monde à retenir ses larmes.
Le supplice des femmes
N’ayant rien oublié de l’apocalypse, la vieille dame continue : « Mon époux, Kernani Saïd, qui avait à l’époque 45 ans, meurt à la prison de Constantine, au bout de trois mois d’incarcération. Tout au long de la tragédie de mai 1945, les femmes du village ont été elles aussi torturées et emprisonnées. Yamina Aoufi a vécu l’enfer. Poursuivie pour avoir divulgué les secrets du domicile d’une famille européenne où elle travaillait comme femme de ménage, l’épouse Mokrani est contrainte de partager une cellule avec des hommes. Elle ne quitte la prison de Sétif qu’après neuf mois de détention. La disparition de son fils Messaoud Mokrani, achevé par la torture, a terriblement affecté Yamina. L’histoire de Yamina Aoufi n’est pas un cas isolé. La vieille Fatima Kharfallah (70 ans) est descendue à la sortie du village, injustement criblée de balles. Battue à mort, Yamina Brakna (épouse de Hocine Khaled) perd la vue. Le tortionnaire Darli en est responsable. Il a en outre torturé son fils, Alloua Khaled. Il faut savoir que le drame des indigènes que nous étions n’a choqué personne ni provoqué la moindre émotion dans les milieux européens », précise la centenaire. Fouillant dans sa mémoire d’éléphant, N’nâ Aldjia revient sur ses propres cicatrices : « Je n’ai pas été informée de la mort de mon mari à temps. L’administration de la prison de Constantine n’a pas jugé utile de nous rendre le corps pour que nous puissions l’enterrer selon le rite musulman. Ne mesurant pas le tort fait à une épouse, mère de deux jeunes enfants, l’administration pénitentiaire me transmet l’acte de décès par voie postale. La réception du document me laisse sans voix, me choque. Muet, mon beau-frère n’échappe pas, lui aussi, à la torture. On lui a même cassé une jambe et il boitera une année durant. La haine a poussé les tortionnaires à piller. Après la razzia, ils calcinaient nos huttes et nos taudis… »
Des familles décimées
Ne perdant à aucun moment le fil conducteur, la mémoire vivante d’Amoucha aborde une autre facette des massacres : « Un jour, on nous bloque l’accès nord de la ville de Sétif, précisément à Farmatou, où l’armée exécute 20 personnes, dont un cousin, Amar Yahioui d’Ouled Azouz, Amar Belamri d’Ouled Aïssa et Ahmed Mekhlouche d’Ouled Belkacem. On a été contraints d’assister à l’exécution. Cette violence inouïe me bouleverse encore, 76 ans après. Pour l’histoire, qu’on ne pourrait travestir aussi facilement, le malheur de la famille Kerouani, qui a perdu Amar Kerouani tué à Maghramane par Joseph Torat (fils de colon), son frère Belkacem et leurs cousins Kerouani Khoutir et Lakhdar, exécutés à la prison d’El Harrach, nous donne un aperçu de l’ampleur de la boucherie. Notre supplice ne s’arrête pas là. Des jours après (précisément le mardi 22 mai 1945), l’armée française oblige des centaines d’indigènes (femmes, hommes, enfants et vieillards) d’Amoucha, de Tizi N’Bechar, d’Oued El Berd et d’autres localités de la région, à rejoindre à pied la plage de Melbou (Béjaïa) pour y demander pardon à l’autorité militaire, alors qu’elle était la principale responsable du bain de sang de mai 1945 », conclut N’nâ Aldjia, qui confiait ses souvenirs pour la première fois…
Kamel Beniaiche
The post Massacres du 8 mai 1945 : La face cachée du génocide first appeared on L'Est Républicain.