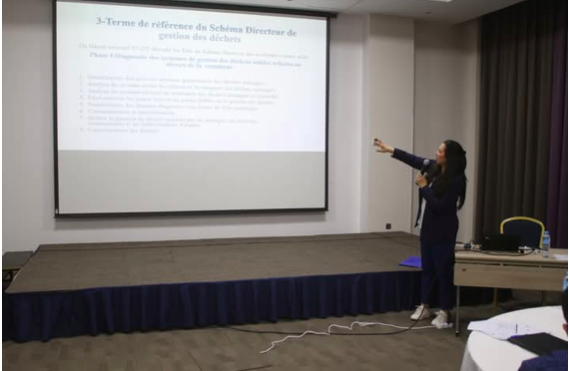Engagement, luttes et adaptations stratégiques : L’UGTA face aux défis de l’Histoire
L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), fondée le 24 février 1956, représente une évolution d’un syndicalisme profondément ancré dans la réalité politique et socio-économique du pays. Son histoire, marquée par des engagements militants, des tragédies et des transformations stratégiques, illustre parfaitement le concept d’«accordéon politique», un terme désignant la capacité du syndicat à s’étendre pour […] The post Engagement, luttes et adaptations stratégiques : L’UGTA face aux défis de l’Histoire appeared first on Le Jeune Indépendant.

L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), fondée le 24 février 1956, représente une évolution d’un syndicalisme profondément ancré dans la réalité politique et socio-économique du pays. Son histoire, marquée par des engagements militants, des tragédies et des transformations stratégiques, illustre parfaitement le concept d’«accordéon politique», un terme désignant la capacité du syndicat à s’étendre pour répondre aux attentes du pouvoir étatique, tout en se contractant pour défendre les intérêts de sa base.
En février 1956, dans une Algérie sous domination coloniale, où les travailleurs étaient largement marginalisés, la création de l’UGTA apparaît comme une réponse incontournable aux injustices syndicales et à l’oppression du système colonial. Au début des années 1950, la majorité des travailleurs algériens étaient intégrés dans des syndicats coloniaux, notamment la CGT, qui privilégiait majoritairement les revendications des travailleurs européens. Cette situation laissait les ouvriers algériens sans réelle représentation et sans défense de leurs droits spécifiques.
Face à cette exclusion, la nécessité de fonder une organisation syndicale autonome devint urgente. C’est dans ce climat de révolte et de quête de justice que l’UGTA voit le jour, portée par des figures emblématiques comme Aïssat Idir, son premier secrétaire général. Par son engagement et sa détermination, il incarne l’espoir d’une émancipation des travailleurs et pose les bases d’un syndicalisme radical et indépendant.
Dans un contexte où la lutte pour l’indépendance se conjugue à une mobilisation générale de la population, le syndicat joue un rôle essentiel en organisant des grèves générales et des manifestations pacifiques. Ces actions, en paralysant l’économie coloniale, deviennent autant d’armes de résistance et contribuent à attirer l’attention internationale sur la cause algérienne.
L’UGTA soutient ainsi activement le Front de libération nationale (FLN), en fournissant des ressources financières et logistiques, renforçant ainsi le lien entre le mouvement ouvrier et la lutte armée. Cette alliance stratégique, indispensable dans la lutte contre le colonisateur, s’inscrit dans une dynamique de sacrifice et de solidarité, marquant durablement l’histoire du syndicat.
Sur le plan international, le syndicat nationaliste s’est engagé dans la sensibilisation de l’opinion internationale à la question algérienne, tout en définissant les objectifs et le contenu politico-social de la révolution algérienne auprès des mouvements syndicaux du monde. L’organisation a également sollicité leur soutien moral et financier, de même qu’il a œuvré à élargir ses relations avec les organisations syndicales du monde entier, et ce en participant à de nombreuses réunions, conférences et manifestations syndicales et ouvrières.
Le parcours du syndicat est tragiquement ponctué d’arrestations, de tortures et de souffrances. En juillet 1959, Aïssat Idir est arrêté, torturé et assassiné par l’armée de la France coloniale, devenant un martyr dont le sacrifice galvanise le mouvement syndical, tant en Algérie qu’à l’international. « La lutte n’est pas un vain mot : chaque jour d’oppression renforce notre détermination à obtenir justice et liberté », disait-il. Ce témoignage continue d’inspirer ceux qui voient dans le syndicalisme une arme contre l’injustice.
Un syndicat au cœur de la construction de l’Etat
Après l’indépendance, l’Algérie ouvre un nouveau chapitre pour l’UGTA, qui devient un acteur central dans la construction de l’Etat. Fort de son héritage révolutionnaire, le syndicat se voit confier la mission de participer activement à la transformation socio-économique du pays. En outre, il devient un interlocuteur privilégié du pouvoir. Dans un contexte dominé par le FLN, le syndicat est intégré à l’appareil de l’Etat. La nationalisation des industries et l’organisation des services publics se font en grande partie par l’intermédiaire de la centrale syndicale qui, tout en défendant les intérêts des ouvriers, joue un rôle dans la mise en œuvre des politiques étatiques. Cette période voit l’UGTA se transformer en véritable outil de mobilisation, capable de canaliser la contestation, tout en participant activement au projet national.
Le FLN, moteur de la libération nationale, s’appuie ainsi sur des structures comme l’UGTA pour mobiliser les masses. Le syndicat, naturellement aligné avec les idéaux de souveraineté et d’indépendance, voit au fil des années son rôle politique se renforcer. L’UGTA devient ainsi un canal privilégié de dialogue entre le pouvoir et les travailleurs. Elle adopte une posture d’« accordéon politique », capable de se dilater pour défendre les revendications sociales et de se contracter pour soutenir les mesures gouvernementales. Cette relation ambivalente permet au FLN de renforcer sa légitimité tout en absorbant les critiques et oppositions qui pourraient émerger du mouvement ouvrier.
L’UGTA face aux défis du néolibéralisme
Les années 1980 sont marquées par l’émergence des premières réformes économiques libérales, qui transforment le paysage socio-économique algérien. Dans ce contexte, la base fait entendre sa voix, exigeant plus d’autonomie et une défense plus rigoureuse de ses droits. Cette tension culmine lors des manifestations d’octobre 1988, où les travailleurs expriment leur rejet des logiques d’instrumentalisation étatique. Cela met en lumière la nécessité pour l’UGTA de revoir sa posture.
Dans les années 1990, la décennie noire représente une période particulièrement éprouvante pour l’UGTA et l’ensemble du paysage politique. Dans un climat d’instabilité, de violence le syndicat se trouve confronté à des défis majeurs. Sous la direction d’Abdelhak Benhamouda, l’UGTA adopte un programme de réformes visant à renforcer le pouvoir d’achat et préserver les acquis sociaux. Le syndicat négocie notamment l’augmentation du salaire minimum garanti (SMIG) et insiste sur l’indexation des rémunérations pour compenser la hausse du coût de la vie.
Pour contrer les tentatives de privatisation anarchique, l’UGTA revendique la réorganisation de la sécurité sociale et la protection des droits liés aux pensions, considérant que la préservation du patrimoine social est un pilier de la dignité des travailleurs. Benhamouda avait affirmé sans équivoque que la privatisation ne devait se faire qu’en concertation avec le monde syndical et que toute démarche imposée sans dialogue représentait un risque pour la souveraineté nationale.
Bien que l’UGTA a exprimé des divergences sur certains aspects des réformes économiques, elle a, dans l’ensemble, soutenu le gouvernement dans ses initiatives pour restaurer la stabilité et lutter contre le terrorisme. Cet engagement a été perçu comme une manière de protéger les travailleurs contre les abus et la violence des groupes terroristes, mais aussi de préserver la paix sociale. Benhamouda a joué ainsi un rôle majeur dans l’engagement social et syndical, soutenant l’Etat dans la lutte contre le terrorisme. « Si c’est faire de la politique que de contribuer à sauver son pays, alors nous ferons de la politique », a-t-il déclaré face aux menaces croissantes. Cependant, en 1997, Benhamouda est assassiné par les terroristes, un drame qui marque une perte immense pour le mouvement syndical.
Le défi du XXIe siècle
Au début du XXIᵉ siècle, l’UGTA fait face aux défis d’un monde en mutation. La mondialisation, l’accélération des échanges économiques et la précarisation de l’emploi redéfinissent les relations entre le syndicat et ses membres. Le pouvoir d’achat s’érode et les revendications pour une meilleure protection sociale se font de plus en plus pressantes. Dans ce contexte, l’UGTA doit repenser ses stratégies et adapter son discours aux nouvelles réalités.
Paradoxalement, la dynamique d’« accordéon politique », qui avait longtemps caractérisé le syndicat, apparaît désormais comme un point de tension. Ainsi, les années 2000 font de l’UGTA un allié indéfectible des décideurs, accentuant le sentiment d’être perçue par une partie de la base comme un frein à une défense véritablement autonome des intérêts des travailleurs.
L’émergence du mouvement Hirak en 2019 accentue cette remise en question. Portant la voix d’une jeunesse en quête de transparence, de justice et de changement, il incite de nombreux militants à exiger que l’UGTA se détache de cette stratégie oscillante et renouvelle son engagement en défense des droits des travailleurs, de manière indépendante et intransigeante. Ce débat interne, nourri par des revendications renouvelées et par les mutations du marché du travail, pousse le syndicat à envisager une réforme en profondeur, capable de concilier héritage révolutionnaire et exigences contemporaines.
Aujourd’hui, l’UGTA se trouve à un véritable carrefour, maintenir son influence tout en naviguant entre la nécessité de soutenir les réformes du gouvernement et les attentes croissantes des travailleurs, qui réclament plus de justice sociale et d’amélioration des conditions de vie.
The post Engagement, luttes et adaptations stratégiques : L’UGTA face aux défis de l’Histoire appeared first on Le Jeune Indépendant.