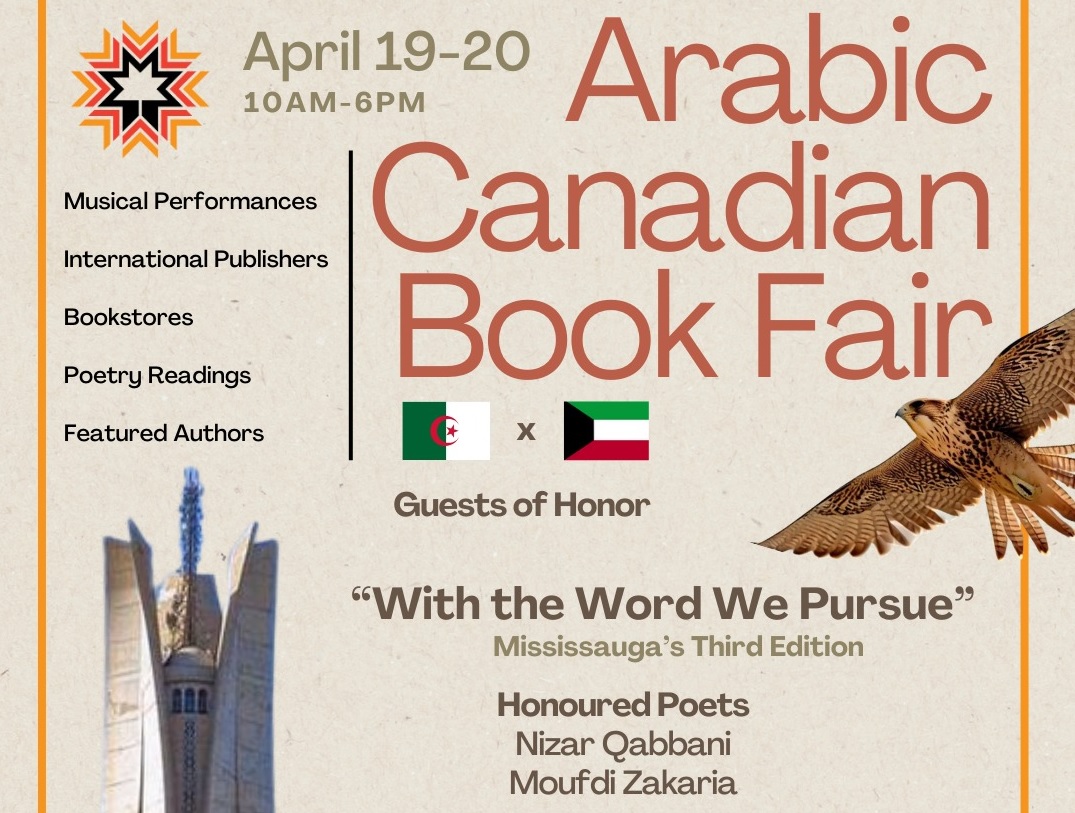L’administration américaine tout près d’admettre son échec dans sa médiation pour la paix en Ukraine
Au sortir d’une réunion regroupant à Paris l’Ukraine et ses alliés occidentaux, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les Etats-Unis mettraient fin à leurs efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine si dans les jours à venir nul progrès n’a été accompli en ce sens. Ce qui en soi […]

Au sortir d’une réunion regroupant à Paris l’Ukraine et ses alliés occidentaux, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les Etats-Unis mettraient fin à leurs efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine si dans les jours à venir nul progrès n’a été accompli en ce sens. Ce qui en soi est un aveu d’échec. On se garde en effet de faire ce genre d’annonce tant qu’on conserve quelque espoir de réussir. Propos confirmé quelques heures plus tard par Donald Trump dans le Bureau ovale, qui toutefois a donné le sentiment d’être moins pessimiste que Marco Rubio sur l’issue finale. Mais ce qui a retenu le plus l’attention dans sa réponse, c’est que celle-ci semble imputer à une des parties plutôt qu’à l’autre la responsabilité de l’échec de la médiation américaine, tout en laissant au public le soin de deviner laquelle, lui-même se gardant pour le moment de la désigner. De là, le fait que chacun a ou ensuite voir midi à sa porte, s’empressant d’interpréter les paroles de Rubio et de Trump à son avantage, ou plutôt de celui de son parti pris, pour l’Ukraine ou pour la Russie. En Occident, les commentateurs ont été unanimes pour dire que c’était la Russie qui faisait échouer les efforts américains pour la paix.
Pas n’importe Russie cependant, non, mais celle-là même qui a été encouragée par la complaisance de Trump, et davantage encore par le peu de considération affiché par lui envers l’Ukraine et son président Volodymyr Zelensky. En Russie, la tendance a bien sûr été inverse. Quoi qu’il en soit, force est de constater que désormais Trump lui-même a cessé de croire qu’il soit si facile de rétablir la paix en Ukraine. Au bout du premier trimestre de son deuxième mandat, la perspective qui s’ouvre devant lui, ce n’est pas la paix revenue en Ukraine, mais tout le contraire, l’exacerbation de la guerre qui s’y déroule depuis maintenant plus de trois ans. Le cessez-le-feu partiel d’un mois vient lui aussi à expiration, sans qu’il soit même question de le reconduire. Pour l’heure, donc, ce sont les pays européens restés fidèles à l’Ukraine qui voient les événements tourner à leur avantage. Dans quelques jours, les Etats-Unis selon toute vraisemblance seront obligés de reconnaître l’échec de leur médiation, et tout reviendra comme avant qu’une administration américaine n’en remplace une autre. A moins évidemment qu’un progrès notable ne se produise dans les négociations par l’entremise des Etats-Unis. Pareil développement ne peut survenir que de la part de la Russie, c’est-à-dire du belligérant à qui revient aujourd’hui l’avantage sur le plan militaire. D’autant que l’Ukraine est tout disposée à signer le deal sur ses métaux, qui plus est à peu près dans les termes posés par l’administration de Trump. A la Russie de faire le geste que les Américains attendent d’elle, qui le cas échéant ferait surmonter les obstacles empêchant l’élaboration d’un accord de paix. Le problème, c’est qu’on ne voit pas ce que cela pourrait être. Pour la Russie, la paix, ce sont principalement deux garanties : la conservation des territoires déjà acquis, et l’abandon pour toujours par l’Ukraine de son projet de devenir membre de l’Otan. Pour l’Ukraine et ses alliés, que l’on compte ou non les Etats-Unis au nombre de ces derniers, la paix n’est concevable que si la Russie au contraire se retire des territoires qu’elle occupe, et qu’elle laisse l’Ukraine libre de ses choix stratégiques.