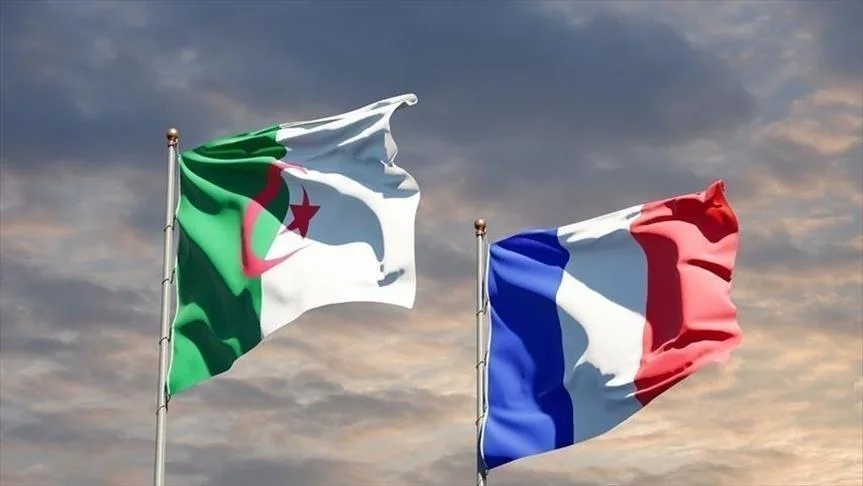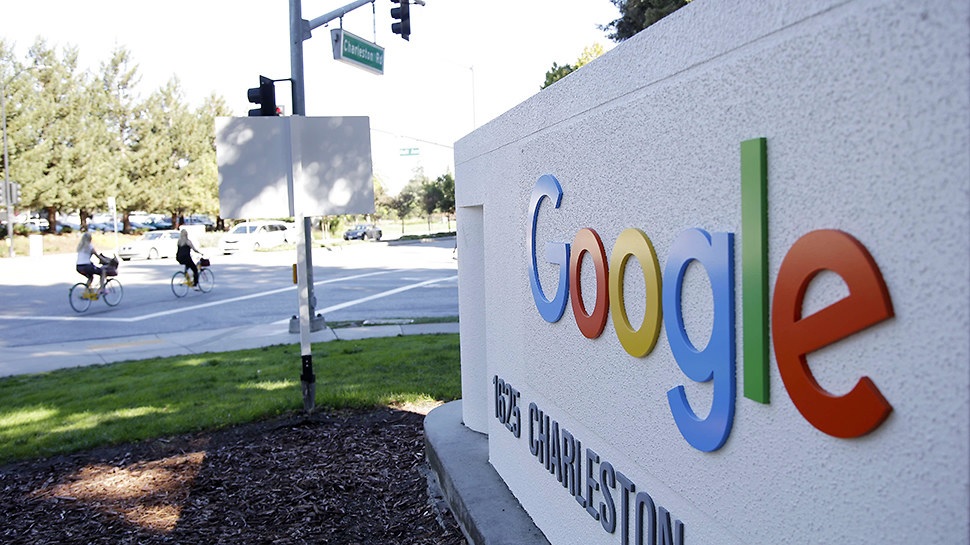Le réalisateur et producteur Mohamed Latrèche au Jour d’Algérie : «Présenter mes films au cœur de l’Afrique a une résonance particulière»
Mohamed Latrèche était passionné de cinéma avant de devenir réalisateur, acteur, scénariste, producteur et distributeur algérien de renommée internationale. Sa passion pour le cinéma a fait de lui un homme de grande compétence dans ce domaine. Propos recueillis par Abla Selles Natif de Sidi-Bel-Abbès, Mohamed Latrèche a produit et réalisé beaucoup de films salués par […]

Mohamed Latrèche était passionné de cinéma avant de devenir réalisateur, acteur, scénariste, producteur et distributeur algérien de renommée internationale. Sa passion pour le cinéma a fait de lui un homme de grande compétence dans ce domaine.
Propos recueillis par Abla Selles
Natif de Sidi-Bel-Abbès, Mohamed Latrèche a produit et réalisé beaucoup de films salués par les critiques. Très attaché à son pays, l’Algérie, et ses symboles, cet homme de cinéma œuvre à mettre la lumière sur l’histoire, la culture mais aussi les hommes qui ont participé à la construction de notre pays. Il participe dans quelques jours au Festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou avec «Zinet, Alger, Le bonheur» et «Boudjemaa & la maison cinéma». Mohamed Latrèche nous parle de son expérience et de ses projets.
nn Le Jour d’Algérie : Vous allez participer à la prochaine édition du Fespaco,
qu’ajoutera cet évènement à votre expérience ?
Mohamed Latrèche : Nous, réalisateurs algériens, avons souvent l’habitude de voir nos films plutôt diffusés en Europe, mais rarement sur notre propre continent. Participer au Fespaco est donc une opportunité précieuse. C’est bien plus qu’un simple festival : c’est un espace de rencontre unique, où l’Afrique cinématographique se rassemble, où les échanges avec le public et les professionnels du continent prennent tout leur sens. Pour moi, présenter mes films au cœur de l’Afrique a une résonance particulière. Nous partageons des préoccupations communes, des défis similaires, et ce dialogue direct avec les spectateurs et les créateurs africains est essentiel.
nn A chaque fois vous rendez hommage à une personne qui vous a marqué dans la vie. Pourquoi le choix de Mohamed Zinet et Boudjemaa ?
Faire un film, c’est raconter des parcours d’hommes, de femmes, des événements ou des phénomènes qui nous paraissent essentiels. J’ai voulu revenir sur l’histoire de Boudjemaa Karèche parce qu’à travers son travail à la Cinémathèque algérienne, il a accompli une véritable œuvre de salubrité publique. Boudjemaa est notre mémoire. La mémoire des cinéphiles, des cinéastes, des Algériens, des Africains, des Européens… et même de ceux qui l’ignorent. Pour Serge Daney, immense critique de cinéma, la Cinémathèque d’Alger est le chef-d’œuvre du cinéma algérien. Boudjemaa l’a dirigée pendant 34 ans. Nous sommes tous ses ciné-fils. Il était essentiel de lui consacrer un film.
Pour Zinet … Quand j’ai commencé à faire du cinéma il y a vingt ans, j’ai cherché à me situer dans l’histoire du cinéma algérien. Tahya ya Didou est vite devenu un repère, une boussole, car ce film incarne un cinéma viscéralement libre, audacieux, novateur.
Mon attachement à Mohamed Zinet tient autant à son talent qu’à son courage et à sa fragilité. Entre la France et l’Algérie, il a passé sa vie à osciller, laissant derrière lui des rêves inaccomplis, des promesses suspendues, des braises sous la cendre. Lui consacrer un film, c’était une évidence.
nn Qu’y a-t-il d’exceptionnel chez Tahya Ya Didou et dans le cinéma Zinet ?
Le mélange détonnant et réussi du drame, de l’humour, de l’impertinence, du théâtre et de la poésie. Il y a un mot qui résume tout cela je crois : Liberté. Et puis un gout prononcé pour l’expérimentation.
nn Tahia ya Didou est porteur de plusieurs messages, sur quoi voulez-vous attirer l’attention du public ?
La liberté. Sans la liberté, il est impossible de vivre et encore moins de faire des films.
nn Pensez-vous que votre message a été bien compris ?
Je l’espère.
nn Comment s’est précisée la forme finale de «Zinet, Alger, le Bonheur» ?
J’ai vu plusieurs fois Zinet en rêve, j’entretenais donc avec lui un dialogue direct. Et j’avais envie de lui donner des nouvelles à la fois de la Casbah, du pays, mais aussi de son film qui a été retrouvé, restauré et
l’amour que portent les gens à son film cinquante après son tournage. Donc le récit devait inéluctablement avoir une essence intime, prendre la forme d’un journal intime. Ceci dit, j’avais une hésitation car les consultants en scénario notamment me poussaient à faire un choix, à trancher. Soit faire un biopic sur Zinet ou un film consacré uniquement à mon rapport à Tahya ya Didou. Mais je ne les ai pas suivis. Pour moi, il était possible, nécessaire même de croiser les deux axes. Pour le tournage, j’ai associé un ami photographe, Youcef Krache, je lui ai demandé de faire le maximum de photos dans la perspective de les mélanger avec mes prises de vues vidéo. Restait Redouane, le neveux de Zinet, qui est le seul acteur vivant du film et qui incarnait dans Tahya ya Didou l’espoir, l’avenir, la relève. Je n’étais pas sûr qu’il accepte de témoigner et nous ouvre sa maison et son cœur comme il le fait dans le film. Cet entretien m’a bouleversé. Après cette rencontre, il est devenu évident que Redouane allait être le centre du film.
Quels sont vos projets ?
J’ai envie de continuer d’explorer l’histoire du cinéma algérien. Je m’attelle en ce moment au portrait de Brahim Tsaki (1946-2021) qui a réalisé, selon moi, le plus beau film du cinéma algérien, Histoire d’une rencontre, couronné d’un Étalon du Yenenga remis des mains de Thomas Sankara à Ouagadougou en 1985. À une époque où planait l’idée de la mort du cinéma (les années quatre vingt), Brahim porta ses films, en même temps que les cinématographies algérienne et africaine, vers des sommets de créativité. Il a été le porte-drapeau d’un cinéma réellement poétique. Je suis vraiment troublé de voir que je vais à Ouaga 40 ans, presque jour pour jour, après que Tsaki ait reçu l’Étalon des mains de Thomas Sankara. Mon esprit est accaparé par Brahim, je pense beaucoup à lui pendant la préparation de mon voyage à Ouaga. Du coup, j’ai pris la décision de tourner lors du Fespaco quelques séquences qui pourraient figurer dans le film que je lui consacre.
nn Un dernier mot ?
Je lance un véritable SOS aux responsables du cinéma en Algérie : il est urgent de sauver et de valoriser notre patrimoine cinématographique. C’est un chantier colossal, mais l’État algérien a les moyens d’y faire face. Nous ne pouvons pas laisser disparaître des œuvres qui font partie de notre histoire. Prenons un exemple frappant : Histoire d’une rencontre de Brahim Tsaki, un pur chef-d’œuvre du cinéma algérien. Aujourd’hui, l’Algérie ne possède plus la moindre copie de ce film. Un négatif a été retrouvé en Italie, et il est impératif de le restaurer et de le remettre en circulation. Chaque jour qui passe, c’est un pan de notre mémoire qui risque de s’effacer. Il est temps d’agir.
A. S.