Exclusif – La famille Boudiaf dénonce un crime d’Etat contre l’écriture historique
Les ayants droit de l’ancien président Mohamed Boudiaf – paix à son âme – nous ont adressé un texte dans... L’article Exclusif – La famille Boudiaf dénonce un crime d’Etat contre l’écriture historique est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Les ayants droit de l’ancien président Mohamed Boudiaf – paix à son âme – nous ont adressé un texte dans lequel ils corrigent les nombreuses inexactitudes contenues dans le livre paru aux éditions Plon sur Krim Belkacem. La contribution de Nacer, Tayeb et Mostefa Boudiaf «porte sur une question historique majeure et soulève un reproche fondamental à l’égard de l’auteur de l’ouvrage et de son préfacier : leur non-respect des principes élémentaires d’un travail rigoureux – absence de bibliographie détaillée, imprécision des lieux, des dates et des sources, entre autres lacunes», précisent-ils. «Ce manquement méthodologique affaiblit leur propos et nuit à la crédibilité de leur récit», soulignent les auteurs de la mise au point riche en informations historiques, que nous publions ci-après.
Crime d’Etat contre l’écriture historique : une double confusion des genres
Quand la passion littéraire l’emporte sur la rigueur historiographique
Nous avons récemment pris connaissance de l’ouvrage Un crime d’Etat, écrit par Farid Alilat et préfacé par Kamel Daoud, publié aux éditions Plon, qui ambitionne de retracer l’assassinat de Krim Belkacem – figure cardinale du Mouvement national algérien – survenu à Francfort en 1970.
Le titre, percutant et chargé de promesses, laissait espérer une enquête méthodique, étayée par des sources fiables, des témoignages croisés et une contextualisation historique à la hauteur du destin de l’homme évoqué. La réputation de la maison d’édition laissait légitimement attendre un travail sérieux, susceptible d’éclairer la trajectoire militante de Krim Belkacem, notamment durant la période décisive de 1947 à 1955, où il fut l’un des principaux artisans du combat nationaliste. Hélas, dès la préface, le ton est donné par un préfacier qui trahit ces exigences. A la lecture attentive de l’ouvrage, deux constats majeurs s’imposent.
D’une part, le texte évolue clairement sur deux registres distincts :
– un registre historique, concentré sur une cinquantaine de pages, qui prétend restituer le parcours militant de Krim Belkacem ;
– un registre politique et conjectural, consacré aux circonstances obscures de son assassinat, marqué par l’incertitude, la rareté des preuves et la prolifération d’hypothèses.
D’autre part, les faiblesses méthodologiques qui affectent la première partie fragilisent inévitablement la crédibilité de la seconde, plus spéculative encore. Cette double approche aurait pu constituer la richesse de l’ouvrage ; elle en révèle surtout les limites.
Dans sa reconstitution historique, l’ouvrage propose un texte lacunaire, souvent approximatif, nourri de témoignages périphériques, de récits indirects et de sources secondaires, sans recours véritable aux documents primaires – archives, correspondances, entretiens – émanant des acteurs centraux de l’époque. Ce déficit de rigueur est d’autant plus problématique qu’il porte sur une séquence abondamment documentée, où l’exigence de précision constitue une condition essentielle de l’intelligibilité des faits.
Ces approximations ne sont pas sans conséquence : elles orientent, parfois de manière insidieuse, l’analyse des circonstances entourant la mort de Krim Belkacem. Une base historique incertaine induit toujours des risques d’interprétation erronée, surtout lorsqu’il s’agit de questions aussi graves que celles impliquant les appareils d’Etat et les responsabilités politiques.
Cette confusion des genres n’est pas anodine ; elle soulève une question de fond sur la manière même d’écrire l’histoire contemporaine. En procédant de la sorte, l’ouvrage compromet à la fois la portée analytique de son propos et la fiabilité de ses conclusions. Ce brouillage méthodologique transparaît dès le titre, qui entretient une ambiguïté sur les intentions réelles de l’ouvrage : récit informé ou reconstruction romancée ? Enquête journalistique ou fresque historique ?
Plus préoccupant encore, cette légèreté documentaire et méthodologique est avalisée, dès la préface, par un intellectuel qui n’hésite pourtant pas à condamner avec vigueur les falsifications de l’histoire nationale. Fustigeant une mémoire tronquée et instrumentalisée, le préfacier dénonce l’écriture officielle de l’histoire, tout en apposant sa signature à un ouvrage qui en reproduit les dérives les plus flagrantes. Ce paradoxe mine profondément la crédibilité de son propos : en prétendant combattre la manipulation, il en devient, consciemment ou non, le relais dans ce livre.
Depuis 1989, l’Algérie connaît une libéralisation sans précédent du champ éditorial et médiatique : publication massive d’ouvrages historiques – signés par Harbi, Meynier, Aït Ahmed, Daho Djerbal ou Omar Carlier –, diffusion de documentaires, multiplication des témoignages d’acteurs de la Guerre de libération. L’accès aux sources n’a jamais été aussi aisé pour quiconque souhaite sincèrement comprendre cette période et toutes nos sources bibliographiques pour ce travail ont été acquises à partir de cette date. Le préfacier, membre reconnu de l’élite intellectuelle algérienne, aurait dû s’y plonger.
Ce décalage entre le ton dénonciateur et l’ignorance manifeste des ressources disponibles pose question. Il traduit moins une entrave à la connaissance qu’une négligence, voire une légèreté intellectuelle, d’autant plus inacceptable de la part d’un écrivain et journaliste en 2025. Et la question se prolonge : pourquoi la maison Plon, réputée pour son sérieux, a-t-elle choisi de publier un texte aussi peu étayé, validé par une préface si manifestement en contradiction avec les faits ?
Traiter d’une figure comme Krim Belkacem engage une responsabilité éthique et intellectuelle : celle de restituer la complexité du contexte, de respecter la gravité des faits et de répondre à l’exigence de probité que commande la mémoire collective du peuple algérien.
En tant que descendants de Mohamed Boudiaf, et cohéritiers de sa mémoire, nous avons toujours défendu cette exigence de rigueur historique.
Mohamed Boudiaf lui-même l’exprima avec clarté et gravité lors du reportage réalisé par Haya Djelloul en 1990, consacré aux sources de l’insurrection du 1er Novembre 1954 à travers les témoignages des principaux survivants de l’époque. Ce document audiovisuel – toujours accessible en ligne (Boudiaf : Les sources du 1er novembre 1954, vidéo YouTube, minute 0:15 – https://www.youtube.com/watch?v=Oo0k_cseLcA&t=961s) – s’ouvre sur une phrase devenue emblématique, que Boudiaf fait sienne dès les premières minutes :
«Un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple orphelin.» Cet adage, dont la portée dépasse les époques et les géographies, résonne à la fois comme un avertissement et comme une leçon de responsabilité. Il s’inscrit dans une tradition intellectuelle ancienne : de Cicéron, pour qui l’histoire est la lumière de la vérité, à Ibn Khaldoun, qui voyait dans l’oubli du passé le ferment de la décadence, en passant par les penseurs de la décolonisation qui ont fait de la mémoire un instrument de reconquête identitaire.
Dans la bouche de Mohamed Boudiaf, cette maxime n’avait rien de rhétorique. Elle constituait une injonction adressée aux générations futures : la connaissance historique n’est pas un privilège de lettrés, mais un fondement de souveraineté. Elle est ce lien vital qui unit les vivants aux morts, les héritiers aux fondateurs, la société présente à l’idéal de justice et de dignité, porté par les combattants de l’indépendance.
Méconnaître cette exigence, c’est courir le risque d’un déracinement collectif, d’un oubli organisé, voire d’une instrumentalisation politique de la mémoire. C’est pourquoi nous réaffirmons ici, avec la fermeté qu’impose la situation, l’engagement hérité de notre père :
défendre une histoire fondée sur des faits établis, des sources vérifiées et une probité intellectuelle sans compromis.
Face au danger que les erreurs, simplifications ou approximations, ne deviennent, avec le temps, des «vérités» admises par défaut, nous nous sentons moralement et historiquement investis du devoir de répondre point par point aux carences méthodologiques constatées dans l’ouvrage évoqué – en particulier pour la période 1947-1955 – afin de préserver l’intégrité de notre histoire nationale et la dignité de ceux qui l’ont écrite au prix de leur vie.
Préambule
Une histoire malmenée qui mine la crédibilité de l’enquête journalistique
Ce constat méthodologique prend une résonance d’autant plus préoccupante que les premières pages de l’ouvrage, consacrées à la période 1947-1955, conditionnent la lecture de l’ensemble du livre. Sur près de 40 pages, soit près d’un sixième du volume total, l’auteur prétend restituer le parcours militant de Krim Belkacem avant le déclenchement de la guerre, ainsi que les dynamiques internes du nationalisme algérien. Or, cette séquence pourtant décisive dans la formation politique et idéologique du personnage principal est traitée avec une légèreté déconcertante : absence de chronologie précise, confusion des protagonistes, faits non sourcés, reconstitutions invérifiables, amalgames entre événements disjoints.
Cette carence documentaire et analytique ne relève pas seulement d’une faiblesse d’érudition : elle affecte directement la crédibilité des 200 pages qui suivent. Comment prétendre dévoiler les coulisses d’un crime d’Etat si l’on échoue d’emblée à restituer de manière fiable la trajectoire de la victime ? Comment interroger les responsabilités implicites ou cachées de l’appareil d’Etat si l’on se méprend sur les affiliations, les réseaux, les conflits politiques qui structurèrent le champ nationaliste dans ses années fondatrices ?
En négligeant la rigueur historique là où elle était la plus accessible – car abondamment documentée –, l’auteur compromet les fondements même de son enquête. L’erreur ou l’approximation dans les premières pages n’est pas anodine : elle agit comme un poison lent, qui infiltre progressivement le raisonnement, mine la confiance du lecteur averti, et ouvre la voie aux extrapolations les plus fragiles.
Une démonstration ne peut reposer sur un socle incertain. Et lorsqu’il s’agit de désigner un crime d’Etat, ce socle doit être d’une solidité irréprochable.
I : L’Organisation Spéciale (O. S.)
Dans son ouvrage (p. 25), l’auteur affirme :
«Au sein de l’O. S., on compte donc Ahmed Ben Bella, Mohamed Belouizdad (qui décédera en 1952 à Paris), Hocine Aït Ahmed, Mohamed Khider ou encore Larbi Ben M’hidi. Parmi eux, Ben Bella se détache du lot […]»
Cette affirmation contient une erreur majeure : Mohamed Khider n’a jamais été membre de l’O. S., contrairement à ce que prétend l’auteur. Cette confusion est d’autant plus surprenante que Mohamed Boudiaf, acteur central de cette époque, ne mentionne jamais Khider dans La Préparation du 1er Novembre (1974), lorsqu’il dresse la composition de l’état-major national de l’O. S. :
«Au printemps 1948, l’O. S. put fonctionner en toute autonomie : un état-major national fut constitué : coordinateur : Mohamed Belouizdad ; responsable militaire : Belhadj Djillali ; responsable politique : Hocine Aït Ahmed ; responsables départementaux : Oranie : Ben Bella ; Algérois : M. Maroc ; Alger-Ville et Mitidja : Reguimi Djillali ; Kabylie : Aït Ahmed et, dans la région de Constantine, Mohamed Boudiaf.»
1 : L’appartenance fictive de Khider à l’O. S. : une reconstruction douteuse
L’auteur attribue à Mohamed Khider un rôle actif dans l’O. S., allant jusqu’à le présenter comme l’un des auteurs du célèbre braquage de la poste centrale d’Oran en avril 1949. Or, cette version ne résiste pas à l’analyse des sources sérieuses. Khider n’a jamais appartenu à l’O. S. : il fut élu député d’Alger sous la bannière du MTLD (Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques), puis envoyé au Caire pour une mission politique. Lui-même le confirme lors de son interrogatoire par les autorités françaises en octobre 1956 (voir Annexe 1). Aucune archive sérieuse, aucun témoignage crédible de l’époque ne le cite comme acteur actif – encore moins dirigeant – de l’organisation clandestine.
En revanche, Ahmed Ben Bella, alors responsable régional de l’O. S. à Oran, a bel et bien participé à cette opération. Ce genre de confusion entre acteurs politiques et cadres clandestins nuit gravement à la précision historique.
2 : Le démantèlement de l’O. S. : les véritables causes
Autre inexactitude de taille : il établit un lien de cause à effet entre le braquage d’Oran et le démantèlement de l’O. S. en mars 1950. Il écrit à la page 25 :
«Le premier coup d’éclat de l’O. S. est l’attaque spectaculaire menée en avril 1949 par Ben Bella, Khider et Aït Ahmed contre la poste centrale d’Oran… L’enquête de la police et la traque lancée contre les auteurs vont aboutir au démantèlement de l’O. S. en mars 1950.»
Cette présentation spectaculaire relève davantage du roman que du travail historique. Mohamed Boudiaf, acteur central et témoin direct, en donne une toute autre lecture dans ses mémoires :
«En mars 1950, une répression féroce s’abattit sur l’O. S., démantelant ses structures, arrêtant des centaines de militants et paralysant les autres. Un incident mineur à Tébessa, où un cadre exclu pour collusion avec la police alerta les autorités, provoqua la vague d’arrestations. C’est par cette malheureuse maladresse que débuta la répression contre l’ensemble de l’O. S.»
Un éclairage complémentaire peut être trouvé dans une intervention filmée de Mohamed Boudiaf en 1990, lors d’un duplex entre Alger et Rabat. Il y évoque directement, en présence de Lahouel, les responsabilités de ce dernier dans l’effondrement de l’O. S., en tant que secrétaire général du MTLD. Cette séquence est visible à la minute 15:30 de la vidéo suivante :
 Lire plus
Lire plus













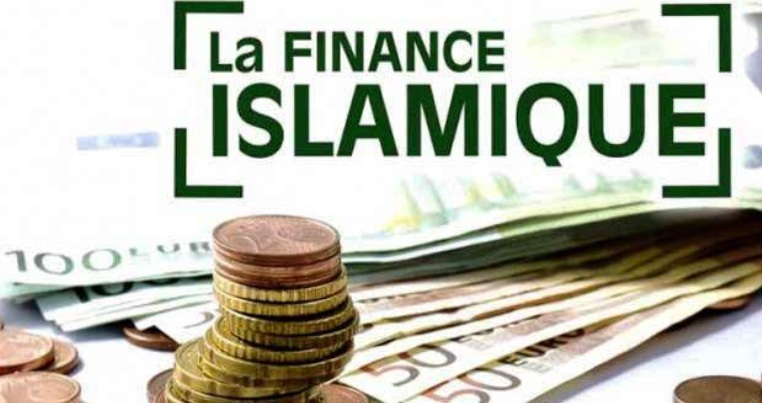











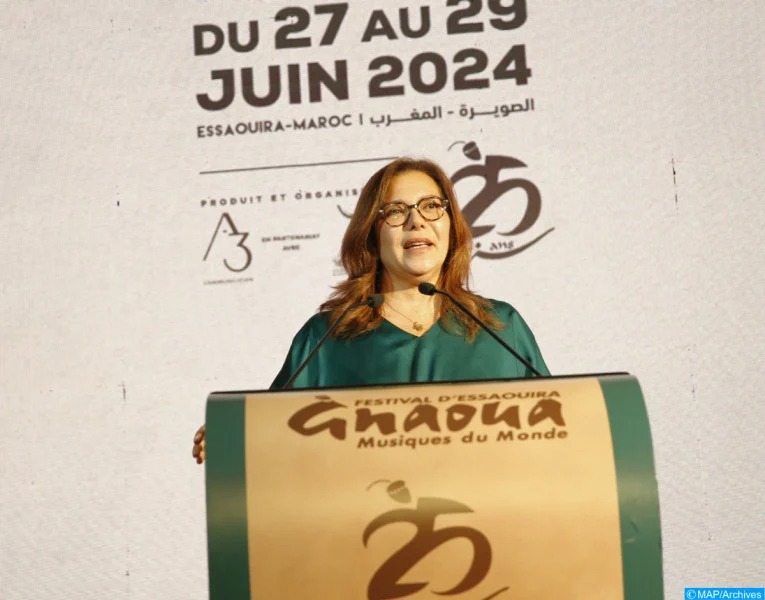












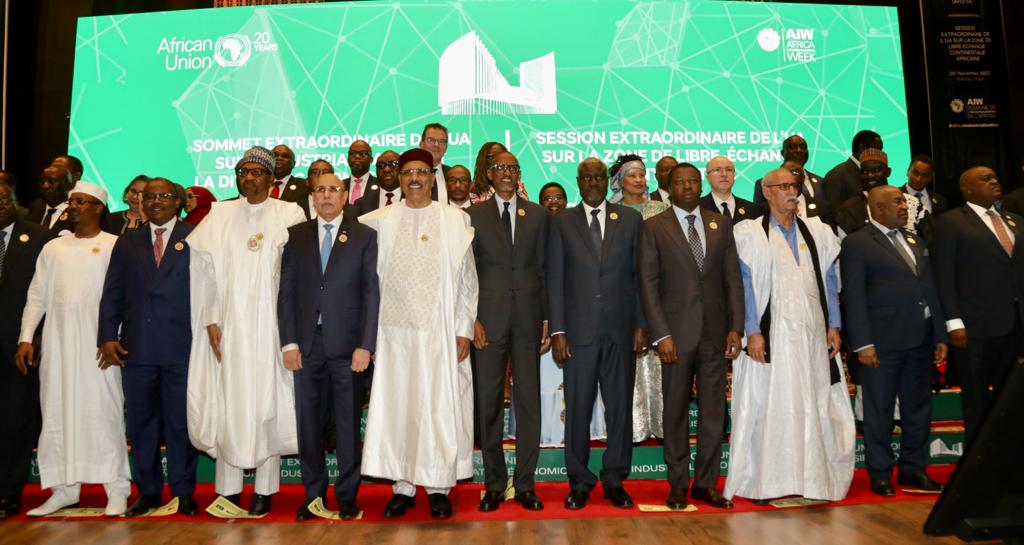






.jpg?#)










































































