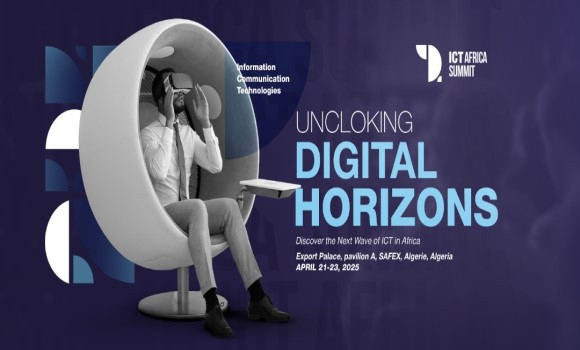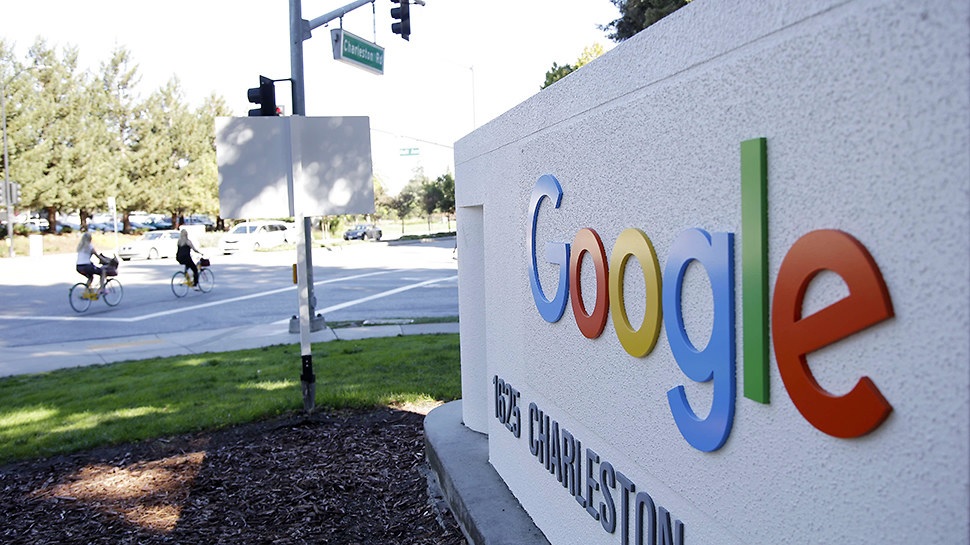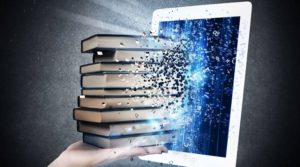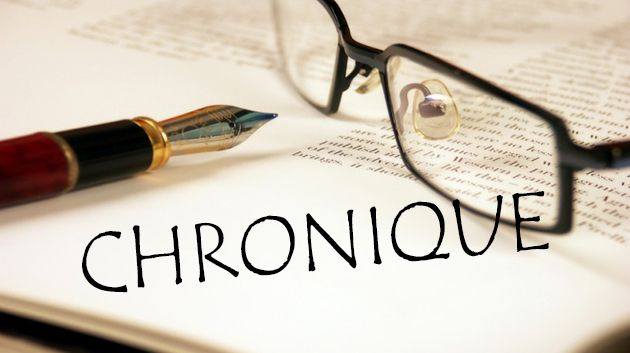La guerre en Ukraine, trois ans plus tard
Hier 24 février, troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, il a moins été question de ce qui se passe sur le terrain militaire que du deal dit des minéraux que l’administration Trump est désireuse de conclure rapidement avec le président ukrainien, mais que ce dernier s’entête non pas, à vrai dire à […]

Hier 24 février, troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, il a moins été question de ce qui se passe sur le terrain militaire que du deal dit des minéraux que l’administration Trump est désireuse de conclure rapidement avec le président ukrainien, mais que ce dernier s’entête non pas, à vrai dire à repousser, mais à retarder pour à la fin en tirer le meilleur profit. La veille, le président russe a bien fait allusion à une offensive sur la partie de Koursk encore occupée, dans le but de la libérer, mais jusqu’à présent rien n’est venu confirmer cette annonce. Tout au contraire, les Ukrainiens l’ont démentie. Si les Russes ont voulu marquer le coup en lançant ce jour-là une opération d’envergure, le fait est qu’il ne semble pas que le succès soit au rendez-vous. Ce n’est pas sur le terrain militaire qu’est advenu récemment le plus significatif dans cette guerre, où les lignes depuis des mois bougent à peine, le cas échéant d’ailleurs toujours en faveur de la Russie, mais aux Etats-Unis, où il y a maintenant un peu plus d’un mois une alternance au pouvoir s’est produite à même de hâter la fin d’un conflit qui laissé à lui-même pourrait s’éterniser. Cette guerre est en apparence seulement une guerre entre l’Ukraine et la Russie.
En réalité, c’en est une entre la Russie et l’Otan, mais qui se déroule en Ukraine seulement, et depuis quelque temps également dans un coin de Russie, ce qui en fait une guerre mondiale avec cette particularité d’être confinée dans un seul pays. Elle n’est pas la seule à répondre à cette définition par les temps qui courent. Elle a été précédée par la guerre civile en Syrie dans laquelle se sont immiscés tant la Russie que des membres de l’Otan, dont au premier chef les Etats-Unis. En Syrie, bien que pour le moment le conflit soit à l’arrêt, ce qui ne veut pas dire définitivement réglé, les forces étrangères y sont encore présentes. Dernièrement, Israël, profitant de la chute de Bachar al Assad, a pris de nouvelles terres syriennes. Il exige maintenant que tout le sud de la Syrie soit démilitarisé. Volodymyr Zelensky est si peu opposé au deal des minéraux qu’il y voit au contraire une planche de salut après la rencontre de Riyad des chefs de la diplomatie russe et américain, à l’effet d’une part de restaurer leurs relations, interrompues depuis trois ans, et de l’autre de mettre fin à la guerre par des moyens pacifiques. Deux objectifs qui ne conviennent ni à l’Europe ni à Kiev. Les Européens sont toujours d’avis qu’il faut infliger à la Russie une défaite stratégique, c’est-à-dire une défaite dont elle serait ensuite incapable de se relever. Si le rapprochement russo-américain se confirmait, le salut pour Zelensky et son pouvoir, l’un et l’autre pour le moment plutôt mal vus par la nouvelle administration américaine, serait d’être lié à celle-ci par des intérêts économiques solides, à ce point vitaux pour elle qu’elle n’aurait d’autre choix que de les défendre contre l’hostilité russe, qui elle évidemment est sans remède. A cette demande ukrainienne de garanties sécuritaires devant accompagner tout deal sur les minéraux, les Américains, par l’intermédiaire de leur nouveau secrétaire au Trésor, ont répondu qu’ils ne pouvaient offrir que des garanties économiques. Mais à bien y regarder, n’est-ce la même chose, à l’appellation près ?