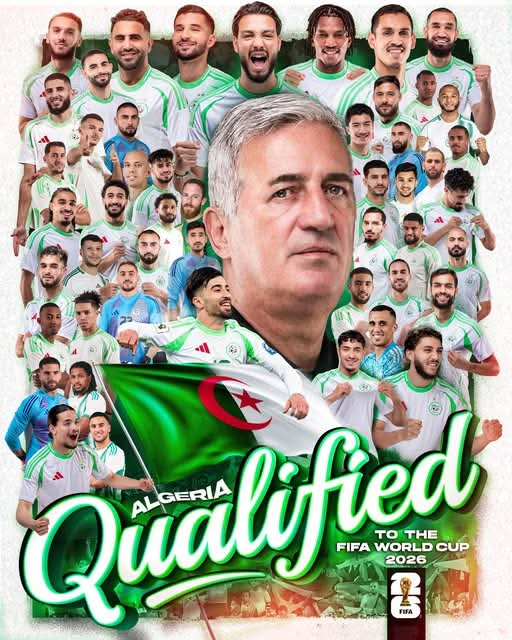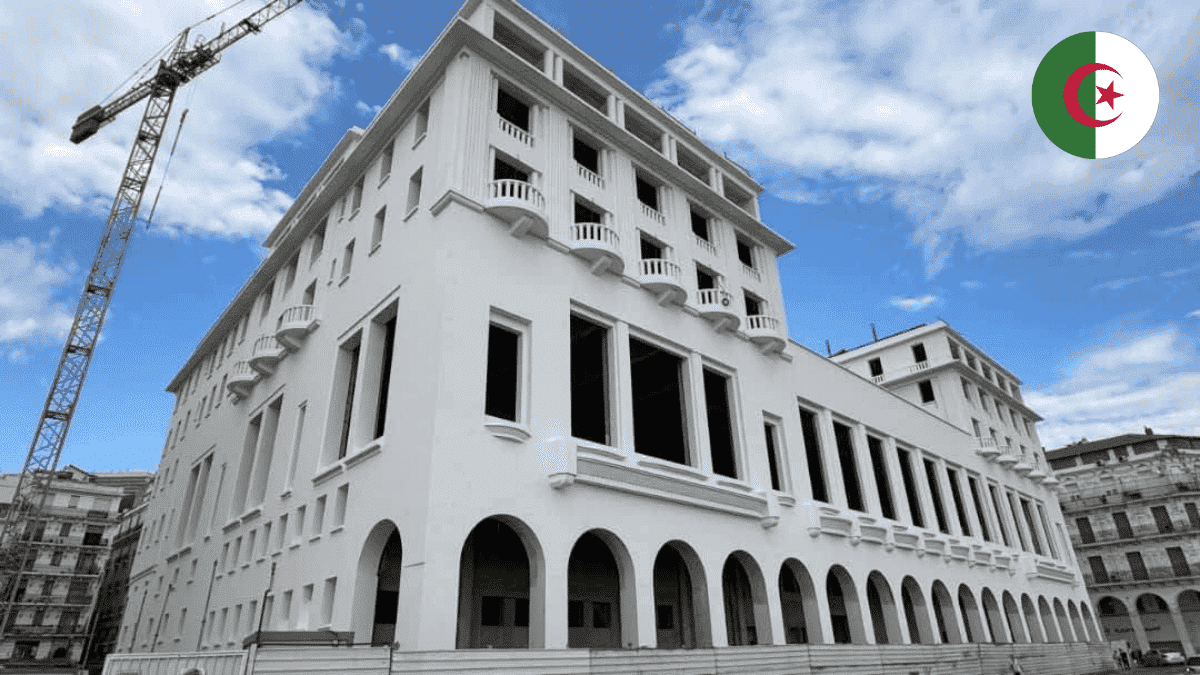Le paysage médiatique algérien : la réalité et le projet
Une contribution d’Aboubakr Zemmal – Le paysage médiatique algérien a de nouveau occupé, ces derniers mois, le devant de la scène... L’article Le paysage médiatique algérien : la réalité et le projet est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Une contribution d’Aboubakr Zemmal – Le paysage médiatique algérien a de nouveau occupé, ces derniers mois, le devant de la scène en s’inscrivant dans un débat presque interminable. Ce constat renvoie à une réalité qu’on ne peut occulter, à savoir ces nombreuses et importantes attentes exprimées tant par les professionnels du secteur que par les consommateurs de contenus médiatiques.
S’il y a un mérite à attribuer à l’actuel ministre de la Communication, Mohamed Meziane, c’est d’avoir ouvert ce débat, jusque-là cantonné aux rédactions, soulevant ainsi une cascade de questions relatives à l’avenir du secteur et à sa capacité à faire face à l’assaut médiatique sans précédent dirigé contre le pays. Le ministre a, en effet, soulevé le couvercle de la marmite, qui s’avère fort bouillonnante.
Ainsi, que ce soit dans ses déclarations, ses rencontres avec de nombreux acteurs des médias ou ses déplacements sur le terrain, le ministre n’a pas hésité à soulever ces questions, cherchant des réponses immédiates et nécessaires pour y remédier. A ce stade, nous devons, au moins, reconnaître la multiplicité et la complexité de ces problèmes, qui se sont accumulés au fil du temps, sans avoir reçu pour autant l’attention sérieuse et minutieuse qu’ils méritaient. Aussi, force de reconnaître que l’effort visant à instaurer le changement souhaité au niveau du paysage médiatique national ne peut se concrétiser qu’en s’attaquant aux sources des déséquilibres, un effort entrepris par le ministère de la Communication il y a un peu plus de six mois.
La mission n’est pas de tout repos. Les actions entreprises, en ce laps de temps, ne peuvent être suffisantes pour prendre en charge toutes ces attentes dans un secteur extrêmement sensible, compte tenu de ses problèmes complexes et des embûches qui entravent sa progression vers des objectifs qui exigent de la patience et du temps.
La question qui se pose, dans ce contexte, tourne autour de l’idée formulée par le docteur Mohamed Meziane et de son regard sur la situation générale actuelle de la profession, ainsi que sur les tensions récurrentes et tenaces qui se sont accumulées au fil du temps et qui, si elles n’étaient pas ignorées, furent tout simplement renvoyées aux calendes grecques.
Il est également logique, par conséquent, de s’interroger sur le modèle médiatique auquel il est parvenu et sur l’approche qu’il envisage pour opérer le changement qualitatif recherché.
Le ministre a été précédé à la tête du secteur par plusieurs personnalités, issues presque exclusivement du monde des médias et de la culture. Il est évident que la plupart d’entre elles connaissent parfaitement la situation. Certains de ces acteurs ont réussi, d’autres ont échoué dans la bataille médiatique.
Il est notable, cependant, que l’incapacité à suivre le rythme des changements en cours demeure une caractéristique générale du secteur. Ceci explique le sentiment généralisé parmi les professionnels qui se caractérise par une forme de culpabilité quant à l’état de délitement que vit le secteur.
Il semble, aujourd’hui, que beaucoup se préoccupent moins de la qualité du produit médiatique, puisqu’ils sont plutôt occupés par le «siphonage» de la plus grande part possible des recettes publicitaires, dont les institutions et les entreprises publiques sont les principales pourvoyeuses.
Cette situation oblige le ministère à engager une réflexion sérieuse pour répondre à cette question cruciale, en relation avec le modèle économique que les entreprises du secteur devront adopter afin de gagner en force et d’assurer leur pérennité.
Face à cette réalité, il est aberrant de constater que de nombreux responsables ne voient d’autre solution que dans la publicité. Nous sommes confrontés à une réalité amère qu’il faut reconnaître : certains, malgré les sommes colossales que l’Etat continue à leur allouer, régulièrement, sans aucun contrôle, ni obligation de rendre des comptes, continuent à manifester des signes de souffrances et à faire du porte-à-porte pour en avoir plus. Et si vous leur posiez les questions : qu’avez-vous fait des sommes faramineuses perçues ? Est-ce que vous les avez utilisées pour aider à la formation d’une génération de journalistes dont le pays serait aujourd’hui fier ? Une génération de brillants journalistes, capables de rivaliser en matière de confection de grands reportages et enquêtes, de mener correctement des interviews ou de rédiger des chroniques et des articles d’opinion. Est-ce que ces sommes ont été utilisées pour revigorer les entreprises de presse, de manière à assurer leur pérennité ? Tant de questions qui demeurent malheureusement sans réponses.
Il est clair, cependant, que certaines de ces questions – et elles ne constituent que la partie émergée de l’iceberg – sont presque les seules auxquelles ces personnes auraient dû répondre, avant que l’Etat ne soit tenu pour responsable d’autres problèmes cruciaux liés aux médias, c’est-à-dire la liberté d’expression et toutes les considérations qui lui sont associées.
Le tableau n’est pas reluisant, certes, et la responsabilité historique des cadres de la presse issue des réformes de 1990 est engagée. A partir de là, la vérité qui s’impose avec entêtement est que ces responsables sont interpellés, de par leur position de faiseurs d’opinion, sur leur obstination à continuer à agir de la même manière et à ne rien entreprendre pour initier une révision approfondie de toute leur trajectoire depuis l’ère de l’ouverture médiatique en Algérie. Qu’a-t-on réellement offert à l’Algérie ?
Il est donc clair que l’approche du ministre Mohamed Meziane, compte tenu de ses actions, ces derniers mois, ne saurait se réduire à une simple question de partage de la publicité, comme pérorée à tue-tête depuis un certain temps, sinon depuis l’avènement du pluralisme médiatique en Algérie. Cette approche préconisée va donc bien au-delà, soulevant des questions stratégiques liées à la sécurité de l’Etat, à la défense de la paix sociale et à la capacité des médias nationaux de répondre efficacement aux attaques médiatiques hostiles et récurrentes.
Il convient de noter que lorsque nous parlons de bataille médiatique, nous entendons une bataille truffée de nombreuses surprises, menée dans les médias internationaux, en plus d’autres moyens de communication à portée effrayante, avec des contenus terrifiants qui pullulent au cœur même de nos téléphones portables, de nos écrans de télévision et ordinateurs. C’est une bataille rude et à visées destructrices qui est menée contre nous. Les plus malins, les plus intelligents et les plus rusés sont ceux qui savent laisser libre cours à leur imagination et entrer dans son tourbillon avec une force qui confond adversaires et ennemis, et qui va à l’essentiel, en laissant de côté les événements insignifiants et les détails superflus.
Nous devons mobiliser toutes nos possibilités médiatiques pour vaincre. La victoire ne vient pas seule, si elle n’est pas convoitée par une stratégie préétablie et savamment concoctée.
C’est, de mon point de vue, le combat qui occupe actuellement l’esprit du Dr Mohamed Meziane et de nombreux décideurs algériens : envisager les médias avec une perspective plus large ; se positionner en première ligne, libérer les initiatives créatives, rompre avec les maîtres de la médiocrité qui ronge nos médias et défaire les inhibitions liées à la notion de peur et de terreur qui hante ceux qui ont des opinions divergentes mais fondées et lucides, pour les placer au cœur des changements qui se dessinent et qui se mettent en perspective du développement d’un soft power agissant et efficace.
Il y a quelques semaines, un débat libre autour de mon livre Le Temps des militaires a été organisé. C’était à la librairie El-Ijtihad d’Alger-Centre. Les médias étaient invités. Il y avait ceux qui ne donnaient pas cher de ma peau. Ils s’attendaient à ce que la rencontre soit interdite et que je sois réprimé. Rien de tout cela n’est arrivé. Les autorités, à leur manière, ont approuvé la rencontre, tandis que ceux que nous pensions soucieux de la liberté d’expression en avaient peur. C’est un paradoxe déconcertant qu’il faut surmonter pour changer et aller de l’avant.
Il y a un autre problème auquel fait face la profession. Il s’agit de l’autocensure qui est devenue au fil du temps endémique. Ce problème complexe ne peut, hélas, être résolu par une décision imposée d’en haut.
A. Z.
Journaliste, écrivain
L’article Le paysage médiatique algérien : la réalité et le projet est apparu en premier sur Algérie Patriotique.