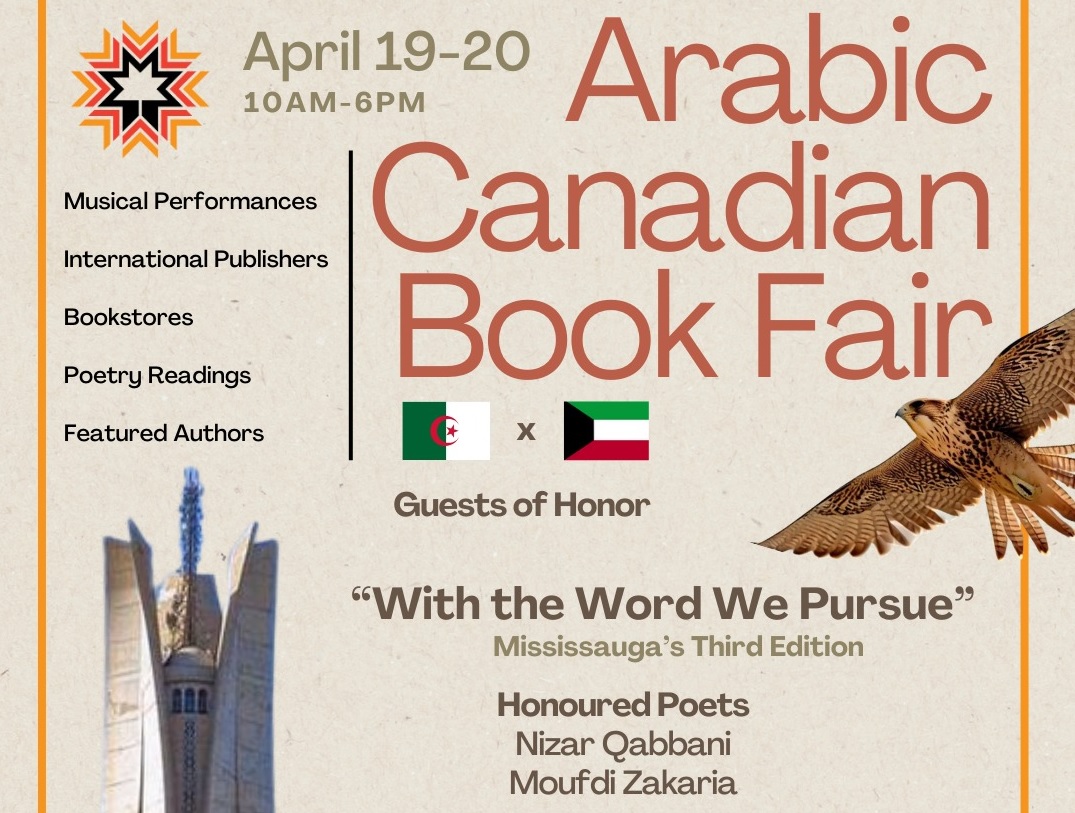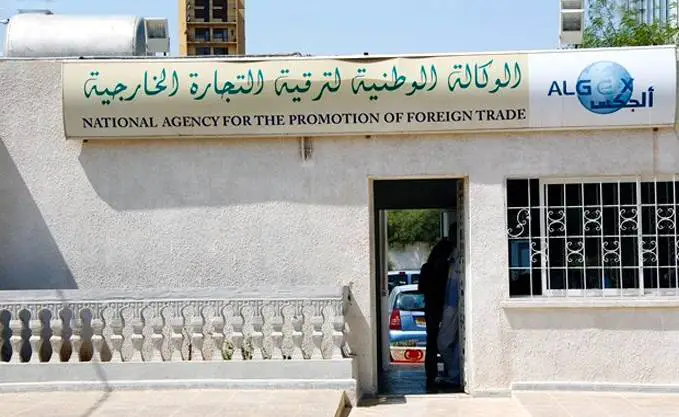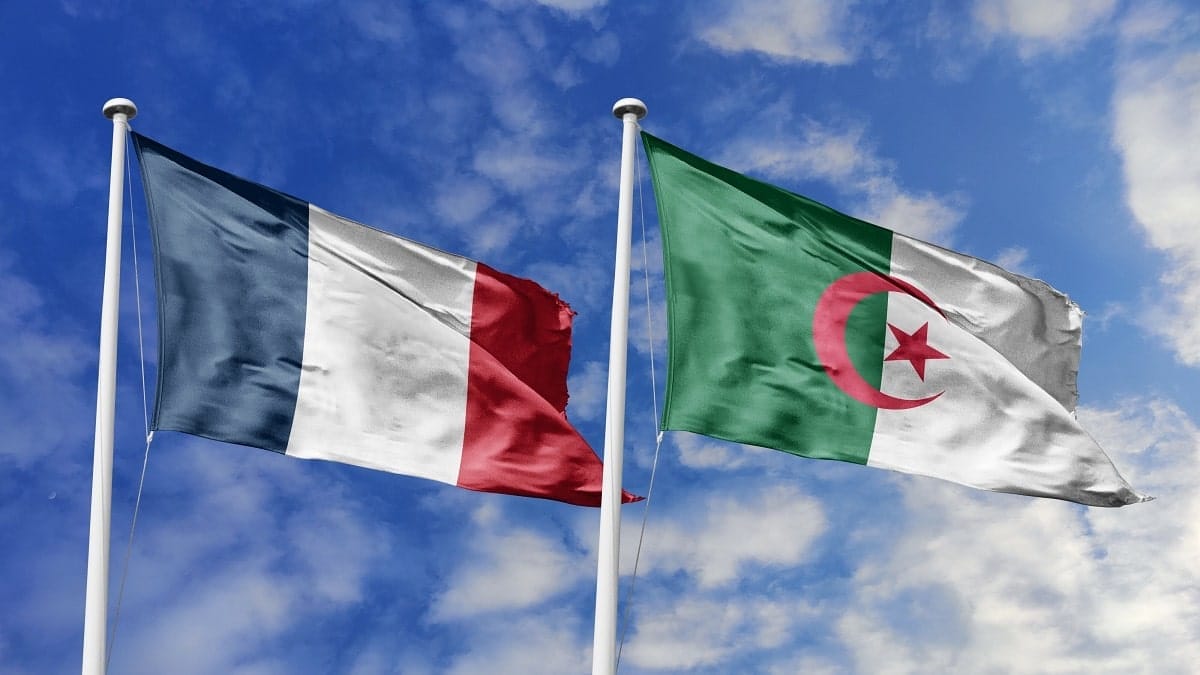Quand Russes et Américains votent à l’unisson
Ce 24 février comptera probablement moins comme le troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine que comme le début de sa fin. On pourra y voir plus tard le coup d’envoi du compte à rebours menant à la fin d’un conflit sanglant, où les pertes humaines de part et d’autre ont été particulièrement […]

Ce 24 février comptera probablement moins comme le troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine que comme le début de sa fin. On pourra y voir plus tard le coup d’envoi du compte à rebours menant à la fin d’un conflit sanglant, où les pertes humaines de part et d’autre ont été particulièrement importantes. Pas de meilleure preuve à cela que le fait qu’Américains et Russes ont voté de la même façon et par deux fois dans l’enceinte des Nations unies : une première fois dans le cadre de l’Assemblée générale, contre la résolution avancée par l’Ukraine et les pays européens, laquelle condamnait la Russie, et une deuxième, au niveau du Conseil de sécurité, pour approuver une résolution américaine appelant à la paix dans les meilleurs délais, qui a ceci de particulier qu’elle ne fait pas obligation à la Russie de se retirer de l’Ukraine. Les représentants européens tout naturellement se sont abstenus lors de ce deuxième vote. Ceux d’entre eux qui auraient pu la faire rejeter, parce que membres permanents du Conseil de sécurité, la France et la Grande-Bretagne, n’ont pas recouru à leur droit de veto, ce qu’ils auraient dû faire, au regard de leur premier vote dans le cadre de l’Assemblée générale.
Si Russes et Américains approuvent par deux fois la même résolution, et que les Américains par deux fois font faux bond à leurs alliés européens, c’est que la messe est dite, que les grandes décisions sont prises, et qu’il ne reste plus qu’à les mettre en œuvre. Ce même jour de 24 février, le président américain, en présence de son homologue français, s’est montré très confiant dans la conclusion de l’accord sur les minéraux avec les Ukrainiens, si bien qu’on pouvait croire que l’affaire était déjà en poche. Ce qui toutefois n’a pas manqué d’étonner, eu égard à la condition réitérée quelques heures plus tôt par le président ukrainien qui lie tout accord en la matière à des garanties de sécurité offertes par les Etats-Unis. Pour Volodymyr Zelensky garanties de sécurité veut
d’abord dire présence de troupes humaines sur le sol ukrainien une fois la paix restaurée, une exigence dont on sait maintenant qu’elle ne sera pas satisfaite par les Américains, qui cependant ne sont pas contre le déploiement d’une force européenne de maintien de la paix. Ce qui en l’occurrence motive Donald Trump, ce n’est pas seulement l’appât du gain, un ressort naturel chez un homme d’affaires, américain qui plus est, mais tout autant le désir de se faire décerner le prix Nobel de la paix, une récompense accordée à un de ses prédécesseurs, Barack Obama, dont on se demande encore si dans son cas elle était justifiée. Mais quelqu’un qui avant d’être élu s’engage à mettre fin à une guerre dès son accession au pouvoir, qui une fois redevenu président s’attelle effectivement à réaliser sa promesse, qui plus que lui a droit au prix Nobel de la paix, quelques doutes qu’on puisse avoir par ailleurs sur ses véritables motifs ? Ce même jour de 24 février, le président russe, s’entretenant avec un journaliste, reconnaissait que Trump agissait bien comme il avait dit qu’il ferait, que cela était la marque d’un leader, et même d’un grand leader. Trump disait déjà lors de la campagne, alors même qu’il était poursuivi dans plusieurs affaires, dont certaines au pénal, qu’il ferait la paix en 24 heures une fois réélu. Un peu plus d’un mois de son investiture, il semble bien qu’il soit en train de réussir.