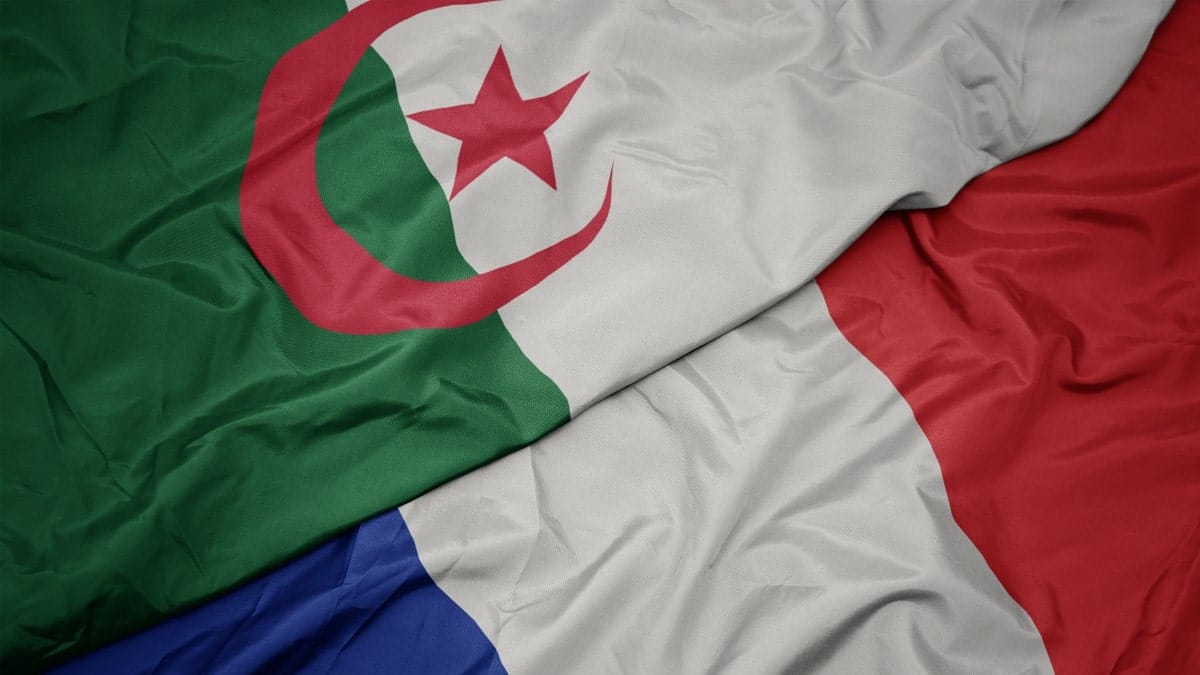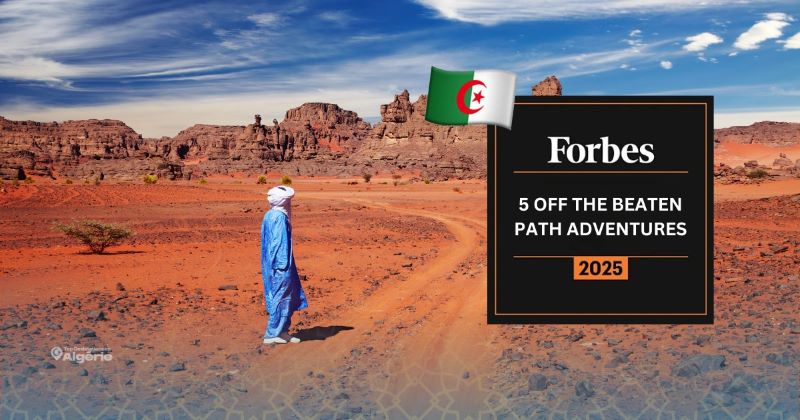Quand un néocolonialisme remplace un autre: Quand Washington veut dame le pion à Paris en Afrique de l’Ouest
Sommes-nous à la veille d’une redéfinition de l’ordre néocoloniale en Afrique dans un format soft? Tout porte à le croire. Après la déroute de la France , l’ancienne puissance européenne en Afrique de l’Ouest, il semblerait que les Etats-Unis entendent bien la remplacer et surtout combler le vide laissé par le départ des troupes françaises […] The post Quand un néocolonialisme remplace un autre: Quand Washington veut dame le pion à Paris en Afrique de l’Ouest appeared first on Le Jeune Indépendant.

Sommes-nous à la veille d’une redéfinition de l’ordre néocoloniale en Afrique dans un format soft? Tout porte à le croire. Après la déroute de la France , l’ancienne puissance européenne en Afrique de l’Ouest, il semblerait que les Etats-Unis entendent bien la remplacer et surtout combler le vide laissé par le départ des troupes françaises du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal et Côte d’Ivoire) ainsi que de l’Afrique centrale (Tchad). Patiemment, Washington tisse sa toile afin d’avoir la mainmise sur la région. Par la persuasion, la pression ou l’intimidation.
Ainsi, la Côte d’Ivoire est en train de devenir une plaque tournante régionale pour les investissements américains avec le reflux de l’influence française. Alors que les relations de la Côte d’Ivoire avec l’ancienne puissance coloniale ont continué de se détériorer, culminant avec la décision de janvier 2025 d’expulser les 600 soldats français présents dans le pays, les États-Unis sont de plus en plus intervenus. Déjà, l’ancien secrétaire d’Etat, Antony Blinken a débuté l’année 2024 avec la première visite d’un chef de la diplomatie américaine en 12 ans.
La Côte d’Ivoire, tête de pont de l’influence américaine
La rencontre avec le président Alassane Ouattara a permis l’approfondissant les liens diplomatiques, commerciaux et militaires entre les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire. Une série d’investissements économiques et commerciaux ont suivi, notamment l’ouverture du premier bureau du service commercial américain en Afrique de l’Ouest francophone au cours de l’été et la signature d’un partenariat d’investissement commercial bilatéral
L’approbation d’un pacte régional sur l’énergie de 300 millions de dollars avec la Millennium Challenge Corporation pour stimuler la participation ivoirienne au marché énergétique ouest-africain est venue ensuite, puis l’ouverture, le 12 décembre 2024, d’un bureau régional de la Société américaine de financement du développement international (DFC) à Abidjan.
L’intérêt des États-Unis pour le pays a réellement décollé après la fin de la guerre civile en 2011, mais surtout après l’adoption du Global Fragility Act en 2019, explique l’ambassadeur américain Davis Ba. Cette loi historique a réservé des fonds pour s’attaquer aux causes profondes des conflits dans certains pays, dont 300 millions de dollars pour les régions côtières d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée et Togo).
Signe de l’inféodation quasi-totale de la Côte d’Ivoire à l’aire d’influence américaine, la déclaration de Washington le 15 mai dernier qui stipule des pourparlers avec plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, pour accepter d’accueillir les migrants expulsés par Washington.
Quand Paris perd pied
Comme le note le magazine en ligne Modern Diplomacy, la France a perdu son emprise en Afrique ces dernières années ; cela menace de mettre fin à ses 60 ans d’influence dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest. Les observateurs s’attendaient avec certitude que les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger expulsent les troupes françaises en raison de leurs relations turbulentes avec la France depuis leur arrivée au pouvoir. Cependant, il était moins probable que le Tchad, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, qualifiés par les observateurs de la scène africaine de « chiens de garde franco-africain », se retirent des troupes françaises.

La France chassée de l’Afrique, les USA en embuscade
Pendant plus de 60 ans, la France a dominé la plupart de ses anciennes colonies d’Afrique subsaharienne grâce à la politique de la Françafrique et surtout par le Franc CFA. Cette politique a assuré la domination de l’influence de la France en Afrique par le biais de la politique et du leadership, du commerce, de la finance, de l’armée, de l’économie et des réseaux liants les élites françaises à celles d’Afrique de l’Ouest.
Le 1er janvier 2025, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé le retrait des troupes françaises de son pays. La Côte d’Ivoire est devenue récemment le sixième pays africain à expulser les soldats français, suivant les traces du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Sénégal. Selon le président Ouattara, la décision de « transfert » avait été prise après s’être assuré que les forces armées ivoiriennes modernisées seraient en mesure de gérer les précédentes opérations françaises dans le pays.
Quid du Franc CFA ?
En 1945, la France a créé le franc CFA, qui a été rattaché au franc français, puis à l’euro. La monnaie est utilisée dans 14 pays africains, dont 6 États membres d’Afrique centrale relevant de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et 8 États membres d’Afrique de l’Ouest relevant de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). En vertu de l’« accord », les pays africains étaient tenus de déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français sur le « compte d’exploitation » spécial et 20 % de leurs engagements financiers ; ainsi, les pays ne devaient conserver que 30 % de leurs réserves de change. Cet ancrage au franc français et à l’euro, le franc CFA, a été mentionné comme une monnaie stable avec un taux d’inflation plus faible.
Pour contrôler le franc CFA, les Français nomment leur agent, qui a le droit de veto, directement au conseil d’administration de la Banque centrale de la BEAC ou de la BCEACO pour « assurer » la convertibilité de la monnaie commune
Non réciproque, la BCEACO n’a aucun droit de veto, aucune position stratégique financière, ni aucune autre influence au sein de la Banque de France. La sauvegarde de son PIB de 99 095,3 milliards de francs CFA est garantie par des politiques monétaires appropriées pour assurer la prospérité économique. Cela montre comment la France manipule la souveraineté monétaire des États membres de la zone CFA et entrave la croissance économique dans des secteurs d’investissement tels que l’agriculture, l’industrie, les infrastructures et le tourisme.
Les États membres de la BCEACO ou de la BEAC doivent disposer d’un mandat complet dans les politiques monétaires au sein de la Banque de France afin de garantir aux investisseurs et aux parties prenantes qu’ils sont fiables dans leur économie.

BCEACO, une banque assujettie à la Banque de France
Cette dépendance crée une situation délicate pour les pays concurrents de la France en Afrique, tels que la Chine, la Russie et l’Inde, d’investir massivement dans ces pays en raison de la possibilité d’une « fixation » de l’économie du pays franc CFA qui pourrait être effectuée par la France. Le contrôle total du système monétaire étant à Paris, la réglementation du franc CFA pourrait également être utilisée comme une « fixation politique et économique » de tout gouvernement africain anti-français.
Malgré l’arrimage du franc CFA au franc français et à l’euro, garantissant ainsi de nombreux marchés d’exportation fiables, les États membres africains sont classés au plus bas de l’indice de complexité économique. Ceci est le résultat de l’incapacité des États à produire des produits divers et complexes. Par exemple, en termes d’échanges commerciaux, la France commerce au maximum avec les États africains non francs CFA par rapport aux pays africains francs CFA. Les principaux partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigéria, l’Angola, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tanzanie, l’Algérie et la Tunisie, tandis que les membres francs CFA contribuent à moins de 1 % du marché français
« Aucun d’entre eux ne serait un pays souverain aujourd’hui si l’armée française ne s’était pas déployée dans la région », n’a pu que déclarer le président français Emmanuel Macron. Un cuisant constat d’échec que masque très mal cette pique très peu diplomatique du locataire de l’Elysée.
L’uranium nigérien
Soudain, les gouvernements pro-français qui prônaient les opérations militaires françaises au Sahel et en Afrique de l’Ouest ont été renversés militairement, à commencer par le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée. Même les sondages électoraux ont rejeté le président sénégalais sortant Macky Sall, un sympathisant bien connu de la France, lors des élections sénégalaises de 2024. Le PASTEF, un parti anti-français dirigé par Ousmane Sonko, a remporté les élections de mars 2024 avec 54 % des voix, et Bassirou Diomaye Faye est devenu président du Sénégal plus tard en novembre 2024. Le parti a remporté une autre large majorité aux élections législatives.

L’Uranium, un enjeu au Sahel
En juin 2024, le gouvernement nigérien a révoqué la licence de l’entreprise nucléaire publique française Orano pour extraire du métal utilisé pour l’énergie nucléaire et les armes de la mine d’Imouraren, dans le nord du Niger. Plus tard, en décembre 2024, la société Orano a publié une déclaration affirmant que le Niger avait nationalisé la mine d’uranium de Somair, dont la société détenait 63 % des actions.
Pendant plus de quatre décennies, la France a été fortement dépendante de l’uranium nigérien pour ses centrales nucléaires. Le Niger est le deuxième exportateur d’uranium vers la France, car il contribue à 20 % des 88 000 tonnes d’uranium importées en France. 70 % de l’électricité française est produite à partir de l’énergie nucléaire.
Suite aux expulsions du Mali, du Niger et du Burkina Faso, les troupes françaises restent désormais uniquement à Djibouti et au Gabon, deux pays qui n’ont pas encore manifesté leur intention de modifier leur position sur la coopération militaire avec Paris.
Cependant, la tendance générale est à un éloignement régional de la France, et alors que Paris réévalue son empreinte militaire en Afrique, les analystes débattent de l’avenir de sa coopération en matière de sécurité sur le continent et de sa capacité à sauver son influence déclinante.
Les griefs historiques
Jean-Hervé Jezequel, directeur du projet Sahel à l’International Crisis Group, considère ces développements comme un tournant historique. Il a expliqué que ce n’est pas le premier cas de retrait de troupes françaises de pays africains, rappelant des événements similaires dans les années 1960, lorsque les anciennes colonies françaises ont obtenu leur indépendance. « Au cours des décennies suivantes, cependant, la France a réussi à redévelopper un accord militaire pour redéployer des troupes », a-t-il déclaré
Ovigwe Eguegu, analyste politique, a souligné que l’engagement militaire de la France en Afrique subsaharienne remonte à 1850, lorsqu’elle a occupé pour la première fois les régions côtières du Sénégal. Jusqu’à récemment, son empreinte n’avait fait que s’étendre, a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, les pays de la région ordonnent aux troupes françaises de partir et le ‘sentiment anti-français’ est l’expression générique citée comme raison. Mais c’est une simplification excessive », a-t-il déclaré.
Il a expliqué que si les griefs historiques découlant de la domination coloniale et de l’exploitation économique françaises jouent un rôle dans ce sentiment, « les dynamiques sécuritaires, politiques et géopolitiques temporaires sont à l’origine du changement d’attitude en matière de politique étrangère dans la région ».
Ovigwe Eguegu a souligné que malgré les initiatives de sécurité de premier plan telles que le G5 Sahel et l’opération Barkhane depuis 2013, « très peu de succès ont été obtenus, la situation ne faisant qu’empirer dans des pays comme le Burkina Faso ».
Il a également noté un mouvement nationaliste croissant en Afrique de l’Ouest, citant la justification du Tchad pour l’expulsion des troupes françaises. « Par exemple, la raison invoquée par N’Djamena pour ordonner le retrait des troupes françaises était que le Tchad avait « mûri dans sa souveraineté », a-t-il déclaré.
La pression populaire
Jean-Hervé Jezequel a fait écho à ce point de vue, affirmant que de nombreux gouvernements africains ne considèrent plus les interventions militaires françaises comme efficaces. « Il est particulièrement clair qu’au Sahel central, selon eux, la stratégie française contre les insurgés ne fonctionnait pas et que l’idée était de changer les alliances militaires », a-t-il déclaré. « Il y a cette idée que la manière française de mener les guerres n’est en fait pas efficace et, plus précisément, qu’elle n’aide pas vraiment les armées nationales à renforcer leurs capacités », a ajouté Jean-Hervé Jezequel.
Cependant, il a souligné que le retrait des troupes françaises n’est pas uniquement une initiative gouvernementale, mais aussi une réponse directe à la pression publique, car l’appel au retrait des troupes a été une demande majeure des citoyens de diverses nations. Dans les pays où l’expulsion des troupes françaises a eu lieu, « les gens étaient favorables au retrait », a-t-il déclaré.
L’avenir de la coopération sécuritaire de la France avec les pays africains reste incertain. Jezequel estime qu’à court terme, il ne peut y avoir de collaboration avec les États du Sahel central – Mali, Burkina Faso et Niger. Alors que d’autres pays, comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Tchad, ont indiqué maintenir leurs liens en matière de sécurité, Jezequel a suggéré que ces partenariats pourraient se concentrer sur la « formation des capacités » plutôt que sur une implication militaire directe.
Paul Melly, consultant au programme Afrique de Chatham House, estime également que « la formation et les partenariats techniques semblent être la voie la plus efficace ».
Sur le plan diplomatique, la situation de la France n’a pas été aidée par des incidents tels que les propos largement critiqués du président Emmanuel Macron en janvier, où il a déclaré que les pays africains avaient « oublié de dire merci » pour les efforts anti-insurrectionnels de la France au Sahel.
Jean-Hervé Jezequel a qualifié cette déclaration de désastre, affirmant qu’elle n’avait fait qu’attiser l’indignation du public contre la France et forcé les diplomates français à limiter les dégâts. Paul Melly a souligné, quant à lui, que ces remarques étaient « largement perçues comme non seulement stupides mais aussi carrément arrogantes » et avaient provoqué « choc et offense ».
The post Quand un néocolonialisme remplace un autre: Quand Washington veut dame le pion à Paris en Afrique de l’Ouest appeared first on Le Jeune Indépendant.