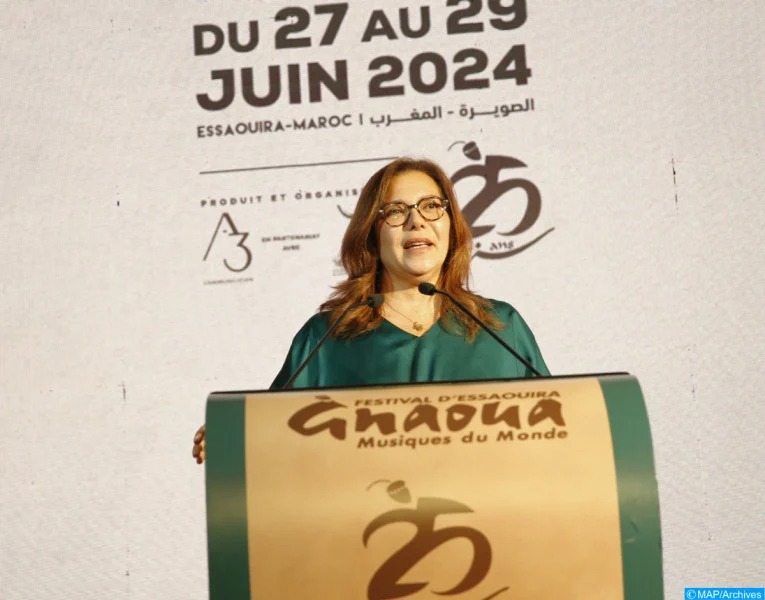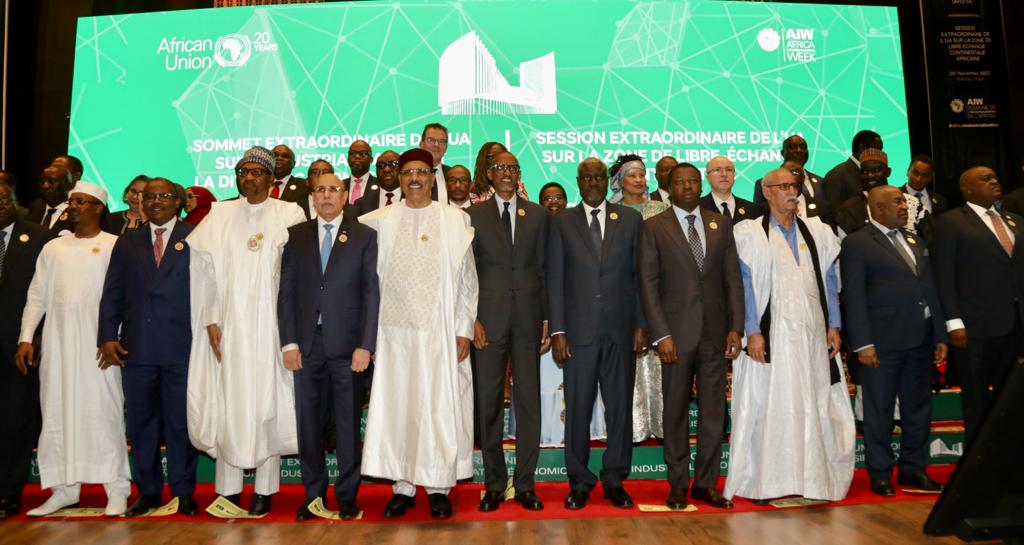Connaissons-nous vraiment notre propre histoire et l’enseignons-nous ?
Une contribution de Mouanis Bekari – Il est étonnant que l’affirmation de Boualem Sansal sur une prétendue marocanité historique de l’Ouest... L’article Connaissons-nous vraiment notre propre histoire et l’enseignons-nous ? est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Une contribution de Mouanis Bekari – Il est étonnant que l’affirmation de Boualem Sansal sur une prétendue marocanité historique de l’Ouest algérien ait suscité si peu de réactions parmi les historiens algériens, alors même que l’histoire antique des frontières nord-africaines est l’une des mieux documentées du monde méditerranéen.
Une frontière enracinée dans l’Antiquité
Au centre de cette géographie historique se trouve la Moulouya (appelée Malva dans les textes anciens), fleuve sinueux de près de 600 km. Dès le IIIe siècle avant notre ère, elle marque une frontière nette et durable. A l’est, le royaume massaesyle de Syphax, qui annexe, en -206 de l’ère moderne, le royaume massyle, unifiant ainsi la Numidie – ancêtre territorial de l’Algérie. A l’ouest, le royaume maure de Bocchus, matrice territoriale du Maroc.
Cette frontière naturelle demeure stable sous Massinissa, après sa victoire à Zama (-202 de l’ère moderne). Aucun texte antique ne signale de contestation de la Moulouya comme limite occidentale de la Numidie. Ce n’est qu’en -104 de l’ère moderne que Rome autorise Bocchus Ier à empiéter temporairement vers l’est, en rétribution de sa trahison et pour lui avoir livré Jugurtha. Une faveur de courte durée : en 42 de l’ère moderne, Rome annexe les deux royaumes, instaurant une frontière administrative officielle, la Moulouya, entre la Maurétanie césarienne (Cherchell) et la Maurétanie tingitane (Tanger). Cette division, calquée sur les réalités antiques, perdure près de cinq siècles.
Continuité historique
Avec l’islamisation, la Moulouya conserve son rôle structurant. Idrissides, Almoravides, Almohades, Zianides ou Mérinides, tous maintiennent cette ligne comme seuil d’influence entre Fès et Tlemcen. Ce découpage hérite directement des logiques antiques et romaines, soulignant la cohérence géopolitique de la région.
L’épisode de 1692 : la bataille de la Moulouya
En mai 1692, le dey d’Alger, Hadj Chaaban, affronte sur la Moulouya les troupes de Moulay Ismaïl, désireux d’étendre son territoire à l’est. Malgré l’infériorité numérique (13 000 Algériens contre 19 000 Marocains), la bataille tourne à l’avantage d’Alger : 5 000 Marocains tués contre une centaine de pertes algériennes, selon Léon Galibert (1). La suite – la reddition de Fès et les mots de Moulay Ismaïl («Tu es le couteau et moi la chair») – actent symboliquement la reconnaissance de la frontière.
La rupture ottomane et l’impéritie coloniale
Ce n’est qu’avec le déclin ottoman que la frontière est remise en question. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Alger repousse les visées marocaines sur Oujda. En 1795, affaiblie, elle cède : le Maroc s’y installe, déplaçant la frontière vers l’Oued Kiss. Une rupture tardive d’avec une tradition vieille de deux millénaires.
Paradoxalement, la colonisation française aurait pu corriger cela. En se proclamant héritière des Ottomans, la France, via l’article 5 de la convention de Tanger (1844), évoque un maintien des frontières anciennes. Mais la convention de Lalla Marnia (1845) entérine au contraire les gains marocains. Mas Latrie (2) y voit l’effet combiné de l’incompétence française et de la duplicité marocaine.
Une mémoire géopolitique prégnante
A l’indépendance, l’intangibilité des frontières coloniales consacre cette distorsion historique. Pourtant, comme le souligne Mas Latrie, «un fait qui persiste depuis vingt siècles constitue un droit respectable, que ne sauraient effacer quelques usurpations récentes». (3)
La Moulouya, pendant plus de deux mille ans, a séparé des entités politiques distinctes au Maghreb. Cette mémoire géographique n’a pas disparu : elle éclaire encore le contentieux frontalier qui a perduré jusqu’au Traité d’Ifrane en 1972.
Dans ce contexte, les affirmations de Sansal apparaissent moins comme une opinion que comme une falsification historique. Leur retentissement, plus encore que leur contenu, interroge cependant : connaissons-nous vraiment notre propre histoire ? Et surtout, l’enseignons-nous ?
M. B.
1) Léon Galibert : L’Algérie : ancienne et moderne depuis les premiers établissements des Carthaginois jusqu’à la prise de la Smalah d’Abd-el-Kader, Paris, Furne et cie, 1844.
2) André de Mas Latrie : «A propos du Maroc et de la frontière algéro-marocaine», conférence Castres, 13 février 1909. BNF.
3) Id.
L’article Connaissons-nous vraiment notre propre histoire et l’enseignons-nous ? est apparu en premier sur Algérie Patriotique.