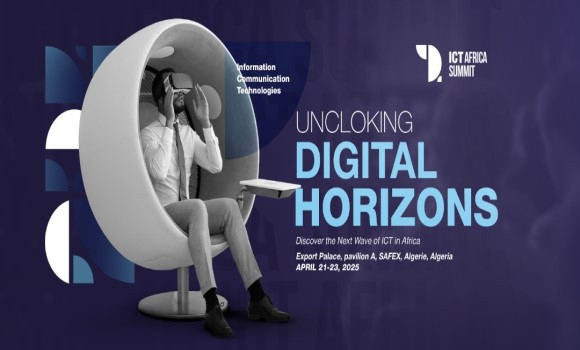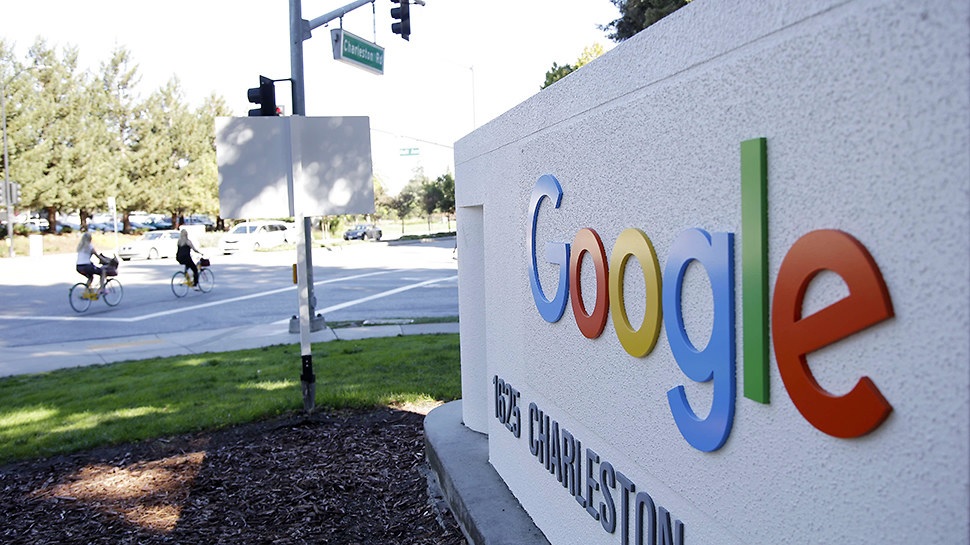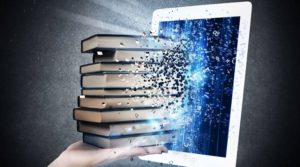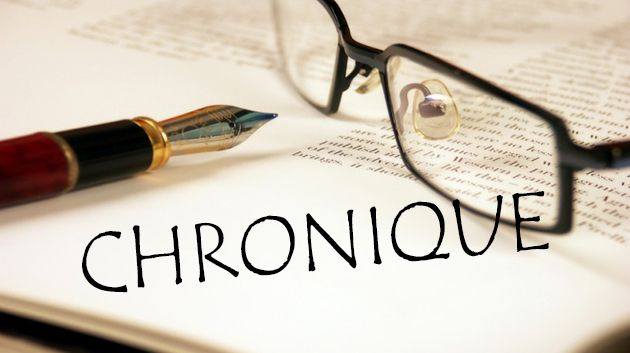Macron voit dans la Russie une menace existentielle
Tant que les Etats-Unis étaient gouvernés par l’administration Biden, la France, de même que l’ensemble des alliés de l’Ukraine, était d’avis qu’il fallait absolument que la Russie perde une guerre que de leur point de vue unanime elle-même avait provoquée. Infliger à la Russie une défaite stratégique était, jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle administration américaine, le […]

Tant que les Etats-Unis étaient gouvernés par l’administration Biden, la France, de même que l’ensemble des alliés de l’Ukraine, était d’avis qu’il fallait absolument que la Russie perde une guerre que de leur point de vue unanime elle-même avait provoquée. Infliger à la Russie une défaite stratégique était, jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle administration américaine, le mot d’ordre dans lequel communiaient tous les pays qui s’étaient résolument placés aux côtés de l’Ukraine. Les Américains ont été les premiers à se servir de cette expression de défaite stratégique. Pourquoi défaite stratégique, et pas en l’occurrence défaite militaire, ou même défaite tout court ? La différence est importante. D’une défaite militaire, on peut s’en remettre, en guérir au bout d’un certain temps, en rejaillir peut-être plus vivant encore. On peut la faire suivre d’une victoire, même d’une qui serait éclatante. D’une défaite stratégique, non. Si la Russie avait déjà connu une défaite de cette nature, elle aurait cessé d’être ce qu’elle est encore aujourd’hui, une superpuissance redoutable, à laquelle personne n’a vraiment envie de se frotter. N’empêche, déjà du temps de l’administration Biden, la France se distinguait de ses alliés, américains et européens, en n’excluant pas un engagement direct dans le conflit, l’envoi de troupes pour se battre aux côtés des forces ukrainiennes, dans l’hypothèse où celles-ci perdraient pied.
Le tollé suscité par ses propos, notamment en Europe occidentale – car à l’est du continent, ceux-ci ont été au contraire plutôt bien reçus, – Emmanuel Macron a continué à envisager cette possibilité. Mais aujourd’hui qu’il y a une nouvelle administration américaine, et qu’en la matière une politique toute différente est en train de prendre forme, le président français, loin d’édulcorer son propos, va plus loin encore dans son hostilité à la Russie, finissant par la qualifier de menace existentielle pour l’Europe. La différence entre menace existentielle et menace tout court, c’est que celle-ci est inexpiable mais pas celle-là. Une menace est existentielle dans la mesure où c’est votre existence même qu’elle met en danger. De ce fait, il n’y a pas moyen de composer avec elle, pas moyen de coexister avec l’agent qui l’incarne. Où vous vous empressez de le détruire, où c’est lui qui finira par vous détruire. Macron a attendu que les représentants de l’administration Trump disent que le danger n’est pas extérieur, qu’il n’est pas russe, ni même chinois, mais intérieur, c’est-à-dire européen, pour prendre leur contrepied en qualifiant la Russie de menace existentielle. S’il avait jusque-là une chance d’avoir son mot à dire dans les négociations pour la paix, il vient de la gâcher. Car cette déclaration sera retenue contre lui autant par les Russes que par les Américains, dont elle dénonce en filigrane l’aveuglement, sinon la complaisance coupable à l’égard des premiers. Le même homme qui tient à se mettre à dos et l’ennemi et l’allié reconnaît pourtant que pour l’heure les Européens ne sont pas près de faire face seuls à la Russie, ni en Ukraine ni possiblement ailleurs en Europe. Il avait été désapprouvé quand il prophétisait une intervention directe dans le conflit, il ne sera pas non plus suivi dans sa nouvelle caractérisation de la Russie.