Dans «The Brutalist» avec Adrian Brody: L’architecture comme allégorie de la violence du monde
Dans la course aux Oscars face aux autres mastodontes de l’année, dont «Emilia Pérez» et «Wicked», l’épopée américaine de Brady Corbet «The Brutalist» arrive dans les salles françaises avec la promesse de nous convaincre de cette comparaison ambitieuse. Son histoire retrace, sur plus d’une trentaine d’années, celle d’un certain László Toth. Rescapé des camps de […]

Dans la course aux Oscars face aux autres mastodontes de l’année, dont «Emilia Pérez» et «Wicked», l’épopée américaine de Brady Corbet «The Brutalist» arrive dans les salles françaises avec la promesse de nous convaincre de cette comparaison ambitieuse.
Son histoire retrace, sur plus d’une trentaine d’années, celle d’un certain László Toth. Rescapé des camps de concentration, l’architecte originaire de Hongrie joué par Adrien Brody vient de débarquer aux États-Unis dans l’État de Pennsylvanie, où il a retrouvé un vieux cousin, dans l’attente que sa femme (Felicity Jones) et sa nièce – toujours en Europe – ne le rejoignent.
Figure avant-garde et respectée dans son domaine sur le vieux continent, László Toth est un inconnu en Amérique. Du moins, jusqu’au jour où un richissime industriel du nom d’Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) met la main sur lui. Le puissant magnat, reconverti dans la vente d’armes pendant la guerre, fait de lui son protégé, et lui confie les commandes d’un projet hors normes. Celui d’un centre culturel et communautaire démesuré, composé entre autres d’un gymnase, un théâtre, une bibliothèque et une chapelle. Les dangers d’un tel projet sur sa santé physique et mentale sont grands, mais László Toth, qui y voit l’entreprise d’une vie, accepte. C’était sans se douter du prix d’un tel pacte sur ce territoire, dont il n’est qu’un étranger.
Divisé en deux parties, elles-mêmes séparées d’un entracte de quinze minutes (nécessaires pour affronter la dureté du deuxième volet), «The Brutalist» est un film saisissant revisitant les vices du mythe du rêve américain. Malgré plusieurs ressorts dramatiques qui viennent alourdir un récit déjà bien assez sombre, il ne ressemble à aucun autre.
Comme celles de la Statue de la Liberté en contre-plongée, les incroyables images du film tournées en 70 mm jouent pour beaucoup. Celles des gratte-ciel new-yorkais, du crépuscule sur la colline, du mouvement des placards de la bibliothèque ou des rayons du soleil qui forment une croix dans l’édifice sacré, aussi. Une scène tournée à Carrare, en Italie, nous a laissés sans voix. Notre héros, László Toth, a pris l’avion depuis les États-Unis pour rejoindre son patron dans cette petite ville toscane, entourée de massifs montagneux connus mondialement pour leurs carrières de marbre exploitées depuis l’époque romaine. Harrison Lee Van Buren veut en extraire une partie pour décorer l’autel de son mémorial.
Dans un café au pied des montagnes, depuis la vue aérienne ou en plein milieu des roches dans la brume, «The Brutalist» nous offre une plongée étourdissante dans ce lieu naturel, mais non moins critique de sa surexploitation. «Carrare est révélateur des conséquences délétères du capitalisme sur la planète», déplore Brady Corbet dans les notes de production.
Depuis le développement du christianisme, l’activité d’extraction du marbre a subi une grosse demande pour l’aménagement interne des lieux religieux, puis pour la construction de sculptures. Si pendant de longs siècles on s’en procurait de façon «artisanale» par le biais de fissures naturelles le long de la roche, une technique d’extraction à la dynamite a accéléré le démantèlement des carrières à l’époque moderne.
Zola D.











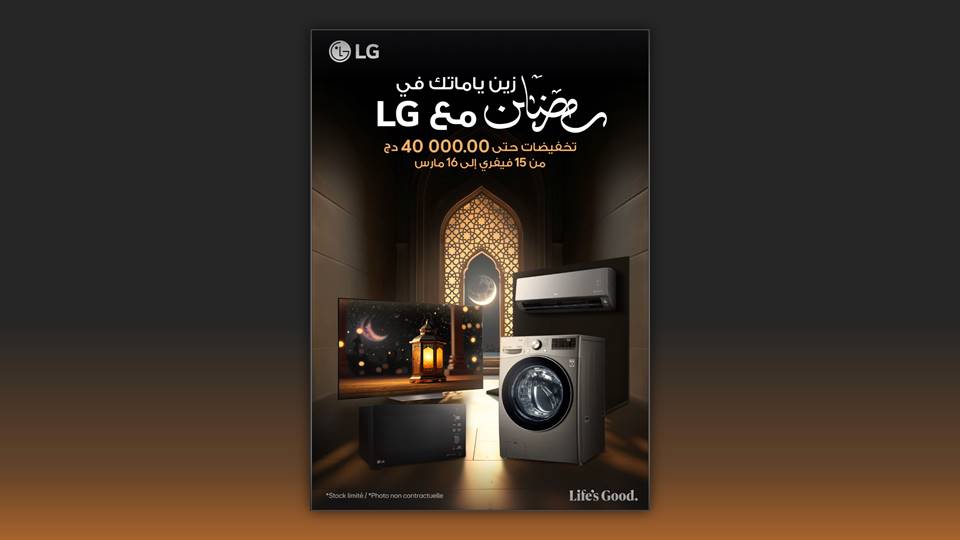



























































![[ Vidéo] Ali Aoun « ont été fixés à 18 mois »](https://djaz.news/uploads/images/202412/image_430x256_6759abcdf1951.jpg)
![[Reportage photos] Merck et LDM ,transfert de technologie.](https://djaz.news/uploads/images/202412/image_430x256_6759abcd329f4.jpg)




















































