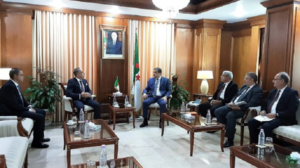France : pourquoi l’Algérie est «oubliée» dans la «lutte» contre l’islamisme
Par Idir Abedrabbou – Dans l’émission «Face à Philippe de Villiers» du 23 mai dernier sur CNews, l’ancien député souverainiste... L’article France : pourquoi l’Algérie est «oubliée» dans la «lutte» contre l’islamisme est apparu en premier sur Algérie Patriotique.

Par Idir Abedrabbou – Dans l’émission «Face à Philippe de Villiers» du 23 mai dernier sur CNews, l’ancien député souverainiste livre une charge virulente contre le projet politique des Frères musulmans, qu’il accuse de menacer l’identité française par un prosélytisme insidieux. Fidèle à son style, De Villiers dénonce une «soumission» des élites à l’islamisme, pointant du doigt une «République des juges» qui, selon lui, recycle les outils de la loi de 1905 – conçue pour limiter l’influence catholique – pour affaiblir un «islam fédérateur» capable de promouvoir le vivre-ensemble. Pourtant, dans ce réquisitoire, un acteur majeur brille par son absence : l’Algérie, un pays dont l’expérience unique dans la lutte contre l’islamisme politique et le terrorisme pourrait être un atout stratégique pour la France. Cet oubli, conjugué à la fermeté de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et président des Républicains (LR), envers Alger, soulève une question cruciale : à qui profite de la distance franco-algérienne ? Et, surtout, qui tient la «boussole» de Retailleau, dont le mentor, De Villiers, partage pourtant des convergences idéologiques avec l’Algérie contre l’islamisme ? De ces paradoxes, quelles sont les influences occultes qui brouillent la vision de l’opinion publique française par le «déboussolement» de Retailleau ?
Philippe de Villiers et les Frères musulmans
Dans l’émission du 23 mai 2025, Philippe de Villiers s’attaque avec véhémence au projet des Frères musulmans, qu’il décrit comme une «guerre de basse intensité» visant à imposer une société «charia-compatible». Reprenant ses thèses développées dans Mémoricide (2024), il fustige le «frérisme» comme une menace culturelle et politique, ciblant l’école comme terrain de prosélytisme. Son diagnostic, partagé par des figures conservatrices comme Eric Zemmour, repose sur une lecture alarmiste : les Frères musulmans infiltreraient les institutions françaises, profitant d’une «double censure» islamiste et woke. Cette analyse, bien que controversée, s’appuie sur des faits documentés, comme les réseaux d’influence de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), proche des Frères, ou les débats sur le voile à l’école depuis Creil (1989).
Cependant, De Villiers omet un allié potentiel de taille : l’Algérie. Ce pays, confronté dès les années 1990 à une tragédie sanglante contre le Front islamique du salut (FIS) et ses ramifications terroristes (GIA, GSPC), dispose d’une expertise opérationnelle inégalée dans la lutte contre l’islamisme. Sur le plan politique, Alger a dissous le FIS en 1992, marginalisant les mouvements fréristes. Socialement, des campagnes de déradicalisation et une promotion de l’islam malékite traditionnel ont limité l’influence des idéologies importées. Sécuritairement, l’Armée nationale populaire (ANP) a démantelé des réseaux terroristes, réduisant la menace du GIA et d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) en Algérie et dans le monde. Cette expérience, saluée par des experts hors des plateaux des grands médias, fait de l’Algérie un modèle de résilience face à l’islamisme politique, un fléau que De Villiers qualifie de «mal du siècle» (CNews, 23 mai 2025). En ignorant cet atout, De Villiers prive son discours d’une perspective stratégique, préférant une rhétorique nationaliste centrée sur la France seule.
L’Algérie : un rempart méconnu contre l’islamisme
L’Algérie n’est pas seulement un voisin géopolitique ; elle est un acteur-clé dans la lutte contre l’islamisme, un domaine où ses intérêts convergent avec ceux de la France. Depuis la «décennie noire» (1991-2002), qui a coûté environ 50 000 vies, Alger a développé une approche multidimensionnelle : 1) Politique, avec l’interdiction – renforcée par la Constitution de 1996 – de l’argument religieux comme base politique et des partis islamistes comme le FIS. 2) Sociale, à travers la promotion d’un islam modéré via des institutions comme le ministère des Affaires religieuses, qui veille à la conformité canonique des prêches et forme les imams. 3) Sécuritaire, avec des opérations antiterroristes continues ayant permis de neutraliser plus de 1 500 membres d’Al-Qaïda entre 2008 et 2020 en Algérie et dans le monde, selon le ministère de la Défense algérien.
Cette expertise est pertinente pour la France, confrontée à des défis similaires (attentats de 2015, radicalisation dans les banlieues). Pourtant, De Villiers, dans son émission, ne mentionne jamais l’Algérie comme partenaire potentiel, se concentrant sur des critiques internes (Europe1.fr). Cette omission est d’autant plus surprenante que l’Algérie combat activement des mouvements comme Rachad, une organisation islamiste exilée, classée comme terroriste et accusée par Alger de relayer l’idéologie des Frères musulmans. Des figures comme Mourad Dhina, ancien cadre du FIS, et Amir DZ, disciple de Larbi Zitout (leader de Rachad basé à Londres), sont dans le viseur des autorités algériennes, mais protégées par des décisions judiciaires en Europe, notamment en France.
La «République des juges» au service des islamistes
Un argument central de De Villiers dans l’émission du 23 mai 2025 attire l’attention : les outils utilisés en 1905 pour limiter l’influence du christianisme, notamment la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, seraient aujourd’hui utilisés pour favoriser la prolifération des idées fréristes. Il évoque une «République des juges» qui, par des décisions judiciaires, freine les efforts contre l’islamisme tout en affaiblissant les valeurs unificatrices de l’islam modéré. Cet argument, provocateur, trouve un écho dans le contexte franco-algérien, où la mosquée de Paris est en ligne de mire, prise sous les feux des disciples de De Villiers parce que proche d’Alger. Pire, elle risque d’être trompeusement ciblée dans le contexte du rapport «Frères musulmans et islamisme politique» pour forcer un changement de gouvernance qui, jusque-là prônant un «islam fédérateur» inspiré du ministère des Affaires religieuses algérien – favorisant le vivre-ensemble –, fera basculer inéluctablement cette organisation séculaire dans le giron du Rassemblement des musulmans de France (RMF), qui défend un islam malékite, aligné sur la doctrine officielle du Maroc et qui contrôle l’Union des mosquées de France (UMF) (nous y reviendrons).
En France, la loi de 1905 a servi à laïciser l’espace public, mais son application stricte (ex. : interdiction du voile dans les écoles en 2004) est critiquée par certains comme une entrave à un islam compatible avec la République. En Algérie, la gestion de l’islam est plus dirigiste : l’Etat contrôle les mosquées et promeut un islam traditionaliste pour contrer les Frères musulmans. De Villiers, en dénonçant une justice française trop permissive, rejoint involontairement la position algérienne, qui reproche à Paris de protéger des islamistes comme Mourad Dhina. Arrêté en France en 2012, Dhina, ex-responsable du FIS (élu responsable par intérim du Bureau exécutif du FIS en octobre 2012), n’a pas été extradé vers l’Algérie, une décision perçue par Alger comme un soutien implicite à Rachad. De même, Amir DZ, influent sur les réseaux sociaux, bénéficie de la liberté d’expression en Europe, malgré ses liens avec Larbi Zitout, accusé par l’Algérie de coordonner les activités subversives de groupuscules qui, lovés derrière le mouvement Hirak, montrent à ce jour des liens concrets avec des organisations islamistes radicales connues, financées par la Turquie et le Qatar.
Pire, certains affidés-partisans de Rachad, comme Amir DZ et Chawki Benzahra, dissimulés derrière un écran et une naïve apparence de réfugiés, sont utilisés par la République des juges et les médias «en continu» pour cibler l’Algérie alors qu’ils n’ont jamais caché leur allégeance au mouvement frériste Rachad qui, comme le prouvent les centaines de photos et prises de parole publiques sur les espaces – physique et virtuel – que la République française leur offre aujourd’hui, en fait des vecteurs de propagande au sein de la population diasporique musulmane.
Ce parallèle suggère une convergence idéologique entre De Villiers et l’Algérie : tous deux critiquent une justice occidentale qui, sous couvert de droits humains, freine la lutte contre l’islamisme. Pourtant, De Villiers, focalisé sur une vision souverainiste, ne capitalise pas sur cette proximité, et son silence sur l’Algérie renforce à la fois l’isolement stratégique de la France et, par son action politique anti-algérienne du moment, l’idée d’incohérence de sa ligne directrice.
Dans ce chapitre, le cas de la Suisse est édifiant pour illustrer les dissonances de la politique française à l’aune du contexte actuel de la relation algéro-française. En effet, la Suisse, qui est pourtant citée comme modèle pour l’application des droits de l’Homme, a pris des mesures fermes et spécifiques contre ce mouvement et ses cadres dirigeants. Son Conseil fédéral a limité les activités politiques de Mourad Dhina en Suisse – à la suite de son élection à la tête du Bureau exécutif du FIS –, en décrétant que «le Conseil fédéral ne saurait tolérer que le conflit opposant le gouvernement algérien au Front islamique du salut (FIS) soit attisé par des figures de proue du FIS vivant en Suisse. Aussi, a-t-il décidé, mercredi (octobre 2012, ndlr) d’interdire au chef du Bureau exécutif du FIS, Mourad Dhina, de faire de la propagande depuis le territoire suisse et de justifier, prôner ou soutenir l’usage de la violence». Mieux encore, «il a également été défendu à Mourad Dhina de justifier, d’encourager ou de soutenir matériellement des actes relevant du terrorisme et de l’extrémisme violent qui visent essentiellement à troubler l’ordre en Algérie», ajoutant : «Pour éviter que cette interdiction ne puisse être contournée, Mourad Dhina a également l’interdiction de confier de telles activités à des tiers. S’il ne respecte pas la mesure prise à son encontre, il s’expose à une expulsion.» Envers Larbi Zitout, la Suisse a été encore plus radicale en lui refusant l’accueil.
Bruno Retailleau : un «déboussolement» stratégique ?
Bruno Retailleau, mentoré par De Villiers dans les années 1980-2000, partage avec lui une méfiance envers l’islamisme politique. En tant que ministre de l’Intérieur, il a proposé des mesures contre la «mouvance frériste» (Le Figaro) et adopté une ligne dure envers l’Algérie, sous prétexte de son refus de reprendre les ressortissants sous OQTF (Franceinfo). Pourtant, cette fermeté contraste avec l’absence de reconnaissance de l’expérience algérienne, un paradoxe que l’émission de De Villiers met en lumière.
En effet, l’émission «Face à Philippe de Villiers» du 23 mai 2025 révèle une paradoxale convergence entre le souverainisme de De Villiers et la fermeté algérienne contre l’islamisme, mais aussi une occasion manquée. En occultant l’Algérie, De Villiers prive la France d’un allié stratégique, tandis que Retailleau, influencé par son mentor, adopte une posture qui éloigne Paris d’Alger. Aussi, en laissant croire que Retailleau serait le «président martyre» dont la France a besoin (i.e. celui chargé de la salle besogne), le mentor habile qu’est De Villiers condamne son disciple dans le spectre d’une vision stratégique pour la France qui élude l’Algérie pour le rapprocher davantage de l’extrême droite où d’autres concurrents pullulent.
Et, dans cette arène stratégique, Retailleau est «déboussolé», à l’image de ce qu’inspire De Villiers en décrivant les dirigeants manipulés par des forces invisibles (CNews, 23 mai 2025). Un «déboussolement» qui profite – certainement – à ceux qui prospèrent dans la division, qu’il s’agisse de puissances rivales ou de mouvements islamistes.
En tout état de cause, cette cécité est aujourd’hui exploitée par des acteurs intérieurs et extérieurs – partis radicaux, Etats, lobbies, et puissances régionales – intéressés par une rupture franco-algérienne. Se posent alors des interrogations légitimes qui devraient être mises à la portée de l’opinion publique française : qui tient la «boussole» de Retailleau ? Est-il un «numéro deux» manquant de profondeur ou un pion dans un jeu géopolitique plus large ?
A qui profite la distance France-Algérie ?
La distance croissante entre Paris et Alger, exacerbée par Retailleau, profite à plusieurs acteurs : des Etats comme le Maroc, l’Etat sioniste ou encore les Émirats arabes unis, en rivalité avec l’Algérie sur le Sahara Occidental et les enjeux de puissances régionales, tirent parti d’une France alignée sur leurs intérêts. Rachad, protégé par des décisions judiciaires européennes, gagne en influence en l’absence d’une coopération franco-algérienne renforcée et progresse en consolidant des jurisprudences profitables aux mouvements islamistes exilés. Enfin, les discours anti-algériens de figures comme De Villiers ou Zemmour alimentent un climat de défiance, détournant l’attention des solutions concrètes, favorable à la montée des populismes européens.
En revanche, un rapprochement France-Algérie, basé sur un partage d’expertise contre l’islamisme, renforcerait la sécurité des deux pays. La France bénéficierait des leçons algériennes sur la déradicalisation, tandis qu’Alger gagnerait un partenaire dans sa lutte contre Rachad et ses relais étatiques.
Vers un partenariat manqué
Pour la majorité lucide des deux rives, la pseudo-affaire du consulat de Créteil a été fuitée et instrumentalisée à dessein pour en faire un point d’achoppement du retour à la normale des relations avec l’Algérie. L’Algérie n’a fait que réagir à des provocations d’une partie de la France officielle, fut-elle judiciaire. La France, par sa déconstruction depuis 1905, n’a fait que suivre un référentiel de textes qui l’immobilise en rempart contre le bon sens et, dans ce contexte précis, contre les règles d’usage propres aux services de sécurité. Et dans cet imbroglio, une solution existe pourtant : la France doit reconnaître l’expérience algérienne contre l’islamisme, voire même pour réparer ses erreurs en Afrique, et bâtir un partenariat fondé sur des intérêts communs. La boussole de Retailleau, si elle existe, doit être recalibrée pour viser une coopération, non une rupture. Ce n’est qu’alors que l’Algérie, déjà prémunie contre la République des juges, tournera la page pour ouvrir le chapitre «l’Avenir et le partenariat gagnant».
I. A.
L’article France : pourquoi l’Algérie est «oubliée» dans la «lutte» contre l’islamisme est apparu en premier sur Algérie Patriotique.