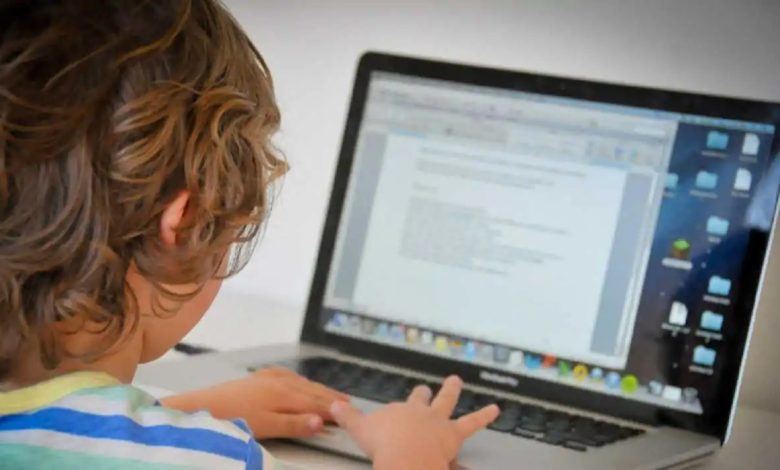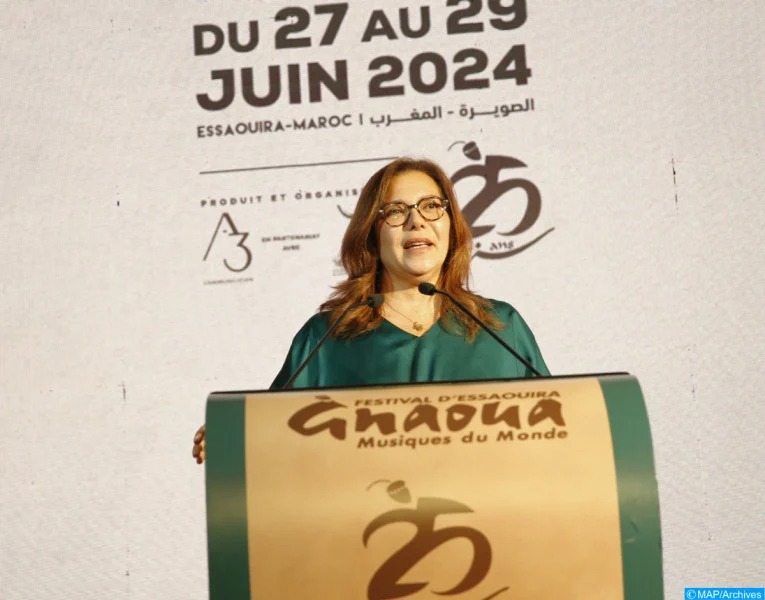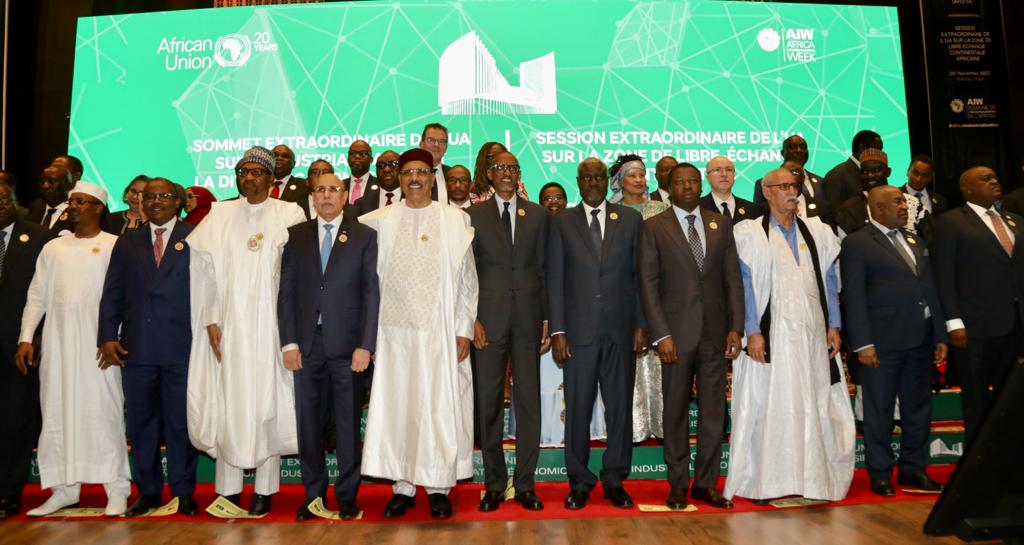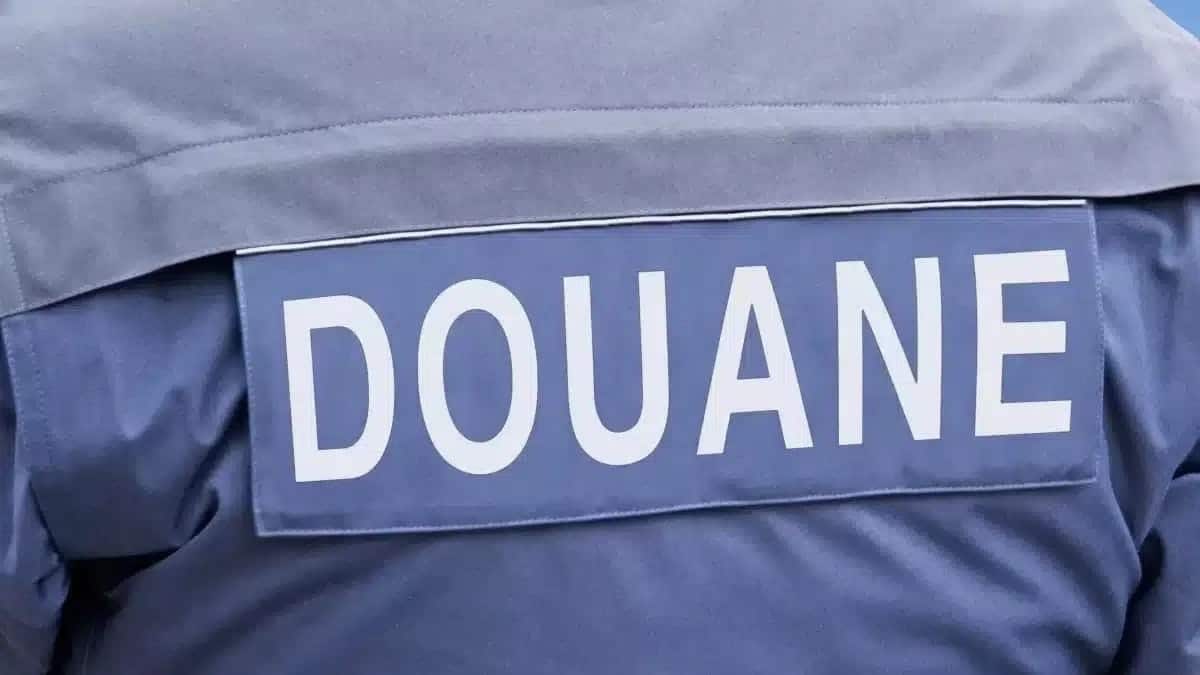Nadia Aït Zaï, avocate et directrice du Ciddef, au Jeune Indépendant : «Le signalement doit être intégré à notre culture juridique»
Avocate et directrice du Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme (Ciddef), Nadia Aït Zaï revient sur l’affaire du présumé viol de 40 mineures à Oran et aborde en profondeur les enjeux du signalement, la protection des enfants et l’application des lois. Le Jeune Indépendant : L’affaire du présumé […] The post Nadia Aït Zaï, avocate et directrice du Ciddef, au Jeune Indépendant : «Le signalement doit être intégré à notre culture juridique» appeared first on Le Jeune Indépendant.

Avocate et directrice du Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme (Ciddef), Nadia Aït Zaï revient sur l’affaire du présumé viol de 40 mineures à Oran et aborde en profondeur les enjeux du signalement, la protection des enfants et l’application des lois.
Le Jeune Indépendant : L’affaire du présumé viol de 40 mineures à Oran a profondément choqué l’opinion publique. Comment la percevez-vous ?
Nadia Aït Zaï : Ce que je peux dire, c’est qu’il faut d’abord prendre du recul par rapport à la façon dont l’information a circulé. Les médias ont rapporté un fait divers extrêmement choquant, certes, mais il faut s’interroger : d’où viennent ces chiffres ? Qui les a transmis aux journalistes ? Car le parquet, de son côté, n’a confirmé qu’un seul cas. Cela pose la question de l’écart entre la réalité judiciaire et les chiffres relayés publiquement. Est-ce que les 39 autres victimes n’ont pas osé se déclarer ? Cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas. Il est fort probable qu’elles aient bel et bien existé. Mais peut-être ne se sont-elles pas déclarées.
Pourtant, cette affaire a aussi été portée au Parlement. Un député a interpellé le ministre de la Justice. Que retenir de cette intervention ?
Ce député a réagi à l’information brute, sans recul juridique. Il a toutefois soulevé deux points fondamentaux : l’obligation de signalement et la réaction des familles. Il a ainsi mis le doigt sur un vrai problème, celui du signalement. Il a estimé que si les mères ou les familles savaient, elles auraient dû alerter les autorités. Cela nous amène à parler de la nature même du signalement. Le problème, c’est que ce signalement n’est pas encadré légalement dans notre système.
Ce que nous avons aujourd’hui, c’est la notion de dénonciation, prévue dans la loi sur la protection de l’enfance. Elle permet d’informer la police, le P/APC (président de la commission communale de protection), ou toute autorité compétente. Mais le terme « dénonciation » est lourd ; il est connoté négativement, presque assimilé à de la délation. Alors que le signalement est un acte de prévention, de vigilance. C’est sur cette base qu’un vrai protocole devrait exister. Ce dernier doit être encadré par un protocole : qui signale ? à qui ? comment ? Il faut aussi des formulaires, un circuit clair.
Justement, comment mettre en place un protocole de signalement efficace ?
Il faut s’en inspirer d’ailleurs. Dans d’autres pays, tout est cadré : formulaires, interlocuteurs précis, procédures claires. L’Organe national de protection et de promotion de l’enfance avait entamé ce travail mais il s’est arrêté. Il est temps qu’il reprenne. Le ministère de la Solidarité devrait relancer ce chantier.
Il faut que les médecins, les enseignants, les travailleurs sociaux sachent qu’ils peuvent et doivent signaler. Or, certains s’en abstiennent, car ils craignent d’être impliqués, voire accusés à tort. Cela montre bien le besoin de sécuriser et d’encadrer cet acte.
Le député évoquait l’idée de rendre ce signalement obligatoire pour les parents, les enseignants, les professionnels de santé. Est-il pertinent de le faire ?
Cette obligation existe déjà dans certains cas. Dans la loi sur la santé, les médecins sont tenus de signaler tout cas de maltraitance observée. De même, le code pénal prévoit qu’on peut être poursuivi pour non-dénonciation lorsqu’on sait qu’un enfant est en danger. En faire une obligation légale explicite pour certaines professions serait une bonne chose. Mais au-delà de la loi, il faut sensibiliser. Dire aux gens : « Si vous voyez, signalez. Ne vous taisez pas. » Car le silence protège les agresseurs. Heureusement, les mentalités évoluent. De plus en plus de citoyens signalent. Le tabou existe encore, mais les gens deviennent plus protecteurs.
Concernant les sanctions contre ce type d’agression, disposons-nous, sur le plan juridique, des textes nécessaires pour lutter contre ces crimes ?
Absolument. Notre arsenal juridique est solide, notamment le Code pénal, qui a intégré de nombreux éléments de la Convention internationale des droits de l’enfant. Et, surtout, les peines sont aggravées lorsqu’il s’agit de victimes mineures. Une infraction punie de 10 ans dans le cas d’un adulte pourrait valoir 20 ans si la victime est un enfant. Le problème n’est donc pas dans la loi mais dans la prévention, la sensibilisation et la protection effective.
Concernant les enfants victimes de ce type d’agression. Quelles mesures concrètes recommandez-vous pour garantir une prise en charge optimale ?
D’abord, il faut identifier les victimes. On parle de viols, d’agressions sexuelles, d’abus, d’inceste … et pour cela, la médecine légale est essentielle. A l’hôpital Mustapha, par exemple, il existe un service spécialisé pour les agressions sexuelles sur enfants. Il assure un suivi psychologique et médical. Mais ce dispositif doit être généralisé à tous les hôpitaux, à toutes les unités de médecine légale. Au Ciddef, nous recevons aussi des enfants agressés, et notre psychologue les prend en charge. Elle peut déceler les signes, distinguer le vrai du faux.
Concrètement, que propose votre fondation aux victimes ?
Dès qu’un cas nous est signalé, notre psychologue prend en charge l’enfant. Elle l’écoute, l’évalue, le suit. C’est elle aussi qui peut, à travers son expertise, distinguer ce qui est réel de ce qui pourrait être inventé. Car il y a des cas de confusion. Ce suivi est essentiel et il faut des professionnels bien formés pour cela. Une fois les cas confirmés nous les signalons aux autorités compétentes.
Est-ce que ces signalements sont bien pris en compte par les autorités ?
Oui, aujourd’hui, les choses ont évolué. Les services de police et de gendarmerie prennent très au sérieux les cas d’agression sexuelle sur mineurs. Il existe des brigades spécialisées, la brigade des mineurs, qui disposent d’outils modernes, et le personnel est mieux formé. Lorsqu’on leur signale un cas, ils le prennent en charge. Il y a un suivi réel. Si ce n’était pas le cas, ils pourraient eux-mêmes être poursuivis pour non-assistance ou dysfonctionnement.
Que dire à ceux qui doutent encore de la réactivité des institutions ?
Il faut aller jusqu’au bout des démarches. Si la police ne réagit pas, il y a le parquet, le procureur de la République. Ce dernier a le devoir de recevoir les citoyens. Il faut cesser de s’arrêter à mi-chemin. Ceux qui disent que leurs plaintes ne sont pas prises en compte doivent insister, demander des comptes, exiger que la procédure suive son cours.
Un dernier mot sur la façon dont cette affaire a été traitée dans l’espace public ?
Il est essentiel de gérer ce type d’affaire avec calme, patience et sans passion. Il faut éviter de se laisser emporter par une opinion publique souvent affolée ou mal informée, et surtout éviter les amalgames. Chaque cas doit être traité avec rigueur et humanité. La justice a besoin de temps et de rigueur. Il faut laisser les institutions travailler, tout en continuant à œuvrer pour mieux encadrer le signalement et accompagner les victimes.
The post Nadia Aït Zaï, avocate et directrice du Ciddef, au Jeune Indépendant : «Le signalement doit être intégré à notre culture juridique» appeared first on Le Jeune Indépendant.